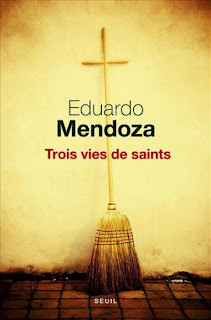Tout juste sorti du Royaume de Carrère, me revoici dans l'histoire vécue d'un personnage, racontée à la troisième personne, truffée des impressions de l'auteur écrivant cette histoire, et ce à la première personne. Ce n'était pourtant pas prévu que deux styles aussi ressemblants se succèdent. Tendance?
Ici, Olivier Rolin nous ramène dans l'URSS du temps de Staline. Le météorologue en question a été, comme des millions de gens, arrêté pour des raisons obscures, puis déporté dans un camp avant d'être tué. Ce livre est d'abord le récit de ce personnage en particulier, qui sert aussi de prétexte pour raconter toute une époque. Ce qu'Olivier Rolin nous raconte, en fait, concerne un pan de l'histoire méconnu, soit celui dit de la "Grande Terreur", qui se situe à la fin des années 30. Staline et ses sbires régnaient par la terreur dans ce qui se voulait pourtant un nouveau modèle social. Toute personne jouissant de ne serait-ce qu'une influence infime hors du cadre du "Parti" était arrêtée puis fusillée. Ainsi en fut-il de ce scientifique sans trop d'histoire, un vrai geek, qui volait vers le succès, ce qui déplut.
Maintenant, pourquoi raconter son histoire à lui? De toute évidence, une correspondance à peu près intacte et un legs de dessins exécutés pendant sa capture ont inspiré l'auteur. Ces lettres sont adressées à sa femme et les dessins, à sa petite fille d'à peine quatre ans. Les lettres sont touchantes, les dessins encore plus, et si l'histoire mérite d'être racontée, elle m'a semblé trop sommaire. Bien sur, Rolin raconte en supposant plusieurs choses au sujet de son personnage (exactement comme Carrère pour les siens...), et à travers ces suppositions, il en profite pour raconter l'époque en URSS en même temps que sa relation avec ce qu'est devenue la Russie. C'est beaucoup de choses pour un seule livre, au demeurant pas tellement long.
Raconter une histoire et sa relation avec cette histoire est un exercice très ambitieux. Rolin est parvenu à me renseigner sur un pan de l'Histoire que je connaissais très mal et je l'en remercie. Sa connaissance des institutions et des personnages marquants de l'époque sont probants. Quant au personnage dont l'existence est le prétexte du livre, j'ai été touché, mais à peine. Le traitement de cette histoire, s'il est bien fouillé, m'a dérangé dans sa forme. Rolin passe, dans le même paragraphe, d'une phrase à la troisième personne à une suivante à la première, tout ça sans guillemets ou quelque forme de ponctuation que ce soit pour distinguer qui parle. Or n'est pas Saramago qui veut. Passer outre aux règles élémentaires de la ponctuation se fait, à mon sens, dans un exercice de style qui a pour but de déstabiliser le lecteur. Ce n'est pas le cas ici. Il faut simplement relire certains paragraphes deux fois, ce qui est désagréable. Dommage, parce que l'époque racontée est fascinante, le personnage choisi, intriguant, et la relation de l'auteur avec l'histoire, pertinente bien qu'accessoire.
Bon livre, donc, mais mauvais timing pour ma part. L'auto-fiction dans la docu-fiction, c'est bien, mais y'a pas que ça. J'ai, ces derniers temps, besoin qu'on me raconte autre chose que soi.
samedi 20 décembre 2014
lundi 8 décembre 2014
Le royaume, par Emmanuel Carrère, éditions P.O.L.
Lorsque lire un livre devient une expérience, que sa période de lecture devient un petit bout de vie dont on veut se rappeler, je crois qu'on peut en conclure que le livre était bon. Et pourtant, Le royaume a commencé si difficilement...
On le sait maintenant, les livres de Carrère ne sont pas des romans "conventionnels". Dans ce qu'il raconte, cet auteur s'ajoute, se met lui-même en scène. Faut aimer, tant le style que le personnage.
Le personnage, c'est lui, Emmanuel Carrère qui nous raconte, dans la première partie du livre, les quelques années de sa vie où il s'est réfugié (si on peut appeler ça ainsi) dans le catholicisme. C'était dans sa trentaine, jeune père de famille. L'auteur nous raconte le pourquoi et le comment de cette "conversion": les hauts, les bas, les lignes droites, les travers, etc. C'est Carrère, donc c'est joliment raconté, mais à force, ça s'alourdit. Au fil des pages, j'avais de plus en plus une impression de "je, me, moi", quoi que souvent atténuée par certaines confessions qui me rendaient le présumé écrivain narcissique un peu plus sympathique. Mais quand même... Je craignais une oeuvre surestimée d'un auteur au faîte de sa carrière, jusqu'à ce que commence la deuxième partie du livre. Alors là, ça décolle, et pas à peu près.
Fort de réflexions qu'il a couché par écrit lors de ses années religieuses, l'auteur décide, quelques années plus tard de pousser plus loin sa réflexion. Un concours de circonstances l'emmène se poser la question: mais qu'est-ce qui a fait que des gens en sont venus à se bâtir une religion autour de l'idée de résurrection? Comment, en fait, en est-on venu à croire à ça? Pour y répondre, il se penchera non sur Jésus lui-même, mais bien sur ceux qui, les premiers, ont rapporté ses propos. Comment, donc, s'est propagé cette histoire? Pour l'expliquer, Carrère s'arrêtera particulièrement sur deux personnages, soit Luc, l'un des évangélistes, et Paul, le fameux Saint-Paul, celui qui, à la suite d'une chute à cheval, décide que dorénavant, sa foi, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, eh bien c'est tout le monde qui devrait l'adopter. Propagande, candeur, opportunisme lié au contexte historique d'alors, il est question de tout ça, et beaucoup plus. Avec le regard d'un historien mais aussi d'un chroniqueur, l'auteur nous raconte, à coups de suppositions et de faits historiques, les débuts de la chrétienté: histoire du peuple juif, de la Palestine, de l'empire romain, de la chute de Jérusalem, de Rome qui brûle... c'est toute cette époque. Et c'est absolument passionnant.
Oui, Carrère continue à exposer les faits et ses théories en regard de son expérience personnelle. Ça peut paraître prétentieux, mais non, ça ne l'est pas, enfin pas trop. Et si ça l'est, on en vient à le comprendre, et ce même si, à quelques occasions, l'auteur nous avoue prétendre être en train de rédiger ce qu'il croit être son livre le plus percutant. Carrère a le mérite d'être sincère et franc... mais aussi, et surtout, érudit et ça, c'est du bonbon.
Maintenant, un tel livre saura-t-il intéresser le commun des immortels (et même des immortels) en 2014-2015? Personnellement, je ne crois pas, quoi que... Il ne s'agit pas ici de connaître la vie des saints par coeur pour apprécier Le royaume. À tout le moins est-il utile de connaître les fondements de la religion chrétienne. À partir de là, on lit ce livre non seulement pour en savoir plus sur cette école de pensée, mais aussi sur la sienne propre, et c'est ce qui fait la force de ce livre. N'étant absolument pas religieux moi-même, je ne m'en intéresse pas moins à ces phénomènes importants de notre monde que sont les religions. Ayant, comme tout le monde des principes, j'en suis aussi parfois à me demander où je me situe par rapport à telle ou telle école de pensée. Carrère nous emmène là, à faire une réflexion ludique, dirais-je, et instructive par le fait même. Non, Le royaume n'a aucune velléité prosélyte, ni aucun arrière-goût new-age. Il nous emmène seulement à nous questionner sur le sens qu'on donne à notre vie en prenant pour exemple celle de gens qui croyaient tellement fort à leur histoire qu'ils voulaient la partager avec d'autres. Pris dans leur contexte historique, peut-être avaient-ils raison, à vous de voir. En même temps, vous vous ferez votre propre définition, vous aussi, du Royaume en question. Celle proposée par Emmanuel Carrère est, à mon sens, jubilatoire.
Esprits curieux, amateurs d'Histoire, fans de bonnes histoires: c'est à lire absolument. Je vous souhaite que sa lecture soit aussi jouissive que fut la mienne.
On le sait maintenant, les livres de Carrère ne sont pas des romans "conventionnels". Dans ce qu'il raconte, cet auteur s'ajoute, se met lui-même en scène. Faut aimer, tant le style que le personnage.
Le personnage, c'est lui, Emmanuel Carrère qui nous raconte, dans la première partie du livre, les quelques années de sa vie où il s'est réfugié (si on peut appeler ça ainsi) dans le catholicisme. C'était dans sa trentaine, jeune père de famille. L'auteur nous raconte le pourquoi et le comment de cette "conversion": les hauts, les bas, les lignes droites, les travers, etc. C'est Carrère, donc c'est joliment raconté, mais à force, ça s'alourdit. Au fil des pages, j'avais de plus en plus une impression de "je, me, moi", quoi que souvent atténuée par certaines confessions qui me rendaient le présumé écrivain narcissique un peu plus sympathique. Mais quand même... Je craignais une oeuvre surestimée d'un auteur au faîte de sa carrière, jusqu'à ce que commence la deuxième partie du livre. Alors là, ça décolle, et pas à peu près.
Fort de réflexions qu'il a couché par écrit lors de ses années religieuses, l'auteur décide, quelques années plus tard de pousser plus loin sa réflexion. Un concours de circonstances l'emmène se poser la question: mais qu'est-ce qui a fait que des gens en sont venus à se bâtir une religion autour de l'idée de résurrection? Comment, en fait, en est-on venu à croire à ça? Pour y répondre, il se penchera non sur Jésus lui-même, mais bien sur ceux qui, les premiers, ont rapporté ses propos. Comment, donc, s'est propagé cette histoire? Pour l'expliquer, Carrère s'arrêtera particulièrement sur deux personnages, soit Luc, l'un des évangélistes, et Paul, le fameux Saint-Paul, celui qui, à la suite d'une chute à cheval, décide que dorénavant, sa foi, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, eh bien c'est tout le monde qui devrait l'adopter. Propagande, candeur, opportunisme lié au contexte historique d'alors, il est question de tout ça, et beaucoup plus. Avec le regard d'un historien mais aussi d'un chroniqueur, l'auteur nous raconte, à coups de suppositions et de faits historiques, les débuts de la chrétienté: histoire du peuple juif, de la Palestine, de l'empire romain, de la chute de Jérusalem, de Rome qui brûle... c'est toute cette époque. Et c'est absolument passionnant.
Oui, Carrère continue à exposer les faits et ses théories en regard de son expérience personnelle. Ça peut paraître prétentieux, mais non, ça ne l'est pas, enfin pas trop. Et si ça l'est, on en vient à le comprendre, et ce même si, à quelques occasions, l'auteur nous avoue prétendre être en train de rédiger ce qu'il croit être son livre le plus percutant. Carrère a le mérite d'être sincère et franc... mais aussi, et surtout, érudit et ça, c'est du bonbon.
Maintenant, un tel livre saura-t-il intéresser le commun des immortels (et même des immortels) en 2014-2015? Personnellement, je ne crois pas, quoi que... Il ne s'agit pas ici de connaître la vie des saints par coeur pour apprécier Le royaume. À tout le moins est-il utile de connaître les fondements de la religion chrétienne. À partir de là, on lit ce livre non seulement pour en savoir plus sur cette école de pensée, mais aussi sur la sienne propre, et c'est ce qui fait la force de ce livre. N'étant absolument pas religieux moi-même, je ne m'en intéresse pas moins à ces phénomènes importants de notre monde que sont les religions. Ayant, comme tout le monde des principes, j'en suis aussi parfois à me demander où je me situe par rapport à telle ou telle école de pensée. Carrère nous emmène là, à faire une réflexion ludique, dirais-je, et instructive par le fait même. Non, Le royaume n'a aucune velléité prosélyte, ni aucun arrière-goût new-age. Il nous emmène seulement à nous questionner sur le sens qu'on donne à notre vie en prenant pour exemple celle de gens qui croyaient tellement fort à leur histoire qu'ils voulaient la partager avec d'autres. Pris dans leur contexte historique, peut-être avaient-ils raison, à vous de voir. En même temps, vous vous ferez votre propre définition, vous aussi, du Royaume en question. Celle proposée par Emmanuel Carrère est, à mon sens, jubilatoire.
Esprits curieux, amateurs d'Histoire, fans de bonnes histoires: c'est à lire absolument. Je vous souhaite que sa lecture soit aussi jouissive que fut la mienne.
vendredi 5 décembre 2014
Chevrotine, par Éric Fottorino, éditions Gallimard
Sentant qu'il va bientôt mourrir, un homme veut raconter à sa fille comment sa mère est disparue, alors que l'enfant avait tout juste deux ans.
Remarié après le difficile deuil d'une première épouse aimée, l'homme en question tombe (mot choisi...) sous l'emprise d'une femme qui, petit à petit, empoisonnera sa vie et celle de tous ceux autour d'eux. Portrait parfait d'une personne toxique, on a ici un genre de polar à l'envers où est expliqué le mode d'emploi d'un terrible aboutissement. Le personnage principal raconte le tissage d'une toile d'araignée dans laquelle il est tombé. Sans être carrément horrible, Chevrotine n'est certainement pas jojo. Bien écrit, raconté froidement, il siérait bien à une soirée d'Halloween.
On a en effet à faire avec un genre de sorcière moderne. Misérabiliste à l'extrême, cette femme aura tout pour se faire haïr. En fait, ne pas connaître Éric Fottorino, on pourrait presque crier au roman misogyne. Outre la quasi-sorcière en question, on remarque que les autres personnages de femmes, secondaires, sont soit mièvres (la première femme), soit peu signifiants. Or, des personnages ont-ils à être sympathiques pour faire une bonne histoire? Non, bien sur. N'en demeure pas moins que force est de reconnaître leurs principales caractéristiques. Dans ce cas, le mauvais rôle des personnages féminins est flagrant, d'autant plus que celui des hommes n'est pas spécialement mauvais. À peine les trouvera-t-on un peu mous, pas assez surs d'eux, manipulés. On navigue dans un monde d'ouvriers, d'anciens pêcheurs reconvertis en travailleurs manuels. Leurs vies, comme les décors, sont teintés du gris du bord de la mer, et du vent. C'est un monde qui ne l'a pas facile, comme notre bonhomme et ça, Fottorino le décrit bien. Comme décor, comme mise en scène, c'est tout à fait réussi. Quant à l'histoire, c'est tout aussi bien ficelé. On assiste à la lente chute d'un couple qui creuse sa tombe à deux, multipliant les victimes autour d'eux, et c'est d'autant plus triste qu'il s'agit de leurs enfants.
Fottorino raconte une histoire de désoeuvrement, de gens qui n'ont eu cesse de faire des mauvais choix. Et pourtant, notre homme, le personnage principal, était porté par son coeur. C'est pourtant ce qui l'a coulé.
Excellent romancier, Éric Fottorino surprend ici par le propos et par les ingrédients utilisés: ses personnages féminins peu aimables, sauf peut-être la fille du couple dont il est question, qui sera peut-être sauvée par sa jeunesse, et ses personnages masculins victimes d'une vie dure. Chevrotine est un roman sombre, de belle facture et qui, sans révolutionner le genre, ne laisse pas indifférent non plus.
Remarié après le difficile deuil d'une première épouse aimée, l'homme en question tombe (mot choisi...) sous l'emprise d'une femme qui, petit à petit, empoisonnera sa vie et celle de tous ceux autour d'eux. Portrait parfait d'une personne toxique, on a ici un genre de polar à l'envers où est expliqué le mode d'emploi d'un terrible aboutissement. Le personnage principal raconte le tissage d'une toile d'araignée dans laquelle il est tombé. Sans être carrément horrible, Chevrotine n'est certainement pas jojo. Bien écrit, raconté froidement, il siérait bien à une soirée d'Halloween.
On a en effet à faire avec un genre de sorcière moderne. Misérabiliste à l'extrême, cette femme aura tout pour se faire haïr. En fait, ne pas connaître Éric Fottorino, on pourrait presque crier au roman misogyne. Outre la quasi-sorcière en question, on remarque que les autres personnages de femmes, secondaires, sont soit mièvres (la première femme), soit peu signifiants. Or, des personnages ont-ils à être sympathiques pour faire une bonne histoire? Non, bien sur. N'en demeure pas moins que force est de reconnaître leurs principales caractéristiques. Dans ce cas, le mauvais rôle des personnages féminins est flagrant, d'autant plus que celui des hommes n'est pas spécialement mauvais. À peine les trouvera-t-on un peu mous, pas assez surs d'eux, manipulés. On navigue dans un monde d'ouvriers, d'anciens pêcheurs reconvertis en travailleurs manuels. Leurs vies, comme les décors, sont teintés du gris du bord de la mer, et du vent. C'est un monde qui ne l'a pas facile, comme notre bonhomme et ça, Fottorino le décrit bien. Comme décor, comme mise en scène, c'est tout à fait réussi. Quant à l'histoire, c'est tout aussi bien ficelé. On assiste à la lente chute d'un couple qui creuse sa tombe à deux, multipliant les victimes autour d'eux, et c'est d'autant plus triste qu'il s'agit de leurs enfants.
Fottorino raconte une histoire de désoeuvrement, de gens qui n'ont eu cesse de faire des mauvais choix. Et pourtant, notre homme, le personnage principal, était porté par son coeur. C'est pourtant ce qui l'a coulé.
Excellent romancier, Éric Fottorino surprend ici par le propos et par les ingrédients utilisés: ses personnages féminins peu aimables, sauf peut-être la fille du couple dont il est question, qui sera peut-être sauvée par sa jeunesse, et ses personnages masculins victimes d'une vie dure. Chevrotine est un roman sombre, de belle facture et qui, sans révolutionner le genre, ne laisse pas indifférent non plus.
samedi 15 novembre 2014
Mayonnaise, par Éric Plamondon, éditions Le Quartanier
Après Johnny "Tarzan" Weissmuler, Éric Plamondon se penche sur Richard Brautigan, un écrivain américain que je ne connaissais pas, dans le deuxième tome de sa trilogie 1984.
Comme dans Hongrie-Hollywood Express, Plamondon explore la vie d'un personnage, et particulièrement sa fin, arrivée en 1984, justement, tout en donnant la parole à un narrateur qui, lui, vit à notre époque. Si le premier personnage a bel et bien existé, on imagine le second fictif... à moins qu'il ne s'agisse de l'auteur. En fait, le narrateur, s'il parle souvent de lui, se présente quand même assez rapidement. Ce narrateur, on peut le supposer qu'il s'agisse de l'auteur du livre, puisqu'il s'agit d'un fan indéniable de Brautigan. Mayonnaise est donc le récit de la rencontre d'un personnage fictif avec un écrivain ayant déjà vécu.
L'auteur raconte cette rencontre par bribes, en alignant des anecdotes qui ramènent tantôt à Brautigan, tantôt au narrateur, tantôt à tout autre personnage ou situation ou fait historique, enfin un tas de choses. Plusieurs de ces choses sont là en incise. De Kurt Vonnegut à Jack Nicholson en passant par Charlie Chaplin, on devine beaucoup de recherche et si on s'en donne la peine, on google beaucoup en lisant Mayonnaise. En fait, on s'en rend compte, les livres d'Éric Plamondon se distinguent par leur forme. Je dirais que c'est écrit pour bien se lire.
Alors pourquoi j'embarque aussi difficilement?
Tout, là dedans, est pourtant sympathique. Le personnage historique: hors norme, mal compris mais déterminant; les anecdotes: ludiques, drôles, intelligentes; le narrateur... bon, pour lui je sais pas trop. En fait, il pourrait être un peu n'importe qui. S'il a un rôle autre que de raconter Brautigan, je l'ai assez mal saisi. Mais l'ensemble est bien, ça coule. C'est fouillé, très fouillé, même, limite encyclopédique. Ça parle de vivre sa vie, de réussites, de défaites... En fait, malgré des chapitres courts, ça parle beaucoup.
En lisant Plamondon, j'ai l'impression de revenir à l'école secondaire et d'assister à la présentation parfaite d'une recherche réalisée par un premier de classe. Tout y est, y'a pas d'erreur, c'est léché, il a pensé à tout, ça mérite un A. Après une telle présentation, je reste avec un espèce de sentiment de frustration du genre "il a fait ça pour bien faire" ou "il a voulu nous impressionner". Bref, il en a trop fait. Mais...
La fin de Mayonnaise est superbe. En racontant sa fin, l'auteur magnifie Brautigan et rend hommage à son esprit libre. En 4 ou 5 pages, il refait le tour du personnage en parlant de lui avec coeur. Là, j'ai totalement embarqué. J'me suis dit que oui, je comprends qu'on ait aimé un mec du genre, qu'on en soit devenu fan. Vivement un peu plus de Richard Brautigan. Mais n'empêche, j'ai terminé Mayonnaise et c'est bien. C'était un peu lourd, un peu académique, un peu froid. J'ai presqu'envie de m'excuser d'avoir trouvé ce livre trop... trop tout.
Cette entrevue d'Éric Plamondon réalisée à la radio de Radio-Canada explique la passion de l'auteur pour son personnage principal, Richard Brautigan.
Comme dans Hongrie-Hollywood Express, Plamondon explore la vie d'un personnage, et particulièrement sa fin, arrivée en 1984, justement, tout en donnant la parole à un narrateur qui, lui, vit à notre époque. Si le premier personnage a bel et bien existé, on imagine le second fictif... à moins qu'il ne s'agisse de l'auteur. En fait, le narrateur, s'il parle souvent de lui, se présente quand même assez rapidement. Ce narrateur, on peut le supposer qu'il s'agisse de l'auteur du livre, puisqu'il s'agit d'un fan indéniable de Brautigan. Mayonnaise est donc le récit de la rencontre d'un personnage fictif avec un écrivain ayant déjà vécu.
L'auteur raconte cette rencontre par bribes, en alignant des anecdotes qui ramènent tantôt à Brautigan, tantôt au narrateur, tantôt à tout autre personnage ou situation ou fait historique, enfin un tas de choses. Plusieurs de ces choses sont là en incise. De Kurt Vonnegut à Jack Nicholson en passant par Charlie Chaplin, on devine beaucoup de recherche et si on s'en donne la peine, on google beaucoup en lisant Mayonnaise. En fait, on s'en rend compte, les livres d'Éric Plamondon se distinguent par leur forme. Je dirais que c'est écrit pour bien se lire.
Alors pourquoi j'embarque aussi difficilement?
Tout, là dedans, est pourtant sympathique. Le personnage historique: hors norme, mal compris mais déterminant; les anecdotes: ludiques, drôles, intelligentes; le narrateur... bon, pour lui je sais pas trop. En fait, il pourrait être un peu n'importe qui. S'il a un rôle autre que de raconter Brautigan, je l'ai assez mal saisi. Mais l'ensemble est bien, ça coule. C'est fouillé, très fouillé, même, limite encyclopédique. Ça parle de vivre sa vie, de réussites, de défaites... En fait, malgré des chapitres courts, ça parle beaucoup.
En lisant Plamondon, j'ai l'impression de revenir à l'école secondaire et d'assister à la présentation parfaite d'une recherche réalisée par un premier de classe. Tout y est, y'a pas d'erreur, c'est léché, il a pensé à tout, ça mérite un A. Après une telle présentation, je reste avec un espèce de sentiment de frustration du genre "il a fait ça pour bien faire" ou "il a voulu nous impressionner". Bref, il en a trop fait. Mais...
La fin de Mayonnaise est superbe. En racontant sa fin, l'auteur magnifie Brautigan et rend hommage à son esprit libre. En 4 ou 5 pages, il refait le tour du personnage en parlant de lui avec coeur. Là, j'ai totalement embarqué. J'me suis dit que oui, je comprends qu'on ait aimé un mec du genre, qu'on en soit devenu fan. Vivement un peu plus de Richard Brautigan. Mais n'empêche, j'ai terminé Mayonnaise et c'est bien. C'était un peu lourd, un peu académique, un peu froid. J'ai presqu'envie de m'excuser d'avoir trouvé ce livre trop... trop tout.
Cette entrevue d'Éric Plamondon réalisée à la radio de Radio-Canada explique la passion de l'auteur pour son personnage principal, Richard Brautigan.
lundi 3 novembre 2014
La ballade d'Ali Baba, par Catherine Mavrikakis, éditions Héliotrope
Tour juste sorti des souvenirs d'enfance de Paul Auster, me voici, sans avoir vraiment voulu que ça arrive, qui émerge maintenant de ceux de Catherine Mavrikakis. Ce que je veux dire ici, c'est que deux fois ce même thème du retour sur l'enfance, c'est lourd. J'aurais du faire attention.
On ne peut reprocher à quiconque de raconter son passé. Pour plusieurs écrivains, on dirait même qu'il s'agit d'un passage obligé. Certain qu'il s'agit d'une source fertile d'inspiration, on le constate à lire Mavrikakis. Mais à l'autre bout, en tant que lecteur, il faut être disposé.
J'aime les auteurs pour leur imaginaire, leur façon de m'aider à m'évader du quotidien, de ce que j'appelle encore naïvement "la vraie vie". Lorsqu'ils me ramènent à des tranches de vie déjà vécue, je me rabat sur leur façon d'écrire et l'originalité de leur récit. C'est alors qu'ils m'embarquent. Mais si rien de tout cela n'arrive, on seulement une partie, j'aurai plutôt l'impression d'être témoin d'un genre de thérapie plus ou moins saine. Ici, avec Mavrikakis qui part dans toutes les directions du temps d'un chapitre à l'autre, qui va de l'enfance de son père en Grèce et en Algérie à la sienne de l'autre côté de l'Atlantique, avec des bouts de fiction où elle vit des aventures avec le fantôme de son père, je n'ai rien à reprocher pour l'originalité du traitement. Alors qu'a-t-il manqué pour que j'aie terminé ce livre avec soulagement?
On n'en est pas au premier modèle de mauvais père des années 70, à plus ou moins dix ans près, au modèle du père irresponsable, libéré du poids d'une enfance rude qui fait de sa "nouvelle" vie quelque chose d'aléatoire, tourné vers des besoins égoïstes. Pourtant, au contraire des portraits de pères québécois, on a ici une variante intéressante en ce que l'auto-dépréciation et le remords ne prennent pas une trop grande place. Restent de grandes parts d'ingratitude, d'absence, mais aussi d'amour, d'urgence de vivre qui font d'une telle vie une histoire à raconter. C'est bien, ça traverse non seulement le temps mais aussi la géographie, mais à force, je m'aperçois que ça me lasse un peu.
Et il y a quelque chose d'autre... Habitante de Montréal, où elle est né, j'ai perçu chez Catherine Mavrikakis, la citoyenne montréalaise, une espèce de non-amour pour sa ville, pour sa position géographique. C'est possible, j'en conviens. On ne perçois pas tous son lieu de résidence de la même façon. Mais ça m'a agacé, voir déçu. J'ai toutefois compris la force de cette écrivaine qui a su si bien raconter l'Amérique, dans son tout américain. J'ai compris que c'est le continent qu'elle habite, et non la ville. Voilà pourquoi elle saura sans doute me faire voyager encore comme elle l'a fait avec Le ciel de Bay City beaucoup plus qu'avec des chroniques sur le lieu où nous habitons tous les deux. Il y a les écrivains du lieu, ceux du temps et ceux du monde. Je place Catherine Mavrikakis dans la troisième catégorie, qui lui va très bien. Pour le reste: ça me va moins.
Cette ballade d'Ali Baba, en fait, prend tout son sens dans une escapade faite au sud des États-Unis, à partir de Montréal. C'est son point de départ et son point de chute... et c'est là où moi, j'ai plutôt décidé de ne pas embarquer.
Pour le rêve américain, tant celui de son père que pour le sien: oui, il faut lire ce livre. Pour le reste, si ce rêve ne nous soulève pas, on fait comme moi et on reste au port en trouvant le temps long.
On ne peut reprocher à quiconque de raconter son passé. Pour plusieurs écrivains, on dirait même qu'il s'agit d'un passage obligé. Certain qu'il s'agit d'une source fertile d'inspiration, on le constate à lire Mavrikakis. Mais à l'autre bout, en tant que lecteur, il faut être disposé.
J'aime les auteurs pour leur imaginaire, leur façon de m'aider à m'évader du quotidien, de ce que j'appelle encore naïvement "la vraie vie". Lorsqu'ils me ramènent à des tranches de vie déjà vécue, je me rabat sur leur façon d'écrire et l'originalité de leur récit. C'est alors qu'ils m'embarquent. Mais si rien de tout cela n'arrive, on seulement une partie, j'aurai plutôt l'impression d'être témoin d'un genre de thérapie plus ou moins saine. Ici, avec Mavrikakis qui part dans toutes les directions du temps d'un chapitre à l'autre, qui va de l'enfance de son père en Grèce et en Algérie à la sienne de l'autre côté de l'Atlantique, avec des bouts de fiction où elle vit des aventures avec le fantôme de son père, je n'ai rien à reprocher pour l'originalité du traitement. Alors qu'a-t-il manqué pour que j'aie terminé ce livre avec soulagement?
On n'en est pas au premier modèle de mauvais père des années 70, à plus ou moins dix ans près, au modèle du père irresponsable, libéré du poids d'une enfance rude qui fait de sa "nouvelle" vie quelque chose d'aléatoire, tourné vers des besoins égoïstes. Pourtant, au contraire des portraits de pères québécois, on a ici une variante intéressante en ce que l'auto-dépréciation et le remords ne prennent pas une trop grande place. Restent de grandes parts d'ingratitude, d'absence, mais aussi d'amour, d'urgence de vivre qui font d'une telle vie une histoire à raconter. C'est bien, ça traverse non seulement le temps mais aussi la géographie, mais à force, je m'aperçois que ça me lasse un peu.
Et il y a quelque chose d'autre... Habitante de Montréal, où elle est né, j'ai perçu chez Catherine Mavrikakis, la citoyenne montréalaise, une espèce de non-amour pour sa ville, pour sa position géographique. C'est possible, j'en conviens. On ne perçois pas tous son lieu de résidence de la même façon. Mais ça m'a agacé, voir déçu. J'ai toutefois compris la force de cette écrivaine qui a su si bien raconter l'Amérique, dans son tout américain. J'ai compris que c'est le continent qu'elle habite, et non la ville. Voilà pourquoi elle saura sans doute me faire voyager encore comme elle l'a fait avec Le ciel de Bay City beaucoup plus qu'avec des chroniques sur le lieu où nous habitons tous les deux. Il y a les écrivains du lieu, ceux du temps et ceux du monde. Je place Catherine Mavrikakis dans la troisième catégorie, qui lui va très bien. Pour le reste: ça me va moins.
Cette ballade d'Ali Baba, en fait, prend tout son sens dans une escapade faite au sud des États-Unis, à partir de Montréal. C'est son point de départ et son point de chute... et c'est là où moi, j'ai plutôt décidé de ne pas embarquer.
Pour le rêve américain, tant celui de son père que pour le sien: oui, il faut lire ce livre. Pour le reste, si ce rêve ne nous soulève pas, on fait comme moi et on reste au port en trouvant le temps long.
dimanche 12 octobre 2014
Excursions dans la zone intérieure, par Paul Auster, éditions Actes Sud/Leméac
Je n'aurais pas cru possible une suite à Chronique d'hiver, le surprenant et si réjouissant ouvrage où Paul Auster racontait son histoire au "tu". Aussi surprenant dans sa forme que dans son contenu dénué de fiction, Auster dévoilait ce qui le constituait à travers des marques sur son corps. C'était brillant.
Seconde partie, donc, avec Excursions... qui va de la petite enfance de l'auteur jusqu'au début de sa vie d'adulte. Il n'y a pas de lien tels que les marques corporelles ou les adresses. Ici, ce sont des impressions, des pensées profondes, des certitudes et des doutes. Le titre est absolument bien choisi. Moins surprenant que le premier, on l'aurait voulu pareil. Or, plus profond parce que justement plus intérieur, ce second livre d'Auster qui s'auto-raconte est encore plus personnel que le premier. Tellement, à vrai dire, qu'il me semble frôler l'égocentrisme. Disons qu'au contraire des Chronique..., celui-là me rend plutôt dubitatif. C'est rare, très rare même, mais je ne me suis même pas rendu jusqu'à la fin.
Le livre commence avec des bribes d'enfance, des perceptions, la prise de conscience de ce qu'il est, du monde qui l'entoure, tout ça dans la sauce années 50 du New Jersey. Raconté par Paul Auster, avec ses mots d'esprit, c'est palpitant. Puis, comme ce fut le cas pour Chronique d'hiver, surviennent au moins deux descriptions hyper détaillées de deux films marquant l'apprentissage du petit Paul. Une de ces descriptions va facilement dans les trente pages. Ce ne sont pas mes portions favorites. Non, c'est pas ennuyant, et oui, Paul Auster les raconte avec passion, à travers les yeux du petit enfant qui voit le film pour la première fois, mais j'avais l'impression d'un grand aparté qui m'éloignait du héros de ce livre, celui auquel je m'étais attaché, soit l'auteur lui-même.
Puis, arrive une correspondance entre le narrateur/auteur et sa première épouse, dans les temps précédant leur union, soit au début de l'âge adulte. À un moment précis, Auster avoue ne pas savoir quelle importance apporter, et avoue, se relisant, ne pas se reconnaître dans la portion la plus jeune de cette correspondance. Eh bien c'est tout à fait le cas: on perd Paul Auster là-dedans. Cet échange épistolaire, édité ici dans un seul sens, c'est à dire de l'homme à la femme, prend toute la place à la fin du livre. On y retrouve les descriptions intéressantes, vues de l'intérieur, des événements de 68 à l'université Columbia, à New York, puis l'apprentissage se continue. Paul va à Paris, vit des angoisses, découvre la vie et poursuit ses études de littérature. C'est pesant. On constate qu'Auster a trouvé là une grande importance, un bel outil pour décrire l'homme qu'il est devenu, ça se sent. Mais c'est tellement personnel qu'après quelques missives et quelques années de lettres, je n'en pouvais plus. Vous savez, ce cliché qu'on se fait du ton un peu enflammé de l'étudiant en littérature qui philosophe? C'est comme ça pendant des pages et des pages. C'est là où il m'a perdu. Ses réflexions m'ont échappées, l'auteur/narrateur m'a glissé entre les doigts. Résultat: alors qu'il me restait encore quelque dix pages à lire, j'ai poussé un profond soupir et j'ai laissé tomber... le livre, mais pas Paul Auster pour autant.
Vite, un retour à la fiction!
Seconde partie, donc, avec Excursions... qui va de la petite enfance de l'auteur jusqu'au début de sa vie d'adulte. Il n'y a pas de lien tels que les marques corporelles ou les adresses. Ici, ce sont des impressions, des pensées profondes, des certitudes et des doutes. Le titre est absolument bien choisi. Moins surprenant que le premier, on l'aurait voulu pareil. Or, plus profond parce que justement plus intérieur, ce second livre d'Auster qui s'auto-raconte est encore plus personnel que le premier. Tellement, à vrai dire, qu'il me semble frôler l'égocentrisme. Disons qu'au contraire des Chronique..., celui-là me rend plutôt dubitatif. C'est rare, très rare même, mais je ne me suis même pas rendu jusqu'à la fin.
Le livre commence avec des bribes d'enfance, des perceptions, la prise de conscience de ce qu'il est, du monde qui l'entoure, tout ça dans la sauce années 50 du New Jersey. Raconté par Paul Auster, avec ses mots d'esprit, c'est palpitant. Puis, comme ce fut le cas pour Chronique d'hiver, surviennent au moins deux descriptions hyper détaillées de deux films marquant l'apprentissage du petit Paul. Une de ces descriptions va facilement dans les trente pages. Ce ne sont pas mes portions favorites. Non, c'est pas ennuyant, et oui, Paul Auster les raconte avec passion, à travers les yeux du petit enfant qui voit le film pour la première fois, mais j'avais l'impression d'un grand aparté qui m'éloignait du héros de ce livre, celui auquel je m'étais attaché, soit l'auteur lui-même.
Puis, arrive une correspondance entre le narrateur/auteur et sa première épouse, dans les temps précédant leur union, soit au début de l'âge adulte. À un moment précis, Auster avoue ne pas savoir quelle importance apporter, et avoue, se relisant, ne pas se reconnaître dans la portion la plus jeune de cette correspondance. Eh bien c'est tout à fait le cas: on perd Paul Auster là-dedans. Cet échange épistolaire, édité ici dans un seul sens, c'est à dire de l'homme à la femme, prend toute la place à la fin du livre. On y retrouve les descriptions intéressantes, vues de l'intérieur, des événements de 68 à l'université Columbia, à New York, puis l'apprentissage se continue. Paul va à Paris, vit des angoisses, découvre la vie et poursuit ses études de littérature. C'est pesant. On constate qu'Auster a trouvé là une grande importance, un bel outil pour décrire l'homme qu'il est devenu, ça se sent. Mais c'est tellement personnel qu'après quelques missives et quelques années de lettres, je n'en pouvais plus. Vous savez, ce cliché qu'on se fait du ton un peu enflammé de l'étudiant en littérature qui philosophe? C'est comme ça pendant des pages et des pages. C'est là où il m'a perdu. Ses réflexions m'ont échappées, l'auteur/narrateur m'a glissé entre les doigts. Résultat: alors qu'il me restait encore quelque dix pages à lire, j'ai poussé un profond soupir et j'ai laissé tomber... le livre, mais pas Paul Auster pour autant.
Vite, un retour à la fiction!
lundi 22 septembre 2014
Mr Gwynn, par Alessandro Barrico, éditions Gallimard
Attention! Lecteur enthousiaste parlant d'un de ses auteurs préférés (et j'ajouterais...) et qui n'a pas été déçu une seule miette. Ça risque de voler haut!
Aviez-vous lu son dernier, Emmaüs? C'était sur les premières amours, la perte de l'innocence, l'entrée dans la vie. Tragique, il comprenait toutefois des scènes tendres mais fortes d'une beauté inouïe. Avec Mr Gwynn, Barrico nous emmène dans l'univers des créateurs. Imagé, il est parsemé d'excentriques qui se tiennent dans l'ombre, de gens qu'on dirait "à part".
Mr Gwynn, un écrivain à succès, décide qu'il arrête tout. Or, quelque temps après sa résignation, l'envie d'écrire lui reprend. Or que faire pour ne pas retourner en arrière? Sa réflexion et les événements le mèneront à devenir portraitiste... par écrit.
Le voilà qui se prépare. On voit apparaître un musicien dont les chiens ont des noms de pianistes, un concepteur d'ampoules dont les réalisations ont des noms de reines, un ex-accordeur de pianos devenu écrivain, un passionné de buanderies... puis commencent les portraits. Un premier nous sera raconté en détails, puis suivront une dizaine d'autres dont certains seront particulièrement marquants.
À certaines occasions, j'ai eu l'impression de revoir le Petit prince faisant le tour des planètes, cherchant sa rose. Ça peut paraître cliché, mais sous la plume de Barrico, ça ne l'est pas. Mr Gwynn cherche effectivement quelque chose. Libre à vous d'identifier le but de sa quête et de dire s'il parvient à son but, mais une chose est sure: le processus décrit est prodigieusement beau.
Ce livre, ce sont des décors, en fait, surtout un en particulier, qui devient lui-même un personnage. Les personnages "humains" sont autant de couleurs vives qui y évoluent avec parfois des scènes presque immobiles où une ampoule a le beau rôle, où l'amitié rattrape un misanthrope, où la beauté se découvre dans ce qui n'est pas beau, où la méchanceté émerge de ce qui a l'air innocent. Sans aucune longueur, Mr Gwynn nous mène d'une scène à l'autre dans un monde où rien n'est ordinaire, celui de la création, du désir de produire du beau... et ce sans ostentation. Vous dire comment c'est beau...
Barrico est le roi incontestable de la description des sens et de tout ce que leur exploitation soulève. C'est un fin clinicien qui sait aller chercher le détail essentiel sur lequel pointer votre microscope. Alors vous voyez quelque chose d'extraordinaire dans ce qui, vu de votre oeil à vous, parait pourtant anodin.
Mais aller à la recherche d'un idéal, du beau, de la bonté, a son prix à payer. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce livre s'appelle Mr Gwynn et non, Mr. Barrico. Autrement, j'ose croire qu'il y a beaucoup de l'auteur dans ce personnage principal.
Il me semble que chaque livre de Barrico surpasse l'autre. Déjà qu'il n'a jamais rien écrit de mauvais, imaginez juste ce que celui-là peut procurer. Certaines scènes sont belles à couper le souffle. Du beau, du bon, du grand Barrico.
Aviez-vous lu son dernier, Emmaüs? C'était sur les premières amours, la perte de l'innocence, l'entrée dans la vie. Tragique, il comprenait toutefois des scènes tendres mais fortes d'une beauté inouïe. Avec Mr Gwynn, Barrico nous emmène dans l'univers des créateurs. Imagé, il est parsemé d'excentriques qui se tiennent dans l'ombre, de gens qu'on dirait "à part".
Mr Gwynn, un écrivain à succès, décide qu'il arrête tout. Or, quelque temps après sa résignation, l'envie d'écrire lui reprend. Or que faire pour ne pas retourner en arrière? Sa réflexion et les événements le mèneront à devenir portraitiste... par écrit.
Le voilà qui se prépare. On voit apparaître un musicien dont les chiens ont des noms de pianistes, un concepteur d'ampoules dont les réalisations ont des noms de reines, un ex-accordeur de pianos devenu écrivain, un passionné de buanderies... puis commencent les portraits. Un premier nous sera raconté en détails, puis suivront une dizaine d'autres dont certains seront particulièrement marquants.
À certaines occasions, j'ai eu l'impression de revoir le Petit prince faisant le tour des planètes, cherchant sa rose. Ça peut paraître cliché, mais sous la plume de Barrico, ça ne l'est pas. Mr Gwynn cherche effectivement quelque chose. Libre à vous d'identifier le but de sa quête et de dire s'il parvient à son but, mais une chose est sure: le processus décrit est prodigieusement beau.
Ce livre, ce sont des décors, en fait, surtout un en particulier, qui devient lui-même un personnage. Les personnages "humains" sont autant de couleurs vives qui y évoluent avec parfois des scènes presque immobiles où une ampoule a le beau rôle, où l'amitié rattrape un misanthrope, où la beauté se découvre dans ce qui n'est pas beau, où la méchanceté émerge de ce qui a l'air innocent. Sans aucune longueur, Mr Gwynn nous mène d'une scène à l'autre dans un monde où rien n'est ordinaire, celui de la création, du désir de produire du beau... et ce sans ostentation. Vous dire comment c'est beau...
Barrico est le roi incontestable de la description des sens et de tout ce que leur exploitation soulève. C'est un fin clinicien qui sait aller chercher le détail essentiel sur lequel pointer votre microscope. Alors vous voyez quelque chose d'extraordinaire dans ce qui, vu de votre oeil à vous, parait pourtant anodin.
Mais aller à la recherche d'un idéal, du beau, de la bonté, a son prix à payer. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce livre s'appelle Mr Gwynn et non, Mr. Barrico. Autrement, j'ose croire qu'il y a beaucoup de l'auteur dans ce personnage principal.
Il me semble que chaque livre de Barrico surpasse l'autre. Déjà qu'il n'a jamais rien écrit de mauvais, imaginez juste ce que celui-là peut procurer. Certaines scènes sont belles à couper le souffle. Du beau, du bon, du grand Barrico.
dimanche 14 septembre 2014
Un an, par Jean Echenoz, éditions de Minuit
Ce livre le confirme: si un nouveau Échenoz sort, je ne peux m'empêcher de me le procurer. On pourrait donc croire que je sois biaisé lorsque j'en parle. Mais voilà, pour une première fois, j'ai un "mais". Sérieux.
C'est sans soute ce qu'on peut appeler une plaquette. Le livre ne fait pas cent pages. C'est l'histoire d'une déchéance, celle de Victoire, fille dans la vingtaine qui fuit une scène qu'elle craint qu'on lui reproche. Alors elle retire son argent (des francs, pas des euros...) et fuit Paris pour le Sud-Ouest.
C'est du Echenoz, alors un détail devient magnifique. En une page ou deux il décrira les sons d'une journée, dans un paragraphe, il vous dira tout ce qu'il pense de toute une société. En fait, avec cette fille somme toute banale dont la vie glisse lentement vers le bas, on dirait une sorte d'éloge à la simplicité, tant celle des gens que des choses. À moins qu'on y voit, à l'inverse, un grand doigt d'honneur à tout type de conformité. C'est ce que j'aime d'Echenoz: ces questions qui restent après sa lecture.
Mais il y a un "mais". Une relation existe entre le personnage principal et un autre, secondaire, qui revient tout au long du livre. C'est ambigu comme relation, on comprend plus ou moins jusqu'à ce que survienne le dénouement de cette relation, à la fin du livre. Je déteste avoir à dire que je l'ai vu venir, un peu comme si on m'avait "vendu le punch" avant la fin. Ce qui me fait constater que pour une première fois, on dirait qu'Echenoz a recouru à une "formule", quelque chose qui ne lui ressemble pas, enfin, qui ne ressemble pas à ces livres précédents. On parle ici d'un type de personnage qu'on voit parfois dans d'autres livres... Je n'en dis pas plus.
Bon, pas de panique, c'est pas mauvais pour autant. C'est juste... une petite aigreur. Ça se lit de bout en bout et bien ce Un an ne soit pas jojo, on sourit quand même souvent, pas tant des situations que des mots toujours si juste de ce grand auteur.
Si vous le connaissez: à lire absolument. Sinon, découvrez-le avec Les grandes blondes ou Ravel. C'est difficile,me semble-t-il, ne pas aimer Jean Echenoz.
C'est sans soute ce qu'on peut appeler une plaquette. Le livre ne fait pas cent pages. C'est l'histoire d'une déchéance, celle de Victoire, fille dans la vingtaine qui fuit une scène qu'elle craint qu'on lui reproche. Alors elle retire son argent (des francs, pas des euros...) et fuit Paris pour le Sud-Ouest.
C'est du Echenoz, alors un détail devient magnifique. En une page ou deux il décrira les sons d'une journée, dans un paragraphe, il vous dira tout ce qu'il pense de toute une société. En fait, avec cette fille somme toute banale dont la vie glisse lentement vers le bas, on dirait une sorte d'éloge à la simplicité, tant celle des gens que des choses. À moins qu'on y voit, à l'inverse, un grand doigt d'honneur à tout type de conformité. C'est ce que j'aime d'Echenoz: ces questions qui restent après sa lecture.
Mais il y a un "mais". Une relation existe entre le personnage principal et un autre, secondaire, qui revient tout au long du livre. C'est ambigu comme relation, on comprend plus ou moins jusqu'à ce que survienne le dénouement de cette relation, à la fin du livre. Je déteste avoir à dire que je l'ai vu venir, un peu comme si on m'avait "vendu le punch" avant la fin. Ce qui me fait constater que pour une première fois, on dirait qu'Echenoz a recouru à une "formule", quelque chose qui ne lui ressemble pas, enfin, qui ne ressemble pas à ces livres précédents. On parle ici d'un type de personnage qu'on voit parfois dans d'autres livres... Je n'en dis pas plus.
Bon, pas de panique, c'est pas mauvais pour autant. C'est juste... une petite aigreur. Ça se lit de bout en bout et bien ce Un an ne soit pas jojo, on sourit quand même souvent, pas tant des situations que des mots toujours si juste de ce grand auteur.
Si vous le connaissez: à lire absolument. Sinon, découvrez-le avec Les grandes blondes ou Ravel. C'est difficile,me semble-t-il, ne pas aimer Jean Echenoz.
jeudi 14 août 2014
Recommencements, par Hélène Dorion, éditions Druide
Je regarde la couverture de ce livre et je me dis encore qu'il s'agit presque d'un miracle que je me le sois procuré. En fait, c'est une entrevue avec Hélène Dorion entendue à la radio qui m'a donné envie de la lire. Autrement, oui bon, d'accord, c'est pas gentil de ne se fier qu'à la page couverture. Y faut pas, c'est superficiel, et tout, mais quand même... un oiseau sur une branche ma ramène inévitablement aux boutiques de choses parfumées dans les centres d'achat, ou à la réclame publicitaire d'une gourou tantrique quelconque... mais passons. Si l'habit ne fait pas le moine, la couverture n'est pas tout le livre. Fort heureusement.
Recommencements est un récit. Hélène Dorion y raconte (et là je dis ça très froidement) sa remise sur pied après deux deuils. Un premier, qui semble prétexte à ce recueil d'impressions, est celui suivant le décès de sa mère. Le second, qui semble a voir pris beaucoup d'importance, est la fin d'une relation.
Hélène Dorion n'écrit pas froidement. Pas du tout. Il y a beaucoup de chaleur dans ses mots et dans son récit, et ce en tous les sens du terme. Elle raconte son désarroi sans misérabilisme dans quelque chose qui ressemble à un atmosphère confortable. Pourtant, le sujet ne l'est pas. Certains décriront ça par une certaine "zenitude", d'autres, par une profonde réflexion. Pour ma part, j'y vois une certaine sagesse et de la poésie, pas tant dans sa façon d'écrire que dans celle de percevoir sa vie.
Pour se retrouver, l'auteur nous raconte des périples dans ses propriétés, une sur le bord d'un lac, l'autre, sur une île du sud. Bon, on n'est pas dans la grande misère économique, c'est certain. Ça pourrait en déranger certains, cette lassitude, comme un genre de naïveté qui ne lui fait pas vraiment prendre conscience des biens qui l'entourent, du fait qu'il lui est facile, pour des raisons que je ne saurais expliquer, de prendre quelques mois et de s'exiler sur une petite île là où passent parfois des ouragans. Mais si on passe par-dessus ça, on lit le parcours de quelqu'un qui traverse sa peine et s'en débarrasse en portant attention sur ce qui l'entoure: la beauté, le calme, la vie qui suit son cours. Dit comme ça, ça semble tout simple et oui, ça l'est, et en plus c'est bien écrit.
Je ne vis pas, présentement, l'émotion qui a poussé Hélène Dorion à écrire ce livre. Si j'expérimentais une peine ou un deuil, je crois que ce récit m'aurait fait du bien. Notez bien que je ne vois pas là une référence de quelque nature thérapeutique que ce soit. J'y vois seulement un regard sage et limpide sur des choses qui nous arrivent tous, raconté de belle façon.
Recommencements est à lire lentement. Ce n'est pas le genre de chose à vous tenir sur le bout de votre chaise, mais qui peut accompagner votre calme ou vous aider à le retrouver.
Recommencements est un récit. Hélène Dorion y raconte (et là je dis ça très froidement) sa remise sur pied après deux deuils. Un premier, qui semble prétexte à ce recueil d'impressions, est celui suivant le décès de sa mère. Le second, qui semble a voir pris beaucoup d'importance, est la fin d'une relation.
Hélène Dorion n'écrit pas froidement. Pas du tout. Il y a beaucoup de chaleur dans ses mots et dans son récit, et ce en tous les sens du terme. Elle raconte son désarroi sans misérabilisme dans quelque chose qui ressemble à un atmosphère confortable. Pourtant, le sujet ne l'est pas. Certains décriront ça par une certaine "zenitude", d'autres, par une profonde réflexion. Pour ma part, j'y vois une certaine sagesse et de la poésie, pas tant dans sa façon d'écrire que dans celle de percevoir sa vie.
Pour se retrouver, l'auteur nous raconte des périples dans ses propriétés, une sur le bord d'un lac, l'autre, sur une île du sud. Bon, on n'est pas dans la grande misère économique, c'est certain. Ça pourrait en déranger certains, cette lassitude, comme un genre de naïveté qui ne lui fait pas vraiment prendre conscience des biens qui l'entourent, du fait qu'il lui est facile, pour des raisons que je ne saurais expliquer, de prendre quelques mois et de s'exiler sur une petite île là où passent parfois des ouragans. Mais si on passe par-dessus ça, on lit le parcours de quelqu'un qui traverse sa peine et s'en débarrasse en portant attention sur ce qui l'entoure: la beauté, le calme, la vie qui suit son cours. Dit comme ça, ça semble tout simple et oui, ça l'est, et en plus c'est bien écrit.
Je ne vis pas, présentement, l'émotion qui a poussé Hélène Dorion à écrire ce livre. Si j'expérimentais une peine ou un deuil, je crois que ce récit m'aurait fait du bien. Notez bien que je ne vois pas là une référence de quelque nature thérapeutique que ce soit. J'y vois seulement un regard sage et limpide sur des choses qui nous arrivent tous, raconté de belle façon.
Recommencements est à lire lentement. Ce n'est pas le genre de chose à vous tenir sur le bout de votre chaise, mais qui peut accompagner votre calme ou vous aider à le retrouver.
lundi 28 juillet 2014
N'oublie pas s'il te plait, que je t'aime, par Gaétan Soucy, éditions Notabilia
Je crains toujours un peu les oeuvres posthumes. Elles comprennent généralement des textes inachevés complétés par d'autres auteurs. Ces complétions ont beau faire bonne figure, on se dit toujours que c'était pas X, Y ou Z et au bout du compte, si on n'est pas triste, on est déçu.
Ici, le texte principal est de Gaétan Soucy. Lorsqu'on me demande qui sont mes auteurs préférés, qu'importe le nombre, j'y glisse toujours Gaétan Soucy. Ses livres La petite fille qui aimait trop les allumettes et Music-Hall figurent parmi mes plus beaux plaisirs de lecture à vie. Soucy écrivait violemment, très crument, et avec une intelligence rare. Son décès rapide a eu le malheur de ne pas me surprendre. D'un auteur aussi fougueux, on s'attendait presque à une fin tragique, en ce que la mort l'a quand même emporté assez jeune (55 ans).
Son texte est une lettre. C'est celle écrite par un professeur de collège à son étudiante. Enfin c'est là une manière de voir le texte parce qu'il s'agit aussi de la lettre qu'un amoureux éconduit adresse à son ex-amante quelque six mois après leur rupture abrupte qui a suivi une relation courte mais forte et intense de quelques mois. Le prétexte de la lettre est une rencontre fortuite de quelques minutes des deux ex au sortir d'un autobus. L'auteur en est resté troublé, profondément tourmenté, et pour remettre de l'ordre dans ses pensées, il lui écrit, à elle, qu'il soupçonne être dans le même état que lui.
On dit que Soucy n'a pas pu terminer la réponse de la jeune fille. Aussi ne fait-elle que deux pages et nous laisse-t-elle un peu sur notre faim. Or, l'éditeur a eu l'idée d'offrir à quatre auteurs, deux hommes et deux femmes, de rédiger la réponse en question, selon leur interprétation propre de la missive de l'auteur. Comme continuation d'oeuvre inachevée il s'agit, à mon sens, d'une brillante idée. Chacun des quatre textes de réponse possède bien sur une style qui lui est propre, mais l'ensemble m'a surpris pour une chose: tous vont dans la même direction. Si le ton diffère, la fin, sans différer totalement d'un texte à l'autre, mène à chaque fois à la même constatation. Je ne sais trop si l'éditeur avait prévu ça, mais on se dit à la fin du livre qu'on aurait quand même aimé qu'un d'eux aille dans la direction opposée, que je n'identifierai pas ici, parce que ces textes, comme celui de Soucy, sont excellents.
Je ne saurais dire que je ne connais rien aux mots d'amour. Lorsqu'on lit beaucoup, on en croise souvent, bien souvent à notre insu, qui partent dans toutes les directions. Ceux de Soucy n'ont rien de mièvre. Je les dirais très "caractériels". Peut-être, ai-je lu, cette lettre est-il inspirée d'un fait véritablement vécu par lui. C'est sans doute vrai parce que ses mots n'ont rien d'inventé. Tous, autant que nous sommes, n'avons pas nécessairement écrit une telle lettre d'amour ou de rupture un jour, mais à tout le moins en avons-nous élaboré une dans notre tête, ou un discours, à un certain moment donné. On se souvient de sa portée, de la force du sentiment qui nous habitait à ce moment, tellement que d'y penser même longtemps après nous chavire encore un peu. Tel est le cas avec ce texte de Soucy. C'est sincère et le propos va droit au but. Maintenant, a-t-il plu, a-t-il blessé ou est-il tombé dans l'indifférence? À vous de voir, comme l'ont fait Sylvain Trudel, Catherine Mavrikakis, Pierre Jourde et Suzanne Côté-Martin.
J'avoue un faible pour la réponse de Catherine Mavrikakis, pour la construction du personnage qu'il y a dans ces quelques pages. Mais attention, les autres réponses aussi valent la peine. À vous de vous identifier à celle de votre choix.
N'oublie pas s'il-te-plait... est un genre de coup de poing ludique qui pourrait, je l'espère, donner le goût de lire Gaétan Soucy. Si vous souhaitez le découvrir, commencez par La petite fille qui aimait trop les allumettes. Vous en ressortirez tout aussi sonné, sinon plus.
Merci, Gaétan Soucy. Mission accomplie.
Ici, le texte principal est de Gaétan Soucy. Lorsqu'on me demande qui sont mes auteurs préférés, qu'importe le nombre, j'y glisse toujours Gaétan Soucy. Ses livres La petite fille qui aimait trop les allumettes et Music-Hall figurent parmi mes plus beaux plaisirs de lecture à vie. Soucy écrivait violemment, très crument, et avec une intelligence rare. Son décès rapide a eu le malheur de ne pas me surprendre. D'un auteur aussi fougueux, on s'attendait presque à une fin tragique, en ce que la mort l'a quand même emporté assez jeune (55 ans).
Son texte est une lettre. C'est celle écrite par un professeur de collège à son étudiante. Enfin c'est là une manière de voir le texte parce qu'il s'agit aussi de la lettre qu'un amoureux éconduit adresse à son ex-amante quelque six mois après leur rupture abrupte qui a suivi une relation courte mais forte et intense de quelques mois. Le prétexte de la lettre est une rencontre fortuite de quelques minutes des deux ex au sortir d'un autobus. L'auteur en est resté troublé, profondément tourmenté, et pour remettre de l'ordre dans ses pensées, il lui écrit, à elle, qu'il soupçonne être dans le même état que lui.
On dit que Soucy n'a pas pu terminer la réponse de la jeune fille. Aussi ne fait-elle que deux pages et nous laisse-t-elle un peu sur notre faim. Or, l'éditeur a eu l'idée d'offrir à quatre auteurs, deux hommes et deux femmes, de rédiger la réponse en question, selon leur interprétation propre de la missive de l'auteur. Comme continuation d'oeuvre inachevée il s'agit, à mon sens, d'une brillante idée. Chacun des quatre textes de réponse possède bien sur une style qui lui est propre, mais l'ensemble m'a surpris pour une chose: tous vont dans la même direction. Si le ton diffère, la fin, sans différer totalement d'un texte à l'autre, mène à chaque fois à la même constatation. Je ne sais trop si l'éditeur avait prévu ça, mais on se dit à la fin du livre qu'on aurait quand même aimé qu'un d'eux aille dans la direction opposée, que je n'identifierai pas ici, parce que ces textes, comme celui de Soucy, sont excellents.
Je ne saurais dire que je ne connais rien aux mots d'amour. Lorsqu'on lit beaucoup, on en croise souvent, bien souvent à notre insu, qui partent dans toutes les directions. Ceux de Soucy n'ont rien de mièvre. Je les dirais très "caractériels". Peut-être, ai-je lu, cette lettre est-il inspirée d'un fait véritablement vécu par lui. C'est sans doute vrai parce que ses mots n'ont rien d'inventé. Tous, autant que nous sommes, n'avons pas nécessairement écrit une telle lettre d'amour ou de rupture un jour, mais à tout le moins en avons-nous élaboré une dans notre tête, ou un discours, à un certain moment donné. On se souvient de sa portée, de la force du sentiment qui nous habitait à ce moment, tellement que d'y penser même longtemps après nous chavire encore un peu. Tel est le cas avec ce texte de Soucy. C'est sincère et le propos va droit au but. Maintenant, a-t-il plu, a-t-il blessé ou est-il tombé dans l'indifférence? À vous de voir, comme l'ont fait Sylvain Trudel, Catherine Mavrikakis, Pierre Jourde et Suzanne Côté-Martin.
J'avoue un faible pour la réponse de Catherine Mavrikakis, pour la construction du personnage qu'il y a dans ces quelques pages. Mais attention, les autres réponses aussi valent la peine. À vous de vous identifier à celle de votre choix.
N'oublie pas s'il-te-plait... est un genre de coup de poing ludique qui pourrait, je l'espère, donner le goût de lire Gaétan Soucy. Si vous souhaitez le découvrir, commencez par La petite fille qui aimait trop les allumettes. Vous en ressortirez tout aussi sonné, sinon plus.
Merci, Gaétan Soucy. Mission accomplie.
dimanche 20 juillet 2014
Les États-Unis du vent, par Daniel Canty, éditions la Peuplade
Ce livre raconte un road trip porté par le vent. Aux États-Unis, un groupe d'amis parcoure les routes secondaires américaines à bord d'un motorisé vaguement modifié, vaguement vintage. Le rêve américain est parfait, le road trip aussi. Personnellement, parmi mes rêves les plus fous, il me semble que de partir avec le vent représente la quintessence de la liberté. C'est ce que raconte Daniel Canty, un auteur québécois. En fait, il s'agit du récit de sa portion du périple, vécue avec le chauffeur, le seul permanent du voyage. Venu prendre le relais d'un autre à Cincinnati, l'auteur roulera jusqu'à Harrisburgh, Pennsylvanie, via Indianapolis, Chicago, Cleveland et d'autres localités encore plus distinctives.
Daniel Canty raconte donc son périple. Il s'agit d'un récit, pas d'un roman, ni non plus d'un carnet de voyage. Ce qu'il raconte, ce sont les gens, les paysages, mais aussi un autre fil que celui des événements. En fait, à force d'avancer sur les routes rendues froides par le mois de décembre en sol américain, on dirait que la fatigue s'installe. Aussi, l'auteur, un peu comme son véhicule, dérive. Ici il partira vers un film, là, sur une note historique, et là encore sur une impression personnelle basée sur cette époque de sa vie.
Si le récit est épique géographiquement, sur une note personnelle, il devient parfois un peu difficile. J'ai eu à relire certains passages par deux fois. Pas que ce soit mal écrit, non, pas du tout. C'est juste que je perdais parfois un peu le fil, justement. Entre deux divagations, il m'est parfois difficilement arrivé de faire un lien. Mais c'est là tout l'exercice de ce livre, aussi poétique que descriptif. Ça déstabilise un peu.
Les États-unis du vent est un livre qui se lit autrement, sans doute, que de la façon dont je l'ai lu. Je l'ai fait lentement, page par page. Peut-être m'aurait-il fallu l'avaler tout rond, comme ses personnages l'ont fait avec les kilomètres. Reste que mon plaisir a été encyclopédique. Dans tout ce que Canty offre, c'est l'aspect atlas et le niveau descriptif que j'ai préférés. Jamais n'aie-je eu l'occasion avant, qu'on me parle de Gary, Indiana ou d'Ekhart en Ohio. Découvrir ce monde autrement que par la forme romanesque me donnait une agréable impression de carte postale parlée.
Parfois ardu, jouissif à d'autres occasions, ce livre ne m'a déçu que pour l'utilisation d'un bon vieux cliché que je n'avais pas rencontré depuis un petit bout: écrire des bouts de texte en anglais. Bien sur, le récit se passe aux USA. Oui, je lis l'anglais, oui, j'ai tout compris. Mais tel n'aurais pas été le cas si le voyage en question avait été fait en Russie, par exemple. Ici comme souvent, l'utilisation de l'anglais m'a semblé esthétique... et un peu convenue, d'où le cliché. Dommage. Autrement, pour le plaisir de partir sur les routes en lisant, ces États-Unis du vent sont une destination toute indiquée.
Daniel Canty raconte donc son périple. Il s'agit d'un récit, pas d'un roman, ni non plus d'un carnet de voyage. Ce qu'il raconte, ce sont les gens, les paysages, mais aussi un autre fil que celui des événements. En fait, à force d'avancer sur les routes rendues froides par le mois de décembre en sol américain, on dirait que la fatigue s'installe. Aussi, l'auteur, un peu comme son véhicule, dérive. Ici il partira vers un film, là, sur une note historique, et là encore sur une impression personnelle basée sur cette époque de sa vie.
Si le récit est épique géographiquement, sur une note personnelle, il devient parfois un peu difficile. J'ai eu à relire certains passages par deux fois. Pas que ce soit mal écrit, non, pas du tout. C'est juste que je perdais parfois un peu le fil, justement. Entre deux divagations, il m'est parfois difficilement arrivé de faire un lien. Mais c'est là tout l'exercice de ce livre, aussi poétique que descriptif. Ça déstabilise un peu.
Les États-unis du vent est un livre qui se lit autrement, sans doute, que de la façon dont je l'ai lu. Je l'ai fait lentement, page par page. Peut-être m'aurait-il fallu l'avaler tout rond, comme ses personnages l'ont fait avec les kilomètres. Reste que mon plaisir a été encyclopédique. Dans tout ce que Canty offre, c'est l'aspect atlas et le niveau descriptif que j'ai préférés. Jamais n'aie-je eu l'occasion avant, qu'on me parle de Gary, Indiana ou d'Ekhart en Ohio. Découvrir ce monde autrement que par la forme romanesque me donnait une agréable impression de carte postale parlée.
Parfois ardu, jouissif à d'autres occasions, ce livre ne m'a déçu que pour l'utilisation d'un bon vieux cliché que je n'avais pas rencontré depuis un petit bout: écrire des bouts de texte en anglais. Bien sur, le récit se passe aux USA. Oui, je lis l'anglais, oui, j'ai tout compris. Mais tel n'aurais pas été le cas si le voyage en question avait été fait en Russie, par exemple. Ici comme souvent, l'utilisation de l'anglais m'a semblé esthétique... et un peu convenue, d'où le cliché. Dommage. Autrement, pour le plaisir de partir sur les routes en lisant, ces États-Unis du vent sont une destination toute indiquée.
mercredi 2 juillet 2014
L'Exception, par Audur Ava Olafsdorttir, éditions Zulma
C'est mon troisième d'elle. J'étais heureux de la trouver en librairie à nouveau. Rosa Candida restera un classique et L'Embellie un beau retour. Cette fois, pas que c'est pas bien, mais...
Une femme, mère de deux jumeaux de deux ans et demi, se fait plaquer par son mari qui sort du placard. Celui-ci va vivre avec un collègue de travail de longue date. L'héroïne (puisque c'est beaucoup plus d'elle que de lui dont il est question) n'a rien vu venir. On les disait "couple idéal", ils étaient frais et beaux... Elle ne comprend pas.
Dans les livres d'Audur Ava, il y a toujours une femme avec un ou des jeunes enfants. Dans chacun de ses livres, la femme part, à un certain moment, avec les enfants à la recherche d'elle même. On dirait que le thème préféré de l'auteur est la retombée sur Terre de femmes utopistes. Pas que ce soit un mauvais thème, non, mais de le voir revenir dans ce nouveau roman m'a un peu déçu.
Dans L'Exception, le personnage principal est accompagné d'un autre personnage dans sa démarche, dans son retour sur Terre. En fait, ça me fait penser que le même pattern survenait aussi aux personnages principaux des deux ouvrages précédents d'Audur Ava. Ici, c'est une voisine mi-écrivaine mi-psychologue qui reçoit les confidences et qui prodigue les conseils. Particularité de l'auteur, la voisine en question est naine, donc, on fait vite un lien vers quelque chose comme un genre de petit troll équivalent d'une voix intérieure. C'est sympa, un peu ironique et très islandais. Toute psychologue et analyste qu'elle est, cette dame se permet des réflexions sur à peu près tout et rien, philosophant sur les relations de couple et le mariage. En fait, on dirait que l'auteur lui fait dire ce qu'elle ne voulait pas mettre dans la bouche de son personnage principal, gardant à cette dernière un lustre et un éclat au moins équivalent aux personnages principaux de ses livres précédents. Or, pour toutes ces raisons, la voisine en question a fini que par me taper sur les nerfs. Déstabilisant, lorsqu'on connaît l'univers de cette auteur islandaise où tous sont quand même gentils, perturbés, mais gentils. Pas que les gens ne sont pas gentils dans L'Exception mais... peut-être le sont-ils trop, au bout du compte?
Une femme, mère de deux jumeaux de deux ans et demi, se fait plaquer par son mari qui sort du placard. Celui-ci va vivre avec un collègue de travail de longue date. L'héroïne (puisque c'est beaucoup plus d'elle que de lui dont il est question) n'a rien vu venir. On les disait "couple idéal", ils étaient frais et beaux... Elle ne comprend pas.
Dans les livres d'Audur Ava, il y a toujours une femme avec un ou des jeunes enfants. Dans chacun de ses livres, la femme part, à un certain moment, avec les enfants à la recherche d'elle même. On dirait que le thème préféré de l'auteur est la retombée sur Terre de femmes utopistes. Pas que ce soit un mauvais thème, non, mais de le voir revenir dans ce nouveau roman m'a un peu déçu.
Dans L'Exception, le personnage principal est accompagné d'un autre personnage dans sa démarche, dans son retour sur Terre. En fait, ça me fait penser que le même pattern survenait aussi aux personnages principaux des deux ouvrages précédents d'Audur Ava. Ici, c'est une voisine mi-écrivaine mi-psychologue qui reçoit les confidences et qui prodigue les conseils. Particularité de l'auteur, la voisine en question est naine, donc, on fait vite un lien vers quelque chose comme un genre de petit troll équivalent d'une voix intérieure. C'est sympa, un peu ironique et très islandais. Toute psychologue et analyste qu'elle est, cette dame se permet des réflexions sur à peu près tout et rien, philosophant sur les relations de couple et le mariage. En fait, on dirait que l'auteur lui fait dire ce qu'elle ne voulait pas mettre dans la bouche de son personnage principal, gardant à cette dernière un lustre et un éclat au moins équivalent aux personnages principaux de ses livres précédents. Or, pour toutes ces raisons, la voisine en question a fini que par me taper sur les nerfs. Déstabilisant, lorsqu'on connaît l'univers de cette auteur islandaise où tous sont quand même gentils, perturbés, mais gentils. Pas que les gens ne sont pas gentils dans L'Exception mais... peut-être le sont-ils trop, au bout du compte?
 Dans son questionnement sur la fin de sa relation, l'héroïne en vient à découvrir, au fil de ses souvenirs, que son mari s'absentait souvent pour x, y ou z raisons et à force, elle se rend bien compte qu'elle s'est fait jouer très, mais alors là très naïvement. On croyait que l'auteur avait donné le mauvais rôle au marin, mais à force, on se rend compte que l'héroïne a sa part de responsabilités. Là, on aurait pu la prendre pour une pauvre fille, mais la force d'Audur Ava est justement de faire aimer des personnages qui n'ont rien d'extraordinaire. On aime cette fille, oui, mais au final, J'étais quand même content qu'elle se reprenne en main et nous lâche avec ses réflexions... En parallèle à tout ça, il y a aussi l'histoire de son père naturel qui veut la rencontrer au bout d'Une trentaine d'années dans l'ombre. Et sa mère, qui, elle aussi, lui a peut-être caché des choses...
Dans son questionnement sur la fin de sa relation, l'héroïne en vient à découvrir, au fil de ses souvenirs, que son mari s'absentait souvent pour x, y ou z raisons et à force, elle se rend bien compte qu'elle s'est fait jouer très, mais alors là très naïvement. On croyait que l'auteur avait donné le mauvais rôle au marin, mais à force, on se rend compte que l'héroïne a sa part de responsabilités. Là, on aurait pu la prendre pour une pauvre fille, mais la force d'Audur Ava est justement de faire aimer des personnages qui n'ont rien d'extraordinaire. On aime cette fille, oui, mais au final, J'étais quand même content qu'elle se reprenne en main et nous lâche avec ses réflexions... En parallèle à tout ça, il y a aussi l'histoire de son père naturel qui veut la rencontrer au bout d'Une trentaine d'années dans l'ombre. Et sa mère, qui, elle aussi, lui a peut-être caché des choses... Pas mauvais mais pas nouveau, l'Exception porte malheureusement bien mal son nom. Audur Ava Olafsdottir demeure, à mon sens une excellente auteure, mais encore un livre avec le même type de personnages et je risque de décrocher.
samedi 14 juin 2014
En finir avec Eddy Bellegueule, par Edouard Louis, éditions du Seuil
Y'a de ces livres dans lesquels on entre à reculons, mal à l'aise, avec une impression d'aller à une soirée où on n'avait absolument pas envie d'aller. C'était ça avec Édouard Louis. Ce que j'en entendais dire ne me laissais pas indifférent, mais je craignais comme la peste le misérabilisme, sentiment que j'abhorre par dessus tout.
J'ai aussi eu peur d'un autre Nelly Arcand. J'avoue que Putain est un des rares livres que que j'ai dû abandonner avant la fin. Ce cri m'exaspérait, cette écriture me rendait hors de moi. Vu de l'extérieur, l'histoire d'Eddy Bellegueule ressemblait à ça. Or, j'ai lu la quatrième de couverture... c'est rare qu'un livre m'attrape par là.
D'entrée de jeu, l'auteur dit ne pas se souvenir d'avoir été heureux dans son enfance. Bon. Puis, l'auteur met la table en expliquant très clairement que d'autant qu'il se souvienne, il a toujours été freluquet, délicat, et il faut bien l'admettre: effeminé. Et ce même enfant. Une des premières scènes raconte un crachat reçu en pleine face à l'école. Bien sur, on fait tout de suite le lien avec l'intimidation qui fait rage dans tout bon établissement scolaire, mais attention, c'est loin d'être tout. D'origine franco-française, vivant dans un village du nord de la France, le gars raconte ses parents, sa famille et son monde, son village. Si à l'école la violence est physique, à la maison elle est verbale. Rapidement, ce garçon se rend compte que ce qu'il est, sa nature même, ne répond aux standards de personne, et le drame réside dans le fait que tout ça se passe il y a une dizaine d'années, au début de ce siècle. C'est à vous jeter par terre.
Rien, dans cet environnement où la vie est difficile, où le niveau de vie est bas, où les plaisirs sont rares, n'encourage à la différence. Personne, dans un tel monde, n'est fier de ce qu'il est ni de ce vers quoi il tend. Il y est à peu près impossible de s'y valoriser. Alors s'il vient à passer quelqu'un de plus faible que soi, le côté animal prend le dessus, et tant pis pour le respect, fut-il question d'un voisin, d'un frère ou même de son propre enfant.
Édouard raconte son enfance froidement, aussi durement qu'il l'a vécue. Il n'épargne personne. On pourrait croire à un règlement de comptes, mais pourtant pas, et c'est là où le livre surprend et où il m'a capté. C'est qu'il s'agit plutôt du regard lucide, voir extra-lucide, d'un personnage mis de côté sur la société actuelle. En racontant tout le monde, Édouard Louis nous fait nous rendre compte que tous, dans ce village, sont des victimes. Ils le sont tous autant que lui. On y quitte l'école le plus tôt possible pour aussitôt entrer à l'usine. On y fait tout aussi tôt des enfants rapidement laissés pour compte et toujours, partout, on écoute la télé.
La lecture de ce livre n'a rien de joyeux. Toutes les anecdotes racontées vous retournent les sens et pourtant, il y a quelque chose qu'on comprend. Pour peu qu'on ait subi les affres de ses pairs à l'enfance ou qu'on ait eu connaissance de celles de nos parents, on comprend que ceux pour qui un tel livre pourrait constituer un miroir n'entreront probablement jamais en contact avec un tel objet: un livre. Pourquoi? À vous de tirer vos conclusions. Quant à moi, je refuse de dire que ce pan de la société n'est constitué que de gros cons. Absolument pas. Mais je constate toutefois que si la Société est sensé avancer, le mouvement ne se fait pas en même temps pour tous. Pourquoi tant de haine? Pourquoi ne valorise-t-on pas l'éducation? Ce livre laisse en suspens bien des questions.
Comme vous voyez, En finir avec... ne laisse pas indifférent. Bien écrit, il se lit aussi bien qu'une rubrique de potins dans un journal. Parce que c'est de ça dont il s'agit, mais les aventures ici racontées dans le détail ne sont pas celles des pipeuls, mais bien de leurs contraires. Or un tel livre est essentiel parce qu'une telle voix est de celles qui dénoncent les guerres. son premier livre est de l'anti-fantasy, ses personnages, le contraire des licornes. Édouard Louis n'a pas fini de faire parler de lui, et c'est tant mieux. Je me fait un devoir de le recommander et d'en parler.
À lire absolument parce que marquant, mais coeurs sensibles et porteurs de lunettes roses, s'abstenir.
J'ai aussi eu peur d'un autre Nelly Arcand. J'avoue que Putain est un des rares livres que que j'ai dû abandonner avant la fin. Ce cri m'exaspérait, cette écriture me rendait hors de moi. Vu de l'extérieur, l'histoire d'Eddy Bellegueule ressemblait à ça. Or, j'ai lu la quatrième de couverture... c'est rare qu'un livre m'attrape par là.
D'entrée de jeu, l'auteur dit ne pas se souvenir d'avoir été heureux dans son enfance. Bon. Puis, l'auteur met la table en expliquant très clairement que d'autant qu'il se souvienne, il a toujours été freluquet, délicat, et il faut bien l'admettre: effeminé. Et ce même enfant. Une des premières scènes raconte un crachat reçu en pleine face à l'école. Bien sur, on fait tout de suite le lien avec l'intimidation qui fait rage dans tout bon établissement scolaire, mais attention, c'est loin d'être tout. D'origine franco-française, vivant dans un village du nord de la France, le gars raconte ses parents, sa famille et son monde, son village. Si à l'école la violence est physique, à la maison elle est verbale. Rapidement, ce garçon se rend compte que ce qu'il est, sa nature même, ne répond aux standards de personne, et le drame réside dans le fait que tout ça se passe il y a une dizaine d'années, au début de ce siècle. C'est à vous jeter par terre.
Rien, dans cet environnement où la vie est difficile, où le niveau de vie est bas, où les plaisirs sont rares, n'encourage à la différence. Personne, dans un tel monde, n'est fier de ce qu'il est ni de ce vers quoi il tend. Il y est à peu près impossible de s'y valoriser. Alors s'il vient à passer quelqu'un de plus faible que soi, le côté animal prend le dessus, et tant pis pour le respect, fut-il question d'un voisin, d'un frère ou même de son propre enfant.
Édouard raconte son enfance froidement, aussi durement qu'il l'a vécue. Il n'épargne personne. On pourrait croire à un règlement de comptes, mais pourtant pas, et c'est là où le livre surprend et où il m'a capté. C'est qu'il s'agit plutôt du regard lucide, voir extra-lucide, d'un personnage mis de côté sur la société actuelle. En racontant tout le monde, Édouard Louis nous fait nous rendre compte que tous, dans ce village, sont des victimes. Ils le sont tous autant que lui. On y quitte l'école le plus tôt possible pour aussitôt entrer à l'usine. On y fait tout aussi tôt des enfants rapidement laissés pour compte et toujours, partout, on écoute la télé.
La lecture de ce livre n'a rien de joyeux. Toutes les anecdotes racontées vous retournent les sens et pourtant, il y a quelque chose qu'on comprend. Pour peu qu'on ait subi les affres de ses pairs à l'enfance ou qu'on ait eu connaissance de celles de nos parents, on comprend que ceux pour qui un tel livre pourrait constituer un miroir n'entreront probablement jamais en contact avec un tel objet: un livre. Pourquoi? À vous de tirer vos conclusions. Quant à moi, je refuse de dire que ce pan de la société n'est constitué que de gros cons. Absolument pas. Mais je constate toutefois que si la Société est sensé avancer, le mouvement ne se fait pas en même temps pour tous. Pourquoi tant de haine? Pourquoi ne valorise-t-on pas l'éducation? Ce livre laisse en suspens bien des questions.
Comme vous voyez, En finir avec... ne laisse pas indifférent. Bien écrit, il se lit aussi bien qu'une rubrique de potins dans un journal. Parce que c'est de ça dont il s'agit, mais les aventures ici racontées dans le détail ne sont pas celles des pipeuls, mais bien de leurs contraires. Or un tel livre est essentiel parce qu'une telle voix est de celles qui dénoncent les guerres. son premier livre est de l'anti-fantasy, ses personnages, le contraire des licornes. Édouard Louis n'a pas fini de faire parler de lui, et c'est tant mieux. Je me fait un devoir de le recommander et d'en parler.
À lire absolument parce que marquant, mais coeurs sensibles et porteurs de lunettes roses, s'abstenir.
dimanche 8 juin 2014
Trois vies de saints, par Eduardo Mendoza, éditions du Seuil
Il y a peu d'auteurs dont j'achète les bouquins sans même consulter la quatrième de couverture. Mendoza est un de ceux-là. Pas qu'il ne m'ait toujours réjoui, par contre. N'en demeure pas moins qu'il m'a toujours diverti. Mendoza est un de ces auteurs qui sache toucher plusieurs genres. Du polar loufoque aux sagas historiques grandioses, le voici qui donne maintenant dans la nouvelle.
Comme le titre l'indique, Trois vies... raconte l'histoire de trois personnages. Quant à savoir s'il s'agit ou pas de saints, c'est là tout Mendoza. Sa définition de la sainteté est assurément bien personnelle et empreinte d'ironie. Mais si l'on considère les saints comme des modèles (à suivre ou pas), je considère qu'il a frappé dans le mille. Les trois ont ce petit quelque chose qui fait avancer les société dans lesquelles ils se retrouvent.
En premier lieu, on retrouve un évêque sud-américain condamné, bien malgré lui, à rester à Barcelone où il ne devait rester que le temps d'un court séjour officiel. Un des intérêts de cette nouvelle est que l'auteur la raconte au "je". En même temps de celle de l'évêque étranger, il raconte l'histoire de sa jeunesse, ou à tout le moins de son environnement familial. Si l'histoire prend des tournures rocambolesques, son propos est parfois dur, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents, avec lequel le narrateur a le mérite de de ne pas en parler de manière hypocrite. Aussi vrai qu'on puisse être parfois très durs envers ses parents, Mendoza l'est ici à la puissance dix, d'autant plus que le personnage raconté à travers eux, soit celui de l'évêque en question, est lui-même un bonhomme fort parce que libre, et donc plutôt incompris par des parents plutôt obtus. L'évêque saura nager habilement à travers les jugements et les inclinaisons que les sociétés civile et religieuse auraient voulu qu'il prenne. Peut-être aura-t-il fait partie de quelque chose de grand... Mendoza vous fait vous le demander.
La seconde nouvelle m'a laissé dubitatif. Le personnage principal, apprenant qu'une maladie l'emportera d'ici une période de temps bien définie, se retrouve dans une situation où la possibilité lui est donnée d'exprimer son avis sur la vie, la société et tutti quanti devant un parquet trié sur le volet. On assiste à sa lente dérive en se demandant s'il feint la folie ou si c'est cette dernière qui s'empare de lui peu à peu. Aussi complexe que les pensées de son personnage principal, cette nouvelle m'a un peu perdu. J'ai cru en saisir un propos très critique, mais je n'ai pas été touché pour autant.
La dernière est ma préférée. Un petit truand de rien découvre la littérature en prison par l'entremise d'une enseignante plutôt désoeuvrée. Ce qui ne ressemblait à rien au départ prendra des proportions incroyables que les deux protagonistes vivront séparément mais intensément chacun de leur côté. Dans cette nouvelle il est clair que Mendoza prend la parole pour donner son interprétation à lui de ce qu'est la littérature, mais aussi de ce qui l'entoure, des perceptions qu'on peut en avoir et de l'utilisation, médiatique ou pas, qu'on peut en faire. Juste pour un Mendoza qui se met dans la peau d'un ancien moins que rien, la nouvelle vaut le détour... et nous fait réaliser qu'il y a peut-être des connections avec l'histoire où il raconte sa famille...
Rien d'hilarant, rien de renversant, mais un bon divertissement. Ceux qui comme moi auront été déçus par quelques uns de ses derniers livres retrouveront un Mendoza qu'on aimerait pouvoir lire plus souvent. Ces histoires sont plus personnelles, et c'est tant mieux. Soulignons enfin l'excellente traduction de François Maspero qui fait très certainement partie du succès que Mendoza puisse avoir avec le public francophone.
Comme le titre l'indique, Trois vies... raconte l'histoire de trois personnages. Quant à savoir s'il s'agit ou pas de saints, c'est là tout Mendoza. Sa définition de la sainteté est assurément bien personnelle et empreinte d'ironie. Mais si l'on considère les saints comme des modèles (à suivre ou pas), je considère qu'il a frappé dans le mille. Les trois ont ce petit quelque chose qui fait avancer les société dans lesquelles ils se retrouvent.
En premier lieu, on retrouve un évêque sud-américain condamné, bien malgré lui, à rester à Barcelone où il ne devait rester que le temps d'un court séjour officiel. Un des intérêts de cette nouvelle est que l'auteur la raconte au "je". En même temps de celle de l'évêque étranger, il raconte l'histoire de sa jeunesse, ou à tout le moins de son environnement familial. Si l'histoire prend des tournures rocambolesques, son propos est parfois dur, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents, avec lequel le narrateur a le mérite de de ne pas en parler de manière hypocrite. Aussi vrai qu'on puisse être parfois très durs envers ses parents, Mendoza l'est ici à la puissance dix, d'autant plus que le personnage raconté à travers eux, soit celui de l'évêque en question, est lui-même un bonhomme fort parce que libre, et donc plutôt incompris par des parents plutôt obtus. L'évêque saura nager habilement à travers les jugements et les inclinaisons que les sociétés civile et religieuse auraient voulu qu'il prenne. Peut-être aura-t-il fait partie de quelque chose de grand... Mendoza vous fait vous le demander.
La seconde nouvelle m'a laissé dubitatif. Le personnage principal, apprenant qu'une maladie l'emportera d'ici une période de temps bien définie, se retrouve dans une situation où la possibilité lui est donnée d'exprimer son avis sur la vie, la société et tutti quanti devant un parquet trié sur le volet. On assiste à sa lente dérive en se demandant s'il feint la folie ou si c'est cette dernière qui s'empare de lui peu à peu. Aussi complexe que les pensées de son personnage principal, cette nouvelle m'a un peu perdu. J'ai cru en saisir un propos très critique, mais je n'ai pas été touché pour autant.
La dernière est ma préférée. Un petit truand de rien découvre la littérature en prison par l'entremise d'une enseignante plutôt désoeuvrée. Ce qui ne ressemblait à rien au départ prendra des proportions incroyables que les deux protagonistes vivront séparément mais intensément chacun de leur côté. Dans cette nouvelle il est clair que Mendoza prend la parole pour donner son interprétation à lui de ce qu'est la littérature, mais aussi de ce qui l'entoure, des perceptions qu'on peut en avoir et de l'utilisation, médiatique ou pas, qu'on peut en faire. Juste pour un Mendoza qui se met dans la peau d'un ancien moins que rien, la nouvelle vaut le détour... et nous fait réaliser qu'il y a peut-être des connections avec l'histoire où il raconte sa famille...
Rien d'hilarant, rien de renversant, mais un bon divertissement. Ceux qui comme moi auront été déçus par quelques uns de ses derniers livres retrouveront un Mendoza qu'on aimerait pouvoir lire plus souvent. Ces histoires sont plus personnelles, et c'est tant mieux. Soulignons enfin l'excellente traduction de François Maspero qui fait très certainement partie du succès que Mendoza puisse avoir avec le public francophone.
lundi 2 juin 2014
La véranda aveugle, par Herbjorg Wassmo, éditions Babel
Il m'arrive rarement de lire des ouvrages parus il y a longtemps. Celui-là est du début des années 80. Écrit par une auteure qu'on décrit comme un des plus grands écrivains norvégiens, c'est le premier d'une trilogie. Je lirai les autres, c'est certain.
Ça se passe quelques années après la Deuxième guerre. On présume qu'on est environ 13 ou 14 ans après cette époque puisque le personnage principale, Tora, est une adolescente née alors que les Allemands occupaient le territoire. Son père était Allemand, et sa mère en a subi les affres. Après la disparition de celui qui fut son amant, elle s'est mis en ménage avec un Norvégien, Henrick.
Il s'agit en fait de l'histoire d'n petit village côtier du nord de la Norvège. Tous triment dur. L'emploi est saisonnier. La mère de Tora ne l'a pas facile, victime non seulement de l'économie, mais aussi de l'opinion qu'ont d'elle les omniprésents habitants du village, et aussi de son nouvel époux, un être sordide, défait, bileux. Or ces personnages habitent une grande maison bourgeoise reconvertie en maison à appartements. Ça a beau être un village, il y a là une promiscuité vraiment particulière, qui apporte autant le réconfort que l'étouffement. Une famille de sept enfants, un célibataire enfermé dans le grenier, Tora, sa mère et son beau-père, et le village.
À plusieurs occasions, j'ai eu l'agréable impression de découvrir un équivalent de l'oeuvre de Michel Tremblay des premiers temps. Non, il ne s'agit pas des Chroniques du Plateau Mont-Royal puisque l'environnement n'est pas pas urbain. Mais il s'agit plutôt de la genèse de quelque chose. On sent que ces personnages iront loin, qu'ils ont un potentiel à se mêler les uns aux autres, mais surtout, immense surprise, on retrouve souvent des dialogues qu'on devine adaptés d'une langue pas nécessairement littéraire. L'auteur, par le biais d'une excellente traduction, donne la parole à ses personnages dans une langue un peu châtiée, raccourcie par plusieurs apostrophes. On sent donc un langage "populaire", pour certains personnages, ce qui donne le ton. Il y a les mieux et les moins bien nantis. Il y a aussi une considération de l'éducation comme investissement dans l'avenir, une certaine considération des étrangers, aussi, et ce qu'ils apportent comme espoir et comme peur. Bref, c'est l'histoire du début d'une nouvelle ère. On voit dans quelle fange tout ça est planté et on souhaite le meilleur à chacun. Or, tel n'est pas le cas pour tous. Pas urbain, mais très dense, La véranda..., bien que norvégien, diffère de la littérature islandaise. C'est ici moins poétique, moins descriptif, plus sec. Aussi les scènes les plus cruelles font-elles plus mal encore. Mais il y a là dedans un espoir flagrant, porté en majeure partie par les femmes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien hâte de voir ce qui arrivera à la plupart de celles-ci, beaucoup plus qu'aux hommes, souvent relégués à des rôles moins...attachants. Vous voyez Tremblay, là encore?
Une recommandation de mon libraire, je vous le recommande à mon tour, histoire de sortir de notre époque, non seulement avec le récit, mais aussi à travers celle où le livre a été écrit. Tout est différent, mais on s'y retrouve, ne serait-ce que par les références que j'ai décrites.
Poignant, actif, froid, mais hyper attachant.
Ça se passe quelques années après la Deuxième guerre. On présume qu'on est environ 13 ou 14 ans après cette époque puisque le personnage principale, Tora, est une adolescente née alors que les Allemands occupaient le territoire. Son père était Allemand, et sa mère en a subi les affres. Après la disparition de celui qui fut son amant, elle s'est mis en ménage avec un Norvégien, Henrick.
Il s'agit en fait de l'histoire d'n petit village côtier du nord de la Norvège. Tous triment dur. L'emploi est saisonnier. La mère de Tora ne l'a pas facile, victime non seulement de l'économie, mais aussi de l'opinion qu'ont d'elle les omniprésents habitants du village, et aussi de son nouvel époux, un être sordide, défait, bileux. Or ces personnages habitent une grande maison bourgeoise reconvertie en maison à appartements. Ça a beau être un village, il y a là une promiscuité vraiment particulière, qui apporte autant le réconfort que l'étouffement. Une famille de sept enfants, un célibataire enfermé dans le grenier, Tora, sa mère et son beau-père, et le village.
À plusieurs occasions, j'ai eu l'agréable impression de découvrir un équivalent de l'oeuvre de Michel Tremblay des premiers temps. Non, il ne s'agit pas des Chroniques du Plateau Mont-Royal puisque l'environnement n'est pas pas urbain. Mais il s'agit plutôt de la genèse de quelque chose. On sent que ces personnages iront loin, qu'ils ont un potentiel à se mêler les uns aux autres, mais surtout, immense surprise, on retrouve souvent des dialogues qu'on devine adaptés d'une langue pas nécessairement littéraire. L'auteur, par le biais d'une excellente traduction, donne la parole à ses personnages dans une langue un peu châtiée, raccourcie par plusieurs apostrophes. On sent donc un langage "populaire", pour certains personnages, ce qui donne le ton. Il y a les mieux et les moins bien nantis. Il y a aussi une considération de l'éducation comme investissement dans l'avenir, une certaine considération des étrangers, aussi, et ce qu'ils apportent comme espoir et comme peur. Bref, c'est l'histoire du début d'une nouvelle ère. On voit dans quelle fange tout ça est planté et on souhaite le meilleur à chacun. Or, tel n'est pas le cas pour tous. Pas urbain, mais très dense, La véranda..., bien que norvégien, diffère de la littérature islandaise. C'est ici moins poétique, moins descriptif, plus sec. Aussi les scènes les plus cruelles font-elles plus mal encore. Mais il y a là dedans un espoir flagrant, porté en majeure partie par les femmes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien hâte de voir ce qui arrivera à la plupart de celles-ci, beaucoup plus qu'aux hommes, souvent relégués à des rôles moins...attachants. Vous voyez Tremblay, là encore?
Une recommandation de mon libraire, je vous le recommande à mon tour, histoire de sortir de notre époque, non seulement avec le récit, mais aussi à travers celle où le livre a été écrit. Tout est différent, mais on s'y retrouve, ne serait-ce que par les références que j'ai décrites.
Poignant, actif, froid, mais hyper attachant.
mardi 22 avril 2014
La déesse des mouches à feux, par Geneviève Pettersen, éditions Le Quartanier
Vous avez peut-être déjà vécu la situation: vous êtes en voyage, loin, dans un pays où on ne parle pas votre langue. Les risques (ou les chances, c'est selon...) de tomber sur quelqu'un combinant votre langue et son accent en cet endroit vous semblent très faibles. Or voilà, au bout de quelques jours, ça vous arrive, vous entendez des mots et un langage connu. Mi-touché mi-fier, vous vous dirigez vers la personne en question. Elle s'étonne aussi, il ou elle vous sourit, vous parlez, l'instant est heureux.
Voilà l'histoire de ma rencontre avec la Déesse... Mais poussons l'anecdote un peu plus loin.
Il y a quand même plusieurs jours que vous êtes partis. Depuis longtemps, vous lisez et vous exprimez dans une autre langue que la vôtre, et ces sons qui résonnent dans la bouche d'un autre vous font réaliser qu'il serait doux, voir reposant d'enfin parler un peu votre langue. Alors vous vous intéressez à l'interlocuteur en question. Au début, vous vous trouvez des références communes, rapidement, vous les exprimez, ensemble vous étalez des clichés bien de chez-vous et bien entendu, vous riez. L'autre vous est sympathique, cette rencontre vous fait du bien.
On est toujours, là encore, dans ma relation (si je peux dire) avec La déesse... après quelques pages.
Puis, au fil de la conversation, vous vous apercevez que cette personne, bien que de la même langue et de la même culture que la vôtre, a ceci de tellement typé qu'elle évoque pour vous les traits les plus tant et tellement caractéristiques de ces gens que vous connaissez (trop?) qu'au bout du compte, l'autre commence à vous agacer. Vous ressentez un malaise que vous cherchez à ne pas lui montrer parce que malgré tout, vous riez bien en sa présence et sa langue vous est toujours aussi douce puisque c'est la vôtre. Mais pourtant, à force, vous voyez ben que malgré les expressions communes, son fond, que vous connaissez trop bien, vous déprime quand même un peu, et vous vous dites que si les gens qui vous entourent comprendraient ce qu'il ou elle vous raconte, au bout du compte, vous auriez honte.
Tout ça pour dire que...
Le Français est ma langue maternelle. Cette langue, on le sait, possède la particularité de différer entre l'écrit et le parlé. Le Français écrit n'a pour moi rien de particulier. C'est une langue internationale comme toutes les autres. J'en suis fier lorsque la compare aux autres. Quant au Français parlé, il est divers. Au seul endroit où j'habite, il prend des sonorités différentes au fil des kilomètres. J'en suis fier de temps en temps, j'en ai eu honte longtemps. Je le parle moins du fait que je n'habite plus son pays, sa région, sa maison.
Au Québec, on a vu, au fil du temps, des auteurs donner à la langue d'ici ses lettres de noblesse en l'écrivant. Ancienne dans sa forme orale, la langue semblait renaître par l'écrit. On en a retrouvé une certaine fierté. Depuis ce temps, des auteurs continuent à saupoudrer ici et là quelques écrits d'expressions ou de mots locaux. Les Acadiens sont sans doute ceux qui sont allé le plus loin en mettant leur accent par écrit. Mais les régions Québécoises, elles?
Jamais, jusqu'à Geneviève Pettersen, n'avait-on écrit tout un livre en "Saguenéen". Voilà, c'est fait. J'ai reconnu la voix, alors j'y suis allé. Avec elle, j'ai d'abord beaucoup ri puisque c'étaient mes mots, mes expressions que je retrouvais se distinguant du Français écrit que je lis depuis si longtemps. J'ai même ri aux larmes de lire, à la virgule près, une musique aussi fidèle. Franc avec vous, il fallait le faire.
Or, à force, même si la voix me plaisait toujours, cette narratrice s'est peu à peu révélée. Je l'ai découvert. Et plus elle se racontait, plus j'ai ressenti un malaise. Je me disais que si quelqu'un avait lu ça en même temps que moi, il m'aurait posé des questions auxquelles je n'aurais pas aimé répondre. Est-ce que des filles de 14 ans, à Chicoutimi, étaient vraiment de tels monstres d'égoïsme en 1995? Le sont-elles toujours? Est-ce que des parents peuvent aller à un tel niveau d'irresponsabilité poussé par un égocentrisme, pour eux aussi, aussi incroyable? Est-ce que les gens de cette région étaient (et sont toujours) d'aussi pathétiques clichés de campagnes de marketing, d'une société de consommation facile, sans saveur, sans envergure, qui ne les pousse qu'à se demander si telle ou telle personne les aime ou pas, et rien d'autre? Où réside la fierté de ces gens, si d'aventure ils en possèdent encore une
Et en fin de compte, comme cette jeune fille qui se raconte dans ce livre, tout est-t-il vraiment aussi trash à Chicoutimi? "Trash" est-il le bon mot? J'en étais à ces réflexions lorsque les dernières pages sont arrivées, rapidement. Le livre se termine sur un pont à l'été 1996. Tout résident du Saguenay saura de quel contexte il s'agit.
Geneviève Pettersen n'avait pas besoin de terminer par cette métaphore. On avait déjà compris combien son livre est un tour de force et que son audace va bien au-delà de son écriture. Tout y est: tant ce qui coule que ce qui permet de garder la tête hors de l'eau, tant la ville et ses esprits étroits que le bois et ses espaces de liberté. Ma foi, c'est finalement très Saguenéen tout ça.
Mais que vous parliez Saguenéen ou pas, vous reconnaîtrez là quelque chose qui ne ressemble à rien, et c'est pour ça qu'il vous faut le lire. Être chauvin, je parlerais d'un grand livre.
Voilà l'histoire de ma rencontre avec la Déesse... Mais poussons l'anecdote un peu plus loin.
Il y a quand même plusieurs jours que vous êtes partis. Depuis longtemps, vous lisez et vous exprimez dans une autre langue que la vôtre, et ces sons qui résonnent dans la bouche d'un autre vous font réaliser qu'il serait doux, voir reposant d'enfin parler un peu votre langue. Alors vous vous intéressez à l'interlocuteur en question. Au début, vous vous trouvez des références communes, rapidement, vous les exprimez, ensemble vous étalez des clichés bien de chez-vous et bien entendu, vous riez. L'autre vous est sympathique, cette rencontre vous fait du bien.
On est toujours, là encore, dans ma relation (si je peux dire) avec La déesse... après quelques pages.
Puis, au fil de la conversation, vous vous apercevez que cette personne, bien que de la même langue et de la même culture que la vôtre, a ceci de tellement typé qu'elle évoque pour vous les traits les plus tant et tellement caractéristiques de ces gens que vous connaissez (trop?) qu'au bout du compte, l'autre commence à vous agacer. Vous ressentez un malaise que vous cherchez à ne pas lui montrer parce que malgré tout, vous riez bien en sa présence et sa langue vous est toujours aussi douce puisque c'est la vôtre. Mais pourtant, à force, vous voyez ben que malgré les expressions communes, son fond, que vous connaissez trop bien, vous déprime quand même un peu, et vous vous dites que si les gens qui vous entourent comprendraient ce qu'il ou elle vous raconte, au bout du compte, vous auriez honte.
Tout ça pour dire que...
Le Français est ma langue maternelle. Cette langue, on le sait, possède la particularité de différer entre l'écrit et le parlé. Le Français écrit n'a pour moi rien de particulier. C'est une langue internationale comme toutes les autres. J'en suis fier lorsque la compare aux autres. Quant au Français parlé, il est divers. Au seul endroit où j'habite, il prend des sonorités différentes au fil des kilomètres. J'en suis fier de temps en temps, j'en ai eu honte longtemps. Je le parle moins du fait que je n'habite plus son pays, sa région, sa maison.
Au Québec, on a vu, au fil du temps, des auteurs donner à la langue d'ici ses lettres de noblesse en l'écrivant. Ancienne dans sa forme orale, la langue semblait renaître par l'écrit. On en a retrouvé une certaine fierté. Depuis ce temps, des auteurs continuent à saupoudrer ici et là quelques écrits d'expressions ou de mots locaux. Les Acadiens sont sans doute ceux qui sont allé le plus loin en mettant leur accent par écrit. Mais les régions Québécoises, elles?
Jamais, jusqu'à Geneviève Pettersen, n'avait-on écrit tout un livre en "Saguenéen". Voilà, c'est fait. J'ai reconnu la voix, alors j'y suis allé. Avec elle, j'ai d'abord beaucoup ri puisque c'étaient mes mots, mes expressions que je retrouvais se distinguant du Français écrit que je lis depuis si longtemps. J'ai même ri aux larmes de lire, à la virgule près, une musique aussi fidèle. Franc avec vous, il fallait le faire.
Or, à force, même si la voix me plaisait toujours, cette narratrice s'est peu à peu révélée. Je l'ai découvert. Et plus elle se racontait, plus j'ai ressenti un malaise. Je me disais que si quelqu'un avait lu ça en même temps que moi, il m'aurait posé des questions auxquelles je n'aurais pas aimé répondre. Est-ce que des filles de 14 ans, à Chicoutimi, étaient vraiment de tels monstres d'égoïsme en 1995? Le sont-elles toujours? Est-ce que des parents peuvent aller à un tel niveau d'irresponsabilité poussé par un égocentrisme, pour eux aussi, aussi incroyable? Est-ce que les gens de cette région étaient (et sont toujours) d'aussi pathétiques clichés de campagnes de marketing, d'une société de consommation facile, sans saveur, sans envergure, qui ne les pousse qu'à se demander si telle ou telle personne les aime ou pas, et rien d'autre? Où réside la fierté de ces gens, si d'aventure ils en possèdent encore une
Et en fin de compte, comme cette jeune fille qui se raconte dans ce livre, tout est-t-il vraiment aussi trash à Chicoutimi? "Trash" est-il le bon mot? J'en étais à ces réflexions lorsque les dernières pages sont arrivées, rapidement. Le livre se termine sur un pont à l'été 1996. Tout résident du Saguenay saura de quel contexte il s'agit.
Geneviève Pettersen n'avait pas besoin de terminer par cette métaphore. On avait déjà compris combien son livre est un tour de force et que son audace va bien au-delà de son écriture. Tout y est: tant ce qui coule que ce qui permet de garder la tête hors de l'eau, tant la ville et ses esprits étroits que le bois et ses espaces de liberté. Ma foi, c'est finalement très Saguenéen tout ça.
Mais que vous parliez Saguenéen ou pas, vous reconnaîtrez là quelque chose qui ne ressemble à rien, et c'est pour ça qu'il vous faut le lire. Être chauvin, je parlerais d'un grand livre.
dimanche 20 avril 2014
Le sermon sur la chute de Rome, par Jérome Ferrari, éditions Babel
J'ai de plus en plus la preuve que je ne dois pas me laisser berner par le titre. Celui-ci ne m'attirait pas non plus. Et on dira ce qu'on voudra, bien qu'il ne s'agisse que d'une fraction infinitésimale d'une oeuvre, le titre fait quand même figure d'enseigne, ça peut quand même attirer. Ici, ça avait quelque chose de docte, d'un peu trop vieille philo. C'était bien le cas, pour le fond. Mais pour la forme... on est en plein dans ce siècle.
Tout se passe autour de deux amis d'enfance qui reprennent le bar du petit village corse où l'un d'eux est né, et où l'autre a passé ses vacances toute sa vie durant, ses parents étant originaires de l'endroit. Pour le premier c'est une installation définitive, pour l'autre, un retour. En fait, les deux reviennent après des études en philo à Paris.
Les deux sont Corses sans l'être, un par adoption, l'autre par le sang. En parallèle à l'histoire des deux garçons, il y a celle du grand-père de l'un d'eux, un genre de survivant du dernier siècle, une espèce de modèle qu'on n'aurait pas voulu suivre mais dont la vie d'infortunes semble avoir tracé la voie aux autres. Et il y a aussi Saint-Augustin et son Sermon sur la chute de Rome. Vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler avant, moi non plus. Ne vous en faites pas, vous le comprendrez. Ce fil conducteur vous aidera, comme toute pensée philosophique, à vous faire une opinion des portraits qu'on est en train de vous dépeindre. Quelle superbe idée.
La question qui se pose, pour tous les personnages du Sermon... est de savoir s'ils ont fait les bons choix de vie. A-t-on vraiment le choix? Qu'est-ce qui motive nos choix? Nous mêmes? La famille? La pression sociale? Le destin?
Ces Corses, qu'ils le soient à 100% ou par adoption, donnent l'impression d'être emportés par un courant plus fort qu'eux. Ferrari nous les montre tels qu'ils sont, assez crument. Ce sont fondamentalement des êtres bons, dirait-on, résiliants, déterminés, mais dotés d'une faiblesse commune qu'on arrive mal à définir, un genre de guigne ambiante. En fait, cette histoire nous fait nous demander s'il n'en va pas des peuples comme des individus: certains ont eu plus de chance que d'autres, certains ont eu plus d'argent, de meilleurs parents, une meilleure éducation... Et si on ne possède que des parcelles de tout ça, à moins d'être plus forts, plus déterminés, plus résiliants que les autres, on risque de finir plutôt mal, comme certains personnages. Et tristement, on dirait que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui quittent le navire...
Jérome Ferrari a l'écriture proustienne. Une phrase peut facilement faire une page entière, voir deux. C'est un genre de prose qui me fait parfois avancer plus difficilement. Or voilà, peut-être était-ce voulu, parce qu'au bout d'une dizaine de pages, j'étais complètement subjugué. Faut dire que le livre commence fort en mettant la table avec la description absolument formidable d'une image du passé. On s'apercevra plus loin que même si on prétend souvent le contraire pour toutes sortes de raisons, rien, au final, n'a vraiment changé. Pas dans le monde ce des personnages, en tout cas.
Plutôt sombre, le Sermon... comprend quand même des personnages lumineux mais surtout, une force d'attraction incontestable. Je l'ai assimilé en quelques heures et si vous êtes dans les bonnes dispositions pour le faire, je vous souhaite une aussi grande expérience de lecture que la mienne. De toute évidence, l'Académie Goncourt (prix remis en 2012) fait de bons choix.
Une grande oeuvre.
Tout se passe autour de deux amis d'enfance qui reprennent le bar du petit village corse où l'un d'eux est né, et où l'autre a passé ses vacances toute sa vie durant, ses parents étant originaires de l'endroit. Pour le premier c'est une installation définitive, pour l'autre, un retour. En fait, les deux reviennent après des études en philo à Paris.
Les deux sont Corses sans l'être, un par adoption, l'autre par le sang. En parallèle à l'histoire des deux garçons, il y a celle du grand-père de l'un d'eux, un genre de survivant du dernier siècle, une espèce de modèle qu'on n'aurait pas voulu suivre mais dont la vie d'infortunes semble avoir tracé la voie aux autres. Et il y a aussi Saint-Augustin et son Sermon sur la chute de Rome. Vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler avant, moi non plus. Ne vous en faites pas, vous le comprendrez. Ce fil conducteur vous aidera, comme toute pensée philosophique, à vous faire une opinion des portraits qu'on est en train de vous dépeindre. Quelle superbe idée.
La question qui se pose, pour tous les personnages du Sermon... est de savoir s'ils ont fait les bons choix de vie. A-t-on vraiment le choix? Qu'est-ce qui motive nos choix? Nous mêmes? La famille? La pression sociale? Le destin?
Ces Corses, qu'ils le soient à 100% ou par adoption, donnent l'impression d'être emportés par un courant plus fort qu'eux. Ferrari nous les montre tels qu'ils sont, assez crument. Ce sont fondamentalement des êtres bons, dirait-on, résiliants, déterminés, mais dotés d'une faiblesse commune qu'on arrive mal à définir, un genre de guigne ambiante. En fait, cette histoire nous fait nous demander s'il n'en va pas des peuples comme des individus: certains ont eu plus de chance que d'autres, certains ont eu plus d'argent, de meilleurs parents, une meilleure éducation... Et si on ne possède que des parcelles de tout ça, à moins d'être plus forts, plus déterminés, plus résiliants que les autres, on risque de finir plutôt mal, comme certains personnages. Et tristement, on dirait que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui quittent le navire...
Jérome Ferrari a l'écriture proustienne. Une phrase peut facilement faire une page entière, voir deux. C'est un genre de prose qui me fait parfois avancer plus difficilement. Or voilà, peut-être était-ce voulu, parce qu'au bout d'une dizaine de pages, j'étais complètement subjugué. Faut dire que le livre commence fort en mettant la table avec la description absolument formidable d'une image du passé. On s'apercevra plus loin que même si on prétend souvent le contraire pour toutes sortes de raisons, rien, au final, n'a vraiment changé. Pas dans le monde ce des personnages, en tout cas.
Plutôt sombre, le Sermon... comprend quand même des personnages lumineux mais surtout, une force d'attraction incontestable. Je l'ai assimilé en quelques heures et si vous êtes dans les bonnes dispositions pour le faire, je vous souhaite une aussi grande expérience de lecture que la mienne. De toute évidence, l'Académie Goncourt (prix remis en 2012) fait de bons choix.
Une grande oeuvre.
mardi 8 avril 2014
Canada, par Richard Ford, éditions Boréal
Un couple américain des années 60. Il a fait la 2e Grande guerre et travaille maintenant pour l'armée. Elle est fille d'immigrants juifs. Ils se rencontrent, baisent, elle devient enceinte et accouche de jumeaux. Une famille est née.
L'armée les fera déménager souvent à travers les US. Jamais ils ne s'installeront vraiment à quelque part. Elle s'en fout. Enseignante, elle n'est pas sociable et ne se mêle pas aux autres. Lui est affable, débonnaire et est bien partout. Ils sont aussi opposés que l'est et l'ouest. Ça paraîtra. Avec le temps, ils s'endureront de plus en plus difficilement. On les retrouve dans une ville du Montana. Les enfants ont 15 ans, un garçon et une fille. C'est le garçon qui raconte l'histoire, et celle-ci se passe en deux temps.
D'abord, une situation foireuse entraine les parents, des personnes on ne peut plus normales, sans histoire, banals, à braquer une banque. La situation qui les y mène, l'histoire même de l'événement et sa fin pathétique sont carrément hypnotiques. Vu d'un garçon de 15 ans, tout est pragmatique, rien ne se discute, tout ce qui est se doit d'être. Aussi est-ce sous cet angle qu'on voit se préparer quelque chose d'improbable. Sous le regard sans filtre du narrateur, on voit cette famille foncer droit sur un mur, et c'est fascinant.
Ensuite, la suite des événements fait que les quatre membres de la famille sont séparés. Si on peut facilement imaginer ce qui arrivera aux parents, on ne voit pas trop ce qui arrivera aux enfants. Alors Richard Ford porte notre attention sur un seul, le petit garçon, qu'on fera traverser la frontière et qu'on installera dans une petite bourgade de Saskatchewan. Si le décor est terne, les personnages qui l'entoureront ne le seront pas. Du long fleuve tranquille qu'était son enfance, après la brusque chute, survient un monde tout droit sorti d'un film de David Lynch. Et comme le Prairies, la vie se passera platement. Le petit bonhomme découvrira un monde qu'il n'avait pas envisager fréquenter, jusqu'à un aboutissement surprenant.
La traduction de Josée Kamoun est excellente, rare, même. Vrai qu'il y avait longtemps que je n'avais pas lu un roman américain dans sa version traduite, mais bon... On en a vu de mauvaises traductions... Les mots utilisés par Ford sont simples, sans fioritures, voir même assez secs. Il n'y a rien là de superflu, d'où le côté hypnotique qui m'a d'abord charmé pour la première partie du livre. Ensuite, une fois rendu au fameux Canada, je me suis perdu un peu. Peut-être est-ce l'immensité du territoire, la linéarité du récit, je ne sais pas. Reste que la fin est réussie. Ford ferme cette histoire de possibles, de déceptions et d'apprentissage dans le décor du Détroit de 2012. S'il est vraiment choisi, si c'est vraiment ce que je pense, on a là un grand livre qui suscite la réflexion. Je serais tenté de remplacer la famille dont il est ici question par toute une civilisation. C'est le genre de métaphore qui me plairait.
Canada est un livre qui demande votre attention. Pas facile, pas difficile, fascinant et glissant, c'est une expérience de lecture pas banale pour qui aime l'action lente, mais précise.
L'armée les fera déménager souvent à travers les US. Jamais ils ne s'installeront vraiment à quelque part. Elle s'en fout. Enseignante, elle n'est pas sociable et ne se mêle pas aux autres. Lui est affable, débonnaire et est bien partout. Ils sont aussi opposés que l'est et l'ouest. Ça paraîtra. Avec le temps, ils s'endureront de plus en plus difficilement. On les retrouve dans une ville du Montana. Les enfants ont 15 ans, un garçon et une fille. C'est le garçon qui raconte l'histoire, et celle-ci se passe en deux temps.
D'abord, une situation foireuse entraine les parents, des personnes on ne peut plus normales, sans histoire, banals, à braquer une banque. La situation qui les y mène, l'histoire même de l'événement et sa fin pathétique sont carrément hypnotiques. Vu d'un garçon de 15 ans, tout est pragmatique, rien ne se discute, tout ce qui est se doit d'être. Aussi est-ce sous cet angle qu'on voit se préparer quelque chose d'improbable. Sous le regard sans filtre du narrateur, on voit cette famille foncer droit sur un mur, et c'est fascinant.
Ensuite, la suite des événements fait que les quatre membres de la famille sont séparés. Si on peut facilement imaginer ce qui arrivera aux parents, on ne voit pas trop ce qui arrivera aux enfants. Alors Richard Ford porte notre attention sur un seul, le petit garçon, qu'on fera traverser la frontière et qu'on installera dans une petite bourgade de Saskatchewan. Si le décor est terne, les personnages qui l'entoureront ne le seront pas. Du long fleuve tranquille qu'était son enfance, après la brusque chute, survient un monde tout droit sorti d'un film de David Lynch. Et comme le Prairies, la vie se passera platement. Le petit bonhomme découvrira un monde qu'il n'avait pas envisager fréquenter, jusqu'à un aboutissement surprenant.
La traduction de Josée Kamoun est excellente, rare, même. Vrai qu'il y avait longtemps que je n'avais pas lu un roman américain dans sa version traduite, mais bon... On en a vu de mauvaises traductions... Les mots utilisés par Ford sont simples, sans fioritures, voir même assez secs. Il n'y a rien là de superflu, d'où le côté hypnotique qui m'a d'abord charmé pour la première partie du livre. Ensuite, une fois rendu au fameux Canada, je me suis perdu un peu. Peut-être est-ce l'immensité du territoire, la linéarité du récit, je ne sais pas. Reste que la fin est réussie. Ford ferme cette histoire de possibles, de déceptions et d'apprentissage dans le décor du Détroit de 2012. S'il est vraiment choisi, si c'est vraiment ce que je pense, on a là un grand livre qui suscite la réflexion. Je serais tenté de remplacer la famille dont il est ici question par toute une civilisation. C'est le genre de métaphore qui me plairait.
Canada est un livre qui demande votre attention. Pas facile, pas difficile, fascinant et glissant, c'est une expérience de lecture pas banale pour qui aime l'action lente, mais précise.
dimanche 9 mars 2014
Deuil, par Gudbergur Bergsson, éditions Métaillé
Gudbergur Bergsson est un auteur islandais, né en 1932. Bien que sa bibliographie soit imposante, c'est là son second ouvrage qui ait été traduit en français. Éric Boury, traducteur aussi de Jon Kalman Stefansson, entre autres, nous l'a transmis. .
Non, c'est pas jojo. Avec un tel titre, on ne s'attend pas à rire. Ce court ouvrage est dur et triste, mais absolument pas rébarbatif. Bien au contraire. Cette voix est très juste pour parler d'une réalité que notre société fait tout, absolument tout pour nous faire oublier. Bergsson fait mal, mais plutôt que de nous faire souffrir, il nous apprend..
Un homme est couché dans son lit. On le devine âgé. Il peine à se lever, il somnole, on le croit qui rêve, mais non, il ressasse des souvenirs tout en constatant le présent: il est seul, sa campagne est récemment entrée dans la mort.
Les derniers jours vécus par sa compagne constituent le fil conducteur des souvenirs du narrateur. Plus qu'un deuil, en fait, l'homme raconte la vieillesse, tant la sienne que celle de la défunte, mais aussi d'autres gens qui l'ont entouré. La mort des autres lui fait prendre conscience de la sienne. Voila ce autour de quoi tournent ses pensées, son existence, tant son passé que son futur, si court soit-il. Vieillir, nous montre-t-il, c'est prendre conscience de la mort, et pas juste de la sienne. D'où le titre, sans doute.
J'ai rarement entendu parler de la vieillesse de cette façon. On dirait le récit d'un soldat en plein coeur d'une bataille. Ça ressemble au récit de Stalingrad raconté de l'intérieur dans Les Bienveillantes, de Jonathan Littel. Rien, ici, n'est enjolivé ou coloré de quelconque façon. C'est cru, parfois choquant parce dit tel quel. Vieillir fait mal au narrateur et aux personnages qui l'entourent. Il y a quelque chose de cruel à constater que plus rien ne va.
La narration est simple et belle. On est vite happé par le narrateur, on est dans son esprit et on a mal. Les malaises s'accumulent, la tristesse aussi. Mais il s'agit d'une belle tristesse parce que racontée doucement, au rythme lent des déplacements du vieillard. Le propos même du narrateur fait en sorte qu'il nous est difficile d'être empathique à son égard. Accepter de mourir est une chose, accepter de vieillir en est une autre, aussi ne nous est-il pas naturel de "comprendre" les descriptions qu'un vieux fait à propos d'autres que lui qui, à l'évidence, verront la mort avant lui. Y'a quelque chose au fond de nous qui fait en sorte qu'on ne veut pas savoir ça, on dirait. Et pourtant... La langue de Bergsson est belle, très nordique en ce qu'elle part parfois dans le monde parallèle des pensées en même temps qu'une action très concrète se déroule. La lecture exige toutefois beaucoup de calme puisqu'on entre, en tout cas pour ma part, dans un monde très peu connu. Aussi faut-il quelque concentration pour bien saisir la portée des propos du narrateur.
Triste et beau, dur et utile, Deuil de Gudbergur Bergsson ne devrait pas vous effrayer. Il m'a aidé à saisir ce que d'autres entrevoient peut-être, à moins qu'ils ne le vivent de la même façon. Peut-être ressortirai-je ce livre plus tard à quelque époque à venir de ma propre vie.
Un beau livre d'apprentissage sur la fin d'un monde, le sien.
Non, c'est pas jojo. Avec un tel titre, on ne s'attend pas à rire. Ce court ouvrage est dur et triste, mais absolument pas rébarbatif. Bien au contraire. Cette voix est très juste pour parler d'une réalité que notre société fait tout, absolument tout pour nous faire oublier. Bergsson fait mal, mais plutôt que de nous faire souffrir, il nous apprend..
Un homme est couché dans son lit. On le devine âgé. Il peine à se lever, il somnole, on le croit qui rêve, mais non, il ressasse des souvenirs tout en constatant le présent: il est seul, sa campagne est récemment entrée dans la mort.
Les derniers jours vécus par sa compagne constituent le fil conducteur des souvenirs du narrateur. Plus qu'un deuil, en fait, l'homme raconte la vieillesse, tant la sienne que celle de la défunte, mais aussi d'autres gens qui l'ont entouré. La mort des autres lui fait prendre conscience de la sienne. Voila ce autour de quoi tournent ses pensées, son existence, tant son passé que son futur, si court soit-il. Vieillir, nous montre-t-il, c'est prendre conscience de la mort, et pas juste de la sienne. D'où le titre, sans doute.
J'ai rarement entendu parler de la vieillesse de cette façon. On dirait le récit d'un soldat en plein coeur d'une bataille. Ça ressemble au récit de Stalingrad raconté de l'intérieur dans Les Bienveillantes, de Jonathan Littel. Rien, ici, n'est enjolivé ou coloré de quelconque façon. C'est cru, parfois choquant parce dit tel quel. Vieillir fait mal au narrateur et aux personnages qui l'entourent. Il y a quelque chose de cruel à constater que plus rien ne va.
La narration est simple et belle. On est vite happé par le narrateur, on est dans son esprit et on a mal. Les malaises s'accumulent, la tristesse aussi. Mais il s'agit d'une belle tristesse parce que racontée doucement, au rythme lent des déplacements du vieillard. Le propos même du narrateur fait en sorte qu'il nous est difficile d'être empathique à son égard. Accepter de mourir est une chose, accepter de vieillir en est une autre, aussi ne nous est-il pas naturel de "comprendre" les descriptions qu'un vieux fait à propos d'autres que lui qui, à l'évidence, verront la mort avant lui. Y'a quelque chose au fond de nous qui fait en sorte qu'on ne veut pas savoir ça, on dirait. Et pourtant... La langue de Bergsson est belle, très nordique en ce qu'elle part parfois dans le monde parallèle des pensées en même temps qu'une action très concrète se déroule. La lecture exige toutefois beaucoup de calme puisqu'on entre, en tout cas pour ma part, dans un monde très peu connu. Aussi faut-il quelque concentration pour bien saisir la portée des propos du narrateur.
Triste et beau, dur et utile, Deuil de Gudbergur Bergsson ne devrait pas vous effrayer. Il m'a aidé à saisir ce que d'autres entrevoient peut-être, à moins qu'ils ne le vivent de la même façon. Peut-être ressortirai-je ce livre plus tard à quelque époque à venir de ma propre vie.
Un beau livre d'apprentissage sur la fin d'un monde, le sien.
dimanche 2 mars 2014
Pourquoi Bologne, par Alain Farah, éditions Le Quartanier
On commence dans l'espace intergalactique. D'entrée de jeu. "Bon, science-fiction" on se dit. Soit. Quelques lignes plus loin, on est en 1962. Pourtant encore quelques lignes plus loin, y'a quelque chose qui accroche parce qu'il nous semble avoir vu passer une référence à notre époque actuelle. Pourtant on retombe dans les années 60. Environnement de l'université McGill, à Montréal. Oups, changement de siècle, on raconte les débuts de l'institution vers 1800-quelque chose. Une ligne plus tard, non, ce sont les années 60, et on est dans la tête de l'auteur. De l'auteur? Mais le personnage principal, c'est qui? L'auteur? Le personnage principal est Alain Farah? Ben oui. Oui mais dans quel siècle sommes-nous alors?
Le roman fait environ 200 pages. Après 100 pages, je me suis demandé si je continuais. Je sortais d'Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, un roman qui suit l'Histoire finement, logiquement. Là, on me brassait comme une pinball dans une machine à boule d'une époque à l'autre en l'espace d'une phrase où deux. Puis un psychiatre entre dans l'histoire et là, on comprend qu'on est en plein délire parano de l'auteur/personnage principal.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une auto-fiction écrite dans un sous-sol ou une thèse universitaire sur le surréalisme?
Et pourtant j'ai continué, d'abord parce que je voulais répondre à cette question précise, à savoir ce que j'étais en train de lire, mais aussi parce qu'au bout du compte, ça se lisait bien. Étais-je victime d'une grosse farce? Quel sera le punch final? Lire ce texte de Farah, c'est un peu comme lire du Boris Vian sur l'acide. C'est complètement pété, sympathique, mais plutôt angoissant. Alors comme lui, on se pause plusieurs questions...
J'ai accroché avec une épisode où l'auteur/personnage raconte une scène de son enfance. Thérapie? Le mec est en train de nous faire nous taper sa thérapie, moi qui déteste ces scènes? Non, ce serait trop... évident. Quelques pages avant la fin, je me suis demandé si je ne me faisais pas carrément rire de moi ou si je n'étais pas en train de lire quelque chose qui ne ressemble à rien et qui, au bout du compte, me captive. Parce ce que lire Pourquoi Bologne, c'est comme regarder un inconnu se taper une crise de délire en pleine rue: on est gênés, mal l'aise. Au début on est choqué mais avec le temps, on comprend ce qui se passe. Alain Farah nous fait carrément vivre un délire. On embarque dedans avec lui, il nous fait une place dans sa tête, et ma foi, ça fonctionne.
Oui, j'ai failli lancer ce livre on fond de la pièce à un certain moment, mais je ne pourrais dire que je n'ai pas aimé. Bien que le scénario soit tout sauf limpide, l'écriture est belle, absolument pas lourde, ce qui rend le tout digeste. Bien écrit, il nous tient par la main pour une visite guidée d'une tête sans dessus dessous. Or, le délire parano est dû à quelque chose, on le découvre, et si la cause de ce désarroi (parce que c'est, à mon sens, de ce dont il est question) a bel et bien existée, eh bien Farah a réussi à nous faire sentir combien l'épisode sombre de l'histoire des sciences qu'il relate a été sombre.
Comment on appelle ça: un roman déconstruit? Je ne saurais dire. À qui le recommander? Là, j'hésite. Qui aime lire et a envie de se faire déranger sera servi. Qui veut découvrir un auteur Québécois hors normes aussi. Entre le quartier de Cartierville et l'université McGill, vous serez accompagné d'un guide plutôt déconcertant, usrtout lorsqu'on s'aperçoit que le temps, ici n,a rien à voir avec ce qu'on a connu de lui jusqu'ici. Et pour qui lit peu et a envie de nouveau... c'est difficile à dire. À prime abord, je ne recommanderais pas Pourquoi Bologne à un lecteur occasionnel... ni surtout conventionnel. Quant à moi, je lirai encore Alain Farah. Je dirais que dans ma vie de lecteur, cette bibitte a jouit d'un bon timing. À détester avec emphase ou à délecter avec ravissement.
Recommandé aux curieux.
Le roman fait environ 200 pages. Après 100 pages, je me suis demandé si je continuais. Je sortais d'Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, un roman qui suit l'Histoire finement, logiquement. Là, on me brassait comme une pinball dans une machine à boule d'une époque à l'autre en l'espace d'une phrase où deux. Puis un psychiatre entre dans l'histoire et là, on comprend qu'on est en plein délire parano de l'auteur/personnage principal.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une auto-fiction écrite dans un sous-sol ou une thèse universitaire sur le surréalisme?
Et pourtant j'ai continué, d'abord parce que je voulais répondre à cette question précise, à savoir ce que j'étais en train de lire, mais aussi parce qu'au bout du compte, ça se lisait bien. Étais-je victime d'une grosse farce? Quel sera le punch final? Lire ce texte de Farah, c'est un peu comme lire du Boris Vian sur l'acide. C'est complètement pété, sympathique, mais plutôt angoissant. Alors comme lui, on se pause plusieurs questions...
J'ai accroché avec une épisode où l'auteur/personnage raconte une scène de son enfance. Thérapie? Le mec est en train de nous faire nous taper sa thérapie, moi qui déteste ces scènes? Non, ce serait trop... évident. Quelques pages avant la fin, je me suis demandé si je ne me faisais pas carrément rire de moi ou si je n'étais pas en train de lire quelque chose qui ne ressemble à rien et qui, au bout du compte, me captive. Parce ce que lire Pourquoi Bologne, c'est comme regarder un inconnu se taper une crise de délire en pleine rue: on est gênés, mal l'aise. Au début on est choqué mais avec le temps, on comprend ce qui se passe. Alain Farah nous fait carrément vivre un délire. On embarque dedans avec lui, il nous fait une place dans sa tête, et ma foi, ça fonctionne.
Oui, j'ai failli lancer ce livre on fond de la pièce à un certain moment, mais je ne pourrais dire que je n'ai pas aimé. Bien que le scénario soit tout sauf limpide, l'écriture est belle, absolument pas lourde, ce qui rend le tout digeste. Bien écrit, il nous tient par la main pour une visite guidée d'une tête sans dessus dessous. Or, le délire parano est dû à quelque chose, on le découvre, et si la cause de ce désarroi (parce que c'est, à mon sens, de ce dont il est question) a bel et bien existée, eh bien Farah a réussi à nous faire sentir combien l'épisode sombre de l'histoire des sciences qu'il relate a été sombre.
Comment on appelle ça: un roman déconstruit? Je ne saurais dire. À qui le recommander? Là, j'hésite. Qui aime lire et a envie de se faire déranger sera servi. Qui veut découvrir un auteur Québécois hors normes aussi. Entre le quartier de Cartierville et l'université McGill, vous serez accompagné d'un guide plutôt déconcertant, usrtout lorsqu'on s'aperçoit que le temps, ici n,a rien à voir avec ce qu'on a connu de lui jusqu'ici. Et pour qui lit peu et a envie de nouveau... c'est difficile à dire. À prime abord, je ne recommanderais pas Pourquoi Bologne à un lecteur occasionnel... ni surtout conventionnel. Quant à moi, je lirai encore Alain Farah. Je dirais que dans ma vie de lecteur, cette bibitte a jouit d'un bon timing. À détester avec emphase ou à délecter avec ravissement.
Recommandé aux curieux.
mardi 18 février 2014
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, éditions Albin Michel
Le deuil de personnages, je veux bien. Celui d'un livre aussi. Mais celui d'une époque que je n'ai pas connue et d"endroits où je ne suis jamais allé, c'est presque trop fort. Je suis sorti d'Au revoir là-haut il y a quelques heures et je crains y rester encore longtemps. Ce livre fut marquant à plusieurs égards. Voici pourquoi.
Les cinquante premières pages sont sans aucune doute les cinquante premières pages les plus enlevantes que j'aie lues jusqu'ici. On est à la fin de la Première guerre mondiale, c'est une question de jours, voire d'heures avant que ça ne s'achève. Le champ de bataille est quelque part en France. On est du côté des soldats Français. Un officier frustré par la fin incessante d'un travail qui lui allait comme un gant terrorise ses troupes en les impliquant dans une dernière bataille. Cette attaque ne changera pas le cours de l'Histoire, mais ses conséquences marqueront certains y ayant participé.
Le ton, la façon de raconter cette histoire est très à propos. Lemaitre est un raconteur. Il y a là du Echenoz, du Teulé, enfin un peu, car l'écriture est somme toute unique. Lemaitre s'adresse à nous. Il nous raconte quelque chose bien plus encore qu'il ne nous l'écrit. Ce ton sympathique et très juste convient à toutes les situations. La description d'un général qui ronfle m'a fait rire bien fort et celle du désarroi et de la peur d'un ancien soldat nous ferait lui tendre la main s'il était juste en face de nous. Lemaitre sait jouer des émotions en les liant toutes par une histoire tragique, immensément tragique, en fait, celle de la petitesse de l'humain devant ce qui le dépasse. Les réflexes naturels de défense sont ici mis en exergue. "Chassez le naturel...", disait quelqu'un... En fait, acculez n'importe qui au pied du mur et vous en verrez la vraie nature. Certains fonceront dans ce mur, d'autres se pisseront dessus. Tout ça se retrouve dans Au revoir là-haut.
Parce qu'il est ici question d'escroqueries, et elles sont très viles. Les gens, comme l'époque, étaient alors très vulnérables. Des personnages restés intacts en ont profité. De bonne ou de mauvaise façon? Je vous en laisse juger. Bien entendu, le mauvais se démarque toujours d'une façon particulière, mais au bout du compte, on en viendra à se demander si, de tous les tricheurs qui évoluent dans ce livre, certains n'avaient pas raison d'agir ainsi. Les récits de guerre ne m'attirent pas. Si tel est le cas, faites comme moi et passez par-dessus votre appréhension. Parce que de la guerre, il n'en est question qu'au début, et comme je le mentionnais plus haut, croyez-moi, cette portion du livre est loin d'être ennuyante. Le reste met en scène les conséquences de la guerre. C'est un pan de l'Histoire que l'on connaît moins, surtout celui de la Grande guerre de 14-18. Celui raconté a pour toile de fond un phénomène qui a bien existé en France: les exhumations des corps des soldats morts au combat. La table est mise: c'est sordide, très bas, triste au possible, mais raconté par Pierre Lemaitre, c'est une histoire incroyable, par moments rocambolesque, que vous dévorerez d'une page à l'autre.
Je ne parlerai pas des personnages, à mon sens parfaits parce que fortement typés. Les sympathiques deviennent vils et les truands... mais qui sont les bons et les méchants? Voilà le bon côté de la littérature: on nous laisse en tirer notre propre conclusion.
Pour terminer, une anecdote incroyable qu'il me faut vous partager. C'est la première fois que ça m'arrive, que je suis témoin d'une telle chose: la fin d'un des personnages principaux d'Au revoir là-haut est exactement la même que celle du personnage principal d'un livre que j'ai terminé tout récemment, soit Le fil des kilomètres, de Christian Guay-Poliquin. Et croyez-moi, cette fin n'est pas banale du tout, mais forte symboliquement. Les personnages mis en cause, dans ces fins, le contexte, l'instrument utilisé... c'est la même scène, mais revisitée dans chacun de ces deux ouvrages. Oui, j'y vois le fruit du hasard. Les deux livres ont sans doute été écrits dans la même période et je serais surpris que ces auteurs se soient téléphonés pour préparer ensemble une bonne blague. Si vous avez lu ces deux livres, s'il vous plait partagez votre impression de ce phénomène étrange avec moi. La coïncidence est trop incroyable pour être passée sous silence.
Reste qu'Au revoir là-haut est un grand livre. Le jury du Goncourt 2013 a réussi un grand coup. Je n'ai pas lu les autres ouvrages mis en candidature mais celui-là figurera très certainement parmi mes plus grands plaisirs de lecture... à vie. Merci, Pierre Lemaitre! Vous voulez en savoir plus? Pierre Lemaitre vous décrit, sur vidéo, son roman et sa motivation en deux minutes et demie.
Les cinquante premières pages sont sans aucune doute les cinquante premières pages les plus enlevantes que j'aie lues jusqu'ici. On est à la fin de la Première guerre mondiale, c'est une question de jours, voire d'heures avant que ça ne s'achève. Le champ de bataille est quelque part en France. On est du côté des soldats Français. Un officier frustré par la fin incessante d'un travail qui lui allait comme un gant terrorise ses troupes en les impliquant dans une dernière bataille. Cette attaque ne changera pas le cours de l'Histoire, mais ses conséquences marqueront certains y ayant participé.
Le ton, la façon de raconter cette histoire est très à propos. Lemaitre est un raconteur. Il y a là du Echenoz, du Teulé, enfin un peu, car l'écriture est somme toute unique. Lemaitre s'adresse à nous. Il nous raconte quelque chose bien plus encore qu'il ne nous l'écrit. Ce ton sympathique et très juste convient à toutes les situations. La description d'un général qui ronfle m'a fait rire bien fort et celle du désarroi et de la peur d'un ancien soldat nous ferait lui tendre la main s'il était juste en face de nous. Lemaitre sait jouer des émotions en les liant toutes par une histoire tragique, immensément tragique, en fait, celle de la petitesse de l'humain devant ce qui le dépasse. Les réflexes naturels de défense sont ici mis en exergue. "Chassez le naturel...", disait quelqu'un... En fait, acculez n'importe qui au pied du mur et vous en verrez la vraie nature. Certains fonceront dans ce mur, d'autres se pisseront dessus. Tout ça se retrouve dans Au revoir là-haut.
Parce qu'il est ici question d'escroqueries, et elles sont très viles. Les gens, comme l'époque, étaient alors très vulnérables. Des personnages restés intacts en ont profité. De bonne ou de mauvaise façon? Je vous en laisse juger. Bien entendu, le mauvais se démarque toujours d'une façon particulière, mais au bout du compte, on en viendra à se demander si, de tous les tricheurs qui évoluent dans ce livre, certains n'avaient pas raison d'agir ainsi. Les récits de guerre ne m'attirent pas. Si tel est le cas, faites comme moi et passez par-dessus votre appréhension. Parce que de la guerre, il n'en est question qu'au début, et comme je le mentionnais plus haut, croyez-moi, cette portion du livre est loin d'être ennuyante. Le reste met en scène les conséquences de la guerre. C'est un pan de l'Histoire que l'on connaît moins, surtout celui de la Grande guerre de 14-18. Celui raconté a pour toile de fond un phénomène qui a bien existé en France: les exhumations des corps des soldats morts au combat. La table est mise: c'est sordide, très bas, triste au possible, mais raconté par Pierre Lemaitre, c'est une histoire incroyable, par moments rocambolesque, que vous dévorerez d'une page à l'autre.
Je ne parlerai pas des personnages, à mon sens parfaits parce que fortement typés. Les sympathiques deviennent vils et les truands... mais qui sont les bons et les méchants? Voilà le bon côté de la littérature: on nous laisse en tirer notre propre conclusion.
Pour terminer, une anecdote incroyable qu'il me faut vous partager. C'est la première fois que ça m'arrive, que je suis témoin d'une telle chose: la fin d'un des personnages principaux d'Au revoir là-haut est exactement la même que celle du personnage principal d'un livre que j'ai terminé tout récemment, soit Le fil des kilomètres, de Christian Guay-Poliquin. Et croyez-moi, cette fin n'est pas banale du tout, mais forte symboliquement. Les personnages mis en cause, dans ces fins, le contexte, l'instrument utilisé... c'est la même scène, mais revisitée dans chacun de ces deux ouvrages. Oui, j'y vois le fruit du hasard. Les deux livres ont sans doute été écrits dans la même période et je serais surpris que ces auteurs se soient téléphonés pour préparer ensemble une bonne blague. Si vous avez lu ces deux livres, s'il vous plait partagez votre impression de ce phénomène étrange avec moi. La coïncidence est trop incroyable pour être passée sous silence.
Reste qu'Au revoir là-haut est un grand livre. Le jury du Goncourt 2013 a réussi un grand coup. Je n'ai pas lu les autres ouvrages mis en candidature mais celui-là figurera très certainement parmi mes plus grands plaisirs de lecture... à vie. Merci, Pierre Lemaitre! Vous voulez en savoir plus? Pierre Lemaitre vous décrit, sur vidéo, son roman et sa motivation en deux minutes et demie.
dimanche 9 février 2014
L'Amérique ou le disparu, d'après Franz Kafka, par Réal Godbout, éditions La Pasteque
Je pousse ma découverte de la bédé encore plus loin, mais je continue à préciser que mon appréciation n'est toujours pas celle de l'expert mais bien du néophyte.
Avec cette expérience-ci, je tombe en plein enchantement. L'adaptation des textes de Kafka me semble justifiée. On le sait, celui-là a toujours su utiliser la métaphore à bon escient. C'est riche pour une bédé! Avec cette histoire, la métaphore en question réside dans le titre. L'Amérique joue le rôle principal de la conquête de Karl qui découvrira vite que là, c'est la loi du plus fort qui prédomine. "Réveillez-vous, tenez-vous prêt, aurait pu dire Kafka. Ça sera pas de la tarte."
J'ai réalisé avec L'Amérique combien les personnages principaux de Kafka ont ceci de très Américain qu'ils sont le plus souvent attachants, issus du peuple, vulnérables. Quand à leur caractère victime, mettons plutôt ça sur une particularité toute kafkaienne, mais n'empêche: ici, Karl, a tout pour se faire aimer. Naïf, on lui crierait constamment qu'il y a traquenard ici et là, mais il a seize ans, débarque dans un nouveau monde, et les nouveaux mondes, quelques qu'ils soient, c'est rarement facile. Je ne connaissais pas du tout cet ouvrage inachevé de Kafka, aussi sa découverte a-t-elle ajouté à l'expérience.
Quant aux dessins, je suis absolument sous le charme. Godbout est un auteur connu au Québec pour des séries publiées dans des revues satiriques dans les années 80 et 90. On m'aurait dit que l'auteur de Michel Risque et de Red Ketchup se lançait dans Kafka, j'aurais tiqué. Or voilà, quel talent. Quels beaux dessins. Le New York de la fin du 19e siècle y est fantastique. On le voit avec les yeux du nouvel arrivant qui, lui, va d'aventure en aventure avec sa bouille de petit voisin qu'on prendrait certainement la peine de saluer tellement il nous parait sympathique.
L'univers de Kafka est étrange, mais réaliste, en ce sens qu'il ne s'agit pas de science-fiction, enfin pas cette fois-ci. Cet ouvrage a un côté très humain, d'où sa dureté, parfois, et les émotions partagées qu'il nous inspire. Je n'y a perçu aucun cliché du "New York de rêve", mais bien, je le dis encore, un décor grand, lourd, faste dans lequel il ne peut que se passer des histoires hors de l'ordinaire.
Les dessins en noir et blanc sont à mon sens très bédéesques parce que caricaturaux mais proportionnés. Les personnages constitueraient un excellent storyboard de vaudeville. Réel plaisir de lecture, L'Amérique de Kafka revisitée par Réal Godbout constitue certainement une belle initiation au genre bédé pour qui, comme moi, n'y plonge que très peu souvent. Un vrai beau livre.
Avec cette expérience-ci, je tombe en plein enchantement. L'adaptation des textes de Kafka me semble justifiée. On le sait, celui-là a toujours su utiliser la métaphore à bon escient. C'est riche pour une bédé! Avec cette histoire, la métaphore en question réside dans le titre. L'Amérique joue le rôle principal de la conquête de Karl qui découvrira vite que là, c'est la loi du plus fort qui prédomine. "Réveillez-vous, tenez-vous prêt, aurait pu dire Kafka. Ça sera pas de la tarte."
J'ai réalisé avec L'Amérique combien les personnages principaux de Kafka ont ceci de très Américain qu'ils sont le plus souvent attachants, issus du peuple, vulnérables. Quand à leur caractère victime, mettons plutôt ça sur une particularité toute kafkaienne, mais n'empêche: ici, Karl, a tout pour se faire aimer. Naïf, on lui crierait constamment qu'il y a traquenard ici et là, mais il a seize ans, débarque dans un nouveau monde, et les nouveaux mondes, quelques qu'ils soient, c'est rarement facile. Je ne connaissais pas du tout cet ouvrage inachevé de Kafka, aussi sa découverte a-t-elle ajouté à l'expérience.
Quant aux dessins, je suis absolument sous le charme. Godbout est un auteur connu au Québec pour des séries publiées dans des revues satiriques dans les années 80 et 90. On m'aurait dit que l'auteur de Michel Risque et de Red Ketchup se lançait dans Kafka, j'aurais tiqué. Or voilà, quel talent. Quels beaux dessins. Le New York de la fin du 19e siècle y est fantastique. On le voit avec les yeux du nouvel arrivant qui, lui, va d'aventure en aventure avec sa bouille de petit voisin qu'on prendrait certainement la peine de saluer tellement il nous parait sympathique.
L'univers de Kafka est étrange, mais réaliste, en ce sens qu'il ne s'agit pas de science-fiction, enfin pas cette fois-ci. Cet ouvrage a un côté très humain, d'où sa dureté, parfois, et les émotions partagées qu'il nous inspire. Je n'y a perçu aucun cliché du "New York de rêve", mais bien, je le dis encore, un décor grand, lourd, faste dans lequel il ne peut que se passer des histoires hors de l'ordinaire.
Les dessins en noir et blanc sont à mon sens très bédéesques parce que caricaturaux mais proportionnés. Les personnages constitueraient un excellent storyboard de vaudeville. Réel plaisir de lecture, L'Amérique de Kafka revisitée par Réal Godbout constitue certainement une belle initiation au genre bédé pour qui, comme moi, n'y plonge que très peu souvent. Un vrai beau livre.
Inscription à :
Articles (Atom)