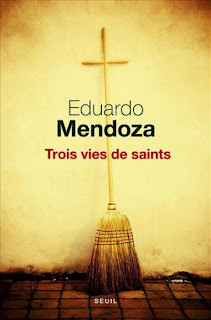Y'a de ces livres dans lesquels on entre à reculons, mal à l'aise, avec une impression d'aller à une soirée où on n'avait absolument pas envie d'aller. C'était ça avec Édouard Louis. Ce que j'en entendais dire ne me laissais pas indifférent, mais je craignais comme la peste le misérabilisme, sentiment que j'abhorre par dessus tout.
J'ai aussi eu peur d'un autre Nelly Arcand. J'avoue que Putain est un des rares livres que que j'ai dû abandonner avant la fin. Ce cri m'exaspérait, cette écriture me rendait hors de moi. Vu de l'extérieur, l'histoire d'Eddy Bellegueule ressemblait à ça. Or, j'ai lu la quatrième de couverture... c'est rare qu'un livre m'attrape par là.
D'entrée de jeu, l'auteur dit ne pas se souvenir d'avoir été heureux dans son enfance. Bon. Puis, l'auteur met la table en expliquant très clairement que d'autant qu'il se souvienne, il a toujours été freluquet, délicat, et il faut bien l'admettre: effeminé. Et ce même enfant. Une des premières scènes raconte un crachat reçu en pleine face à l'école. Bien sur, on fait tout de suite le lien avec l'intimidation qui fait rage dans tout bon établissement scolaire, mais attention, c'est loin d'être tout. D'origine franco-française, vivant dans un village du nord de la France, le gars raconte ses parents, sa famille et son monde, son village. Si à l'école la violence est physique, à la maison elle est verbale. Rapidement, ce garçon se rend compte que ce qu'il est, sa nature même, ne répond aux standards de personne, et le drame réside dans le fait que tout ça se passe il y a une dizaine d'années, au début de ce siècle. C'est à vous jeter par terre.
Rien, dans cet environnement où la vie est difficile, où le niveau de vie est bas, où les plaisirs sont rares, n'encourage à la différence. Personne, dans un tel monde, n'est fier de ce qu'il est ni de ce vers quoi il tend. Il y est à peu près impossible de s'y valoriser. Alors s'il vient à passer quelqu'un de plus faible que soi, le côté animal prend le dessus, et tant pis pour le respect, fut-il question d'un voisin, d'un frère ou même de son propre enfant.
Édouard raconte son enfance froidement, aussi durement qu'il l'a vécue. Il n'épargne personne. On pourrait croire à un règlement de comptes, mais pourtant pas, et c'est là où le livre surprend et où il m'a capté. C'est qu'il s'agit plutôt du regard lucide, voir extra-lucide, d'un personnage mis de côté sur la société actuelle. En racontant tout le monde, Édouard Louis nous fait nous rendre compte que tous, dans ce village, sont des victimes. Ils le sont tous autant que lui. On y quitte l'école le plus tôt possible pour aussitôt entrer à l'usine. On y fait tout aussi tôt des enfants rapidement laissés pour compte et toujours, partout, on écoute la télé.
La lecture de ce livre n'a rien de joyeux. Toutes les anecdotes racontées vous retournent les sens et pourtant, il y a quelque chose qu'on comprend. Pour peu qu'on ait subi les affres de ses pairs à l'enfance ou qu'on ait eu connaissance de celles de nos parents, on comprend que ceux pour qui un tel livre pourrait constituer un miroir n'entreront probablement jamais en contact avec un tel objet: un livre. Pourquoi? À vous de tirer vos conclusions. Quant à moi, je refuse de dire que ce pan de la société n'est constitué que de gros cons. Absolument pas. Mais je constate toutefois que si la Société est sensé avancer, le mouvement ne se fait pas en même temps pour tous. Pourquoi tant de haine? Pourquoi ne valorise-t-on pas l'éducation? Ce livre laisse en suspens bien des questions.
Comme vous voyez, En finir avec... ne laisse pas indifférent. Bien écrit, il se lit aussi bien qu'une rubrique de potins dans un journal. Parce que c'est de ça dont il s'agit, mais les aventures ici racontées dans le détail ne sont pas celles des pipeuls, mais bien de leurs contraires. Or un tel livre est essentiel parce qu'une telle voix est de celles qui dénoncent les guerres. son premier livre est de l'anti-fantasy, ses personnages, le contraire des licornes. Édouard Louis n'a pas fini de faire parler de lui, et c'est tant mieux. Je me fait un devoir de le recommander et d'en parler.
À lire absolument parce que marquant, mais coeurs sensibles et porteurs de lunettes roses, s'abstenir.
samedi 14 juin 2014
dimanche 8 juin 2014
Trois vies de saints, par Eduardo Mendoza, éditions du Seuil
Il y a peu d'auteurs dont j'achète les bouquins sans même consulter la quatrième de couverture. Mendoza est un de ceux-là. Pas qu'il ne m'ait toujours réjoui, par contre. N'en demeure pas moins qu'il m'a toujours diverti. Mendoza est un de ces auteurs qui sache toucher plusieurs genres. Du polar loufoque aux sagas historiques grandioses, le voici qui donne maintenant dans la nouvelle.
Comme le titre l'indique, Trois vies... raconte l'histoire de trois personnages. Quant à savoir s'il s'agit ou pas de saints, c'est là tout Mendoza. Sa définition de la sainteté est assurément bien personnelle et empreinte d'ironie. Mais si l'on considère les saints comme des modèles (à suivre ou pas), je considère qu'il a frappé dans le mille. Les trois ont ce petit quelque chose qui fait avancer les société dans lesquelles ils se retrouvent.
En premier lieu, on retrouve un évêque sud-américain condamné, bien malgré lui, à rester à Barcelone où il ne devait rester que le temps d'un court séjour officiel. Un des intérêts de cette nouvelle est que l'auteur la raconte au "je". En même temps de celle de l'évêque étranger, il raconte l'histoire de sa jeunesse, ou à tout le moins de son environnement familial. Si l'histoire prend des tournures rocambolesques, son propos est parfois dur, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents, avec lequel le narrateur a le mérite de de ne pas en parler de manière hypocrite. Aussi vrai qu'on puisse être parfois très durs envers ses parents, Mendoza l'est ici à la puissance dix, d'autant plus que le personnage raconté à travers eux, soit celui de l'évêque en question, est lui-même un bonhomme fort parce que libre, et donc plutôt incompris par des parents plutôt obtus. L'évêque saura nager habilement à travers les jugements et les inclinaisons que les sociétés civile et religieuse auraient voulu qu'il prenne. Peut-être aura-t-il fait partie de quelque chose de grand... Mendoza vous fait vous le demander.
La seconde nouvelle m'a laissé dubitatif. Le personnage principal, apprenant qu'une maladie l'emportera d'ici une période de temps bien définie, se retrouve dans une situation où la possibilité lui est donnée d'exprimer son avis sur la vie, la société et tutti quanti devant un parquet trié sur le volet. On assiste à sa lente dérive en se demandant s'il feint la folie ou si c'est cette dernière qui s'empare de lui peu à peu. Aussi complexe que les pensées de son personnage principal, cette nouvelle m'a un peu perdu. J'ai cru en saisir un propos très critique, mais je n'ai pas été touché pour autant.
La dernière est ma préférée. Un petit truand de rien découvre la littérature en prison par l'entremise d'une enseignante plutôt désoeuvrée. Ce qui ne ressemblait à rien au départ prendra des proportions incroyables que les deux protagonistes vivront séparément mais intensément chacun de leur côté. Dans cette nouvelle il est clair que Mendoza prend la parole pour donner son interprétation à lui de ce qu'est la littérature, mais aussi de ce qui l'entoure, des perceptions qu'on peut en avoir et de l'utilisation, médiatique ou pas, qu'on peut en faire. Juste pour un Mendoza qui se met dans la peau d'un ancien moins que rien, la nouvelle vaut le détour... et nous fait réaliser qu'il y a peut-être des connections avec l'histoire où il raconte sa famille...
Rien d'hilarant, rien de renversant, mais un bon divertissement. Ceux qui comme moi auront été déçus par quelques uns de ses derniers livres retrouveront un Mendoza qu'on aimerait pouvoir lire plus souvent. Ces histoires sont plus personnelles, et c'est tant mieux. Soulignons enfin l'excellente traduction de François Maspero qui fait très certainement partie du succès que Mendoza puisse avoir avec le public francophone.
Comme le titre l'indique, Trois vies... raconte l'histoire de trois personnages. Quant à savoir s'il s'agit ou pas de saints, c'est là tout Mendoza. Sa définition de la sainteté est assurément bien personnelle et empreinte d'ironie. Mais si l'on considère les saints comme des modèles (à suivre ou pas), je considère qu'il a frappé dans le mille. Les trois ont ce petit quelque chose qui fait avancer les société dans lesquelles ils se retrouvent.
En premier lieu, on retrouve un évêque sud-américain condamné, bien malgré lui, à rester à Barcelone où il ne devait rester que le temps d'un court séjour officiel. Un des intérêts de cette nouvelle est que l'auteur la raconte au "je". En même temps de celle de l'évêque étranger, il raconte l'histoire de sa jeunesse, ou à tout le moins de son environnement familial. Si l'histoire prend des tournures rocambolesques, son propos est parfois dur, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents, avec lequel le narrateur a le mérite de de ne pas en parler de manière hypocrite. Aussi vrai qu'on puisse être parfois très durs envers ses parents, Mendoza l'est ici à la puissance dix, d'autant plus que le personnage raconté à travers eux, soit celui de l'évêque en question, est lui-même un bonhomme fort parce que libre, et donc plutôt incompris par des parents plutôt obtus. L'évêque saura nager habilement à travers les jugements et les inclinaisons que les sociétés civile et religieuse auraient voulu qu'il prenne. Peut-être aura-t-il fait partie de quelque chose de grand... Mendoza vous fait vous le demander.
La seconde nouvelle m'a laissé dubitatif. Le personnage principal, apprenant qu'une maladie l'emportera d'ici une période de temps bien définie, se retrouve dans une situation où la possibilité lui est donnée d'exprimer son avis sur la vie, la société et tutti quanti devant un parquet trié sur le volet. On assiste à sa lente dérive en se demandant s'il feint la folie ou si c'est cette dernière qui s'empare de lui peu à peu. Aussi complexe que les pensées de son personnage principal, cette nouvelle m'a un peu perdu. J'ai cru en saisir un propos très critique, mais je n'ai pas été touché pour autant.
La dernière est ma préférée. Un petit truand de rien découvre la littérature en prison par l'entremise d'une enseignante plutôt désoeuvrée. Ce qui ne ressemblait à rien au départ prendra des proportions incroyables que les deux protagonistes vivront séparément mais intensément chacun de leur côté. Dans cette nouvelle il est clair que Mendoza prend la parole pour donner son interprétation à lui de ce qu'est la littérature, mais aussi de ce qui l'entoure, des perceptions qu'on peut en avoir et de l'utilisation, médiatique ou pas, qu'on peut en faire. Juste pour un Mendoza qui se met dans la peau d'un ancien moins que rien, la nouvelle vaut le détour... et nous fait réaliser qu'il y a peut-être des connections avec l'histoire où il raconte sa famille...
Rien d'hilarant, rien de renversant, mais un bon divertissement. Ceux qui comme moi auront été déçus par quelques uns de ses derniers livres retrouveront un Mendoza qu'on aimerait pouvoir lire plus souvent. Ces histoires sont plus personnelles, et c'est tant mieux. Soulignons enfin l'excellente traduction de François Maspero qui fait très certainement partie du succès que Mendoza puisse avoir avec le public francophone.
lundi 2 juin 2014
La véranda aveugle, par Herbjorg Wassmo, éditions Babel
Il m'arrive rarement de lire des ouvrages parus il y a longtemps. Celui-là est du début des années 80. Écrit par une auteure qu'on décrit comme un des plus grands écrivains norvégiens, c'est le premier d'une trilogie. Je lirai les autres, c'est certain.
Ça se passe quelques années après la Deuxième guerre. On présume qu'on est environ 13 ou 14 ans après cette époque puisque le personnage principale, Tora, est une adolescente née alors que les Allemands occupaient le territoire. Son père était Allemand, et sa mère en a subi les affres. Après la disparition de celui qui fut son amant, elle s'est mis en ménage avec un Norvégien, Henrick.
Il s'agit en fait de l'histoire d'n petit village côtier du nord de la Norvège. Tous triment dur. L'emploi est saisonnier. La mère de Tora ne l'a pas facile, victime non seulement de l'économie, mais aussi de l'opinion qu'ont d'elle les omniprésents habitants du village, et aussi de son nouvel époux, un être sordide, défait, bileux. Or ces personnages habitent une grande maison bourgeoise reconvertie en maison à appartements. Ça a beau être un village, il y a là une promiscuité vraiment particulière, qui apporte autant le réconfort que l'étouffement. Une famille de sept enfants, un célibataire enfermé dans le grenier, Tora, sa mère et son beau-père, et le village.
À plusieurs occasions, j'ai eu l'agréable impression de découvrir un équivalent de l'oeuvre de Michel Tremblay des premiers temps. Non, il ne s'agit pas des Chroniques du Plateau Mont-Royal puisque l'environnement n'est pas pas urbain. Mais il s'agit plutôt de la genèse de quelque chose. On sent que ces personnages iront loin, qu'ils ont un potentiel à se mêler les uns aux autres, mais surtout, immense surprise, on retrouve souvent des dialogues qu'on devine adaptés d'une langue pas nécessairement littéraire. L'auteur, par le biais d'une excellente traduction, donne la parole à ses personnages dans une langue un peu châtiée, raccourcie par plusieurs apostrophes. On sent donc un langage "populaire", pour certains personnages, ce qui donne le ton. Il y a les mieux et les moins bien nantis. Il y a aussi une considération de l'éducation comme investissement dans l'avenir, une certaine considération des étrangers, aussi, et ce qu'ils apportent comme espoir et comme peur. Bref, c'est l'histoire du début d'une nouvelle ère. On voit dans quelle fange tout ça est planté et on souhaite le meilleur à chacun. Or, tel n'est pas le cas pour tous. Pas urbain, mais très dense, La véranda..., bien que norvégien, diffère de la littérature islandaise. C'est ici moins poétique, moins descriptif, plus sec. Aussi les scènes les plus cruelles font-elles plus mal encore. Mais il y a là dedans un espoir flagrant, porté en majeure partie par les femmes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien hâte de voir ce qui arrivera à la plupart de celles-ci, beaucoup plus qu'aux hommes, souvent relégués à des rôles moins...attachants. Vous voyez Tremblay, là encore?
Une recommandation de mon libraire, je vous le recommande à mon tour, histoire de sortir de notre époque, non seulement avec le récit, mais aussi à travers celle où le livre a été écrit. Tout est différent, mais on s'y retrouve, ne serait-ce que par les références que j'ai décrites.
Poignant, actif, froid, mais hyper attachant.
Ça se passe quelques années après la Deuxième guerre. On présume qu'on est environ 13 ou 14 ans après cette époque puisque le personnage principale, Tora, est une adolescente née alors que les Allemands occupaient le territoire. Son père était Allemand, et sa mère en a subi les affres. Après la disparition de celui qui fut son amant, elle s'est mis en ménage avec un Norvégien, Henrick.
Il s'agit en fait de l'histoire d'n petit village côtier du nord de la Norvège. Tous triment dur. L'emploi est saisonnier. La mère de Tora ne l'a pas facile, victime non seulement de l'économie, mais aussi de l'opinion qu'ont d'elle les omniprésents habitants du village, et aussi de son nouvel époux, un être sordide, défait, bileux. Or ces personnages habitent une grande maison bourgeoise reconvertie en maison à appartements. Ça a beau être un village, il y a là une promiscuité vraiment particulière, qui apporte autant le réconfort que l'étouffement. Une famille de sept enfants, un célibataire enfermé dans le grenier, Tora, sa mère et son beau-père, et le village.
À plusieurs occasions, j'ai eu l'agréable impression de découvrir un équivalent de l'oeuvre de Michel Tremblay des premiers temps. Non, il ne s'agit pas des Chroniques du Plateau Mont-Royal puisque l'environnement n'est pas pas urbain. Mais il s'agit plutôt de la genèse de quelque chose. On sent que ces personnages iront loin, qu'ils ont un potentiel à se mêler les uns aux autres, mais surtout, immense surprise, on retrouve souvent des dialogues qu'on devine adaptés d'une langue pas nécessairement littéraire. L'auteur, par le biais d'une excellente traduction, donne la parole à ses personnages dans une langue un peu châtiée, raccourcie par plusieurs apostrophes. On sent donc un langage "populaire", pour certains personnages, ce qui donne le ton. Il y a les mieux et les moins bien nantis. Il y a aussi une considération de l'éducation comme investissement dans l'avenir, une certaine considération des étrangers, aussi, et ce qu'ils apportent comme espoir et comme peur. Bref, c'est l'histoire du début d'une nouvelle ère. On voit dans quelle fange tout ça est planté et on souhaite le meilleur à chacun. Or, tel n'est pas le cas pour tous. Pas urbain, mais très dense, La véranda..., bien que norvégien, diffère de la littérature islandaise. C'est ici moins poétique, moins descriptif, plus sec. Aussi les scènes les plus cruelles font-elles plus mal encore. Mais il y a là dedans un espoir flagrant, porté en majeure partie par les femmes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien hâte de voir ce qui arrivera à la plupart de celles-ci, beaucoup plus qu'aux hommes, souvent relégués à des rôles moins...attachants. Vous voyez Tremblay, là encore?
Une recommandation de mon libraire, je vous le recommande à mon tour, histoire de sortir de notre époque, non seulement avec le récit, mais aussi à travers celle où le livre a été écrit. Tout est différent, mais on s'y retrouve, ne serait-ce que par les références que j'ai décrites.
Poignant, actif, froid, mais hyper attachant.
Inscription à :
Articles (Atom)