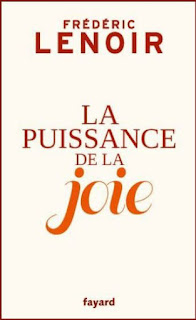Voici le livre le plus suffoquant qu'il m'ait été donné de lire. Règne animal est un livre qui, comme pour ses personnages, se referme sur nous, nous écrase, nous prends à la gorge. Quant à Jean-Baptiste Del Amo, on parle d'une écriture rare, d'un vocabulaire et d'une narration si forts que même les pires misères deviennent, sous sa plume, terriblement fascinantes. Seul un écrivain de ce calibre peut se permettre un roman aussi noir, aussi foncé et aussi excellent. Parce que l'entreprises était casse-gueule pour son auteur. C'est plutôt la nôtre, notre gueule de lecteurs, qui se disloque à la fin de ce livre.
La première moitié raconte la vie d'une famille de petits agriculteurs français du début du 20e siècle. La vie est dure, les gens sont durs, mais pourtant rien ne semble leur arriver. Ils vivent, seulement, du mieux qu'ils peuvent. Terre et animaux font partie du quotidien des humains. Terre et animaux sont partout, dans la maison, sur la ferme, dans leurs têtes. La vie, c'est de survivre. L'auteur pose sa loupe sur un tableau qu'on connaît trop peu. La vie paysanne à cette époque était dure oui, mais sait-on à quelle point? Et pour qui, et pourquoi? L'homme parle peu et s'use au travail, la femme aussi, mais plus encore, elle endure une vie qui ne lui va pas. Puis l'enfant, une petite fille, arrive et se fond à ce décor, cette vie. Elle deviendra la même chose. Puis vient un nouveau personnage, un garçon de ferme issu de la famille d'un des deux parents, venu pour aider, et enfin arrive la guerre de 14-18. Les tableaux décrits tant de la vie sur la terre que de la guerre sont hypnotiques tellement ils sont bien décrits. Rien, ici n'a de couleur. Tout n'est que boue, terre, grisaille. Et à travers ça, un désir de survivre, de se hisser la tête hors de l'eau, de dominer quelque chose comme la nature, par exemple, ou un ennemi qu'on ne connait pas.
Deuxième partie du livre, on est projetés en 1981. Sur la même ferme, la même terre, vivent les descendants de la famille décrite précédemment. la petite fille d'alors est maintenant la matriarche. Son fils, devenu grand-père, mène ses deux fils dans l'exploitation d'une ferme porcine. Là, l'auteur décrit le quotidien de chacun des membres de la famille et de leur relation, voir même, de leur vie avec l'entreprise familiale. C'était dur avant, mais maintenant, est-ce vraiment mieux? Il faut lire Règne animal pour connaître les détails d'une entreprise d'élevage de porcs dans les années 80. Par le détail, Del Amo décrit un autre monde qu'on connaît trop peu et qui, pourtant, n'avait l'air de rien. La misère a changé de format, mais elle existe encore. En fait, c'est comme si la guerre se poursuivait. Et c'est là où le titre de ce livre prend tout son sens: on est en plein règne animal. Mais qui sont les animaux? Où est l'humain là dedans? Et si on avait tout raté?
On m'aurait décrit ce livre par le détail que jamais je ne l'aurais lu. Le sujet est d'une dureté incroyable. On y parle de soumission, d'exploitation, de vulnérabilité, et partout, on se demande pourquoi tout ça, pourquoi une telle vie. En fait, est-ce vraiment une vie?
Et pourtant, sa lecture nous mène à un miracle opéré par l'auteur. Del Amo m'avait complètement eu avec Une éducation libertine. Le revoici avec son écriture fine, ses descriptions précises, ses mots si bien choisis qu'il donne l'impression d'avoir lu des pages et des pages d'encyclopédies avant de choisir les bons termes. Ça a l'air lourd comme ça, mais ça se lit tellement bien qu'on en vient à ne pas croire qu'on se laisse happer par une histoire aussi dure. On étouffe, et on aime ça. On plisse les yeux d'horreur ou de dégout mis on ne voit pas comment arrêter sa lecture. Tout ça sans meurtres, sans intrigue sadique ou sans science-fiction. Tout ça, dans la vie ordinaire grossit tellement de fois qu'on n'en voit que les germes, les microbes, et encore une fois, les ratées.
Ça, mais alors là, ça, oui, c'est de la littérature, et un réel un divertissement en plus. Ce livre me restera longtemps en tête, pour toutes sortes de raisons. Chapeau à Jean-Baptiste Del Amo. Vivement un autre!
mardi 20 décembre 2016
dimanche 4 décembre 2016
L'accordeur de silences, par Mia Couto, éditions Métailié
Ce joli titre est une belle idée soit de la maison d'édition, soit du traducteur de Mia Couto (Elisabeth Monteiro Rodrigues, qui a fait un excellent travail), un écrivain lusophone mozambicain qui écrit magnifiquement bien. Cet Accordeur... est remarquable à plusieurs égards.
Un homme a quitté la ville, le monde, avec ses deux fils et un accompagnateur. Ils vivent loin de la civilisation, dans un ancien camp de chasse, dans la savane. Pour cet homme, le monde, ailleurs, ça n'existe pas. Le monde, désormais, c'est eux. Ayant fait abstraction de son passé, il imposera la même chose à ses enfants, comme plein d'autres choses. En fait, cet homme imposera sa vision du monde à son entourage, qui comprend aussi un ravitailleur, qui leur apporte des vivres de temps en temps. Or, un événement brisera cet ordre établi par le père tout puissant, et la réalité reviendra le frapper.
C'est le fils le plus jeune qui raconte l'histoire. Cette histoire est la sienne, sa relation avec son père, son frère et l'autre, un aide de camp bizarre. Au fil du temps, on découvrira combien cette réclusion pèse à l'ainé, qui parlera à de leur mère à son petit frère. Et il y a les autres, l'aide de camp, le ravitailleur... qui sont-ils vraiment?
Le petit narrateur a connu peu de choses de leur vie d'avant, aussi le suit-on, au début, dans sa découverte naïve du monde. Puis, l'influence de son frère et la tyrannie grandissante de son père le fera rêver d'un autre monde. Et arrivera ce qui devait arriver: quelqu'un de nouveau. Et ce quelqu'un est une femme...
D'une grande intelligence, cette histoire fait autant sourire qu'elle choque. Il y a quelque chose d'un conteur, chez cet auteur, qui nous tient captif. Il y a aussi beaucoup de poésie, la relation avec la terre et tout ce qui entoure les personnages est vraiment belle. Puis, lorsqu'on comprend le passé qui les a mené là, on assiste à une scène d'une violence qu'on n'avait pas vue venir. Entre tout ça, on retrouve certains chapitres écrits sous la forme de lettres qu'un des personnages adressera à un autre personnage qui lui est cher. On ira alors, avec ces lettres, vivre des émotions diverses écrites dans des mots super bien choisis.
Ce livre nous ramène à la place que nous occupons dans l'univers, dans le monde, dans notre monde, et sur nos rapports avec les autres. L'histoire, enlevante, emmène à ces réflexions, sans toutefois nous perdre dans des pensées trop profondes. Bref, c'est très habile.
Et il y a le décor, l'Afrique de nos jours, celle dont on n'entend pas parler, calme et parfois cruelle, comme cette histoire, qui est vite devenue une très belle découverte. Mia Couto est un écrivain très reconnu dans son pays, en Afrique et dans le monde lusophone. Il a écrit plusieurs livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Avec raison. C'est à découvrir, pour le dépaysement, tant dans la façon de raconter que par les décors présentés et les émotions suggérées.
Un homme a quitté la ville, le monde, avec ses deux fils et un accompagnateur. Ils vivent loin de la civilisation, dans un ancien camp de chasse, dans la savane. Pour cet homme, le monde, ailleurs, ça n'existe pas. Le monde, désormais, c'est eux. Ayant fait abstraction de son passé, il imposera la même chose à ses enfants, comme plein d'autres choses. En fait, cet homme imposera sa vision du monde à son entourage, qui comprend aussi un ravitailleur, qui leur apporte des vivres de temps en temps. Or, un événement brisera cet ordre établi par le père tout puissant, et la réalité reviendra le frapper.
C'est le fils le plus jeune qui raconte l'histoire. Cette histoire est la sienne, sa relation avec son père, son frère et l'autre, un aide de camp bizarre. Au fil du temps, on découvrira combien cette réclusion pèse à l'ainé, qui parlera à de leur mère à son petit frère. Et il y a les autres, l'aide de camp, le ravitailleur... qui sont-ils vraiment?
Le petit narrateur a connu peu de choses de leur vie d'avant, aussi le suit-on, au début, dans sa découverte naïve du monde. Puis, l'influence de son frère et la tyrannie grandissante de son père le fera rêver d'un autre monde. Et arrivera ce qui devait arriver: quelqu'un de nouveau. Et ce quelqu'un est une femme...
D'une grande intelligence, cette histoire fait autant sourire qu'elle choque. Il y a quelque chose d'un conteur, chez cet auteur, qui nous tient captif. Il y a aussi beaucoup de poésie, la relation avec la terre et tout ce qui entoure les personnages est vraiment belle. Puis, lorsqu'on comprend le passé qui les a mené là, on assiste à une scène d'une violence qu'on n'avait pas vue venir. Entre tout ça, on retrouve certains chapitres écrits sous la forme de lettres qu'un des personnages adressera à un autre personnage qui lui est cher. On ira alors, avec ces lettres, vivre des émotions diverses écrites dans des mots super bien choisis.
Ce livre nous ramène à la place que nous occupons dans l'univers, dans le monde, dans notre monde, et sur nos rapports avec les autres. L'histoire, enlevante, emmène à ces réflexions, sans toutefois nous perdre dans des pensées trop profondes. Bref, c'est très habile.
Et il y a le décor, l'Afrique de nos jours, celle dont on n'entend pas parler, calme et parfois cruelle, comme cette histoire, qui est vite devenue une très belle découverte. Mia Couto est un écrivain très reconnu dans son pays, en Afrique et dans le monde lusophone. Il a écrit plusieurs livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Avec raison. C'est à découvrir, pour le dépaysement, tant dans la façon de raconter que par les décors présentés et les émotions suggérées.
lundi 28 novembre 2016
Le rouge vif de la rhubarbe, par Audur Ava Olafsdottir, éditions Zulma
Agustina est une adolescente qui vit avec sa grand-mère dans l'Islande des années 60 ou 70. Une infirmité de naissance la fait se déplacer avec des béquilles. Sa mère, une scientifique qui vit à l'étranger, lui envoie régulièrement des lettres. Voilà pour l'histoire. Vraiment. C'est aussi simple que ça.
À travers ça, Agustina rencontrera un garçon de son âge qui prendra partie de la protéger, elle s'interrogera souvent sur la rencontre fortuite de ses parents qui conduira à sa naissance, puis elle élaborera le projet de monter avec ses béquilles la montagne qui surplombe son village.
Ce livre serait donc le premier que cette auteur a écrit, ceci avant le fameux Rosa Candida qui l'a fait connaître des lecteurs francophones. On y retrouve la même sensibilité, le même lien entre les personnages et la terre et aussi la même vulnérabilité de personnages qui font pourtant tout pour démontrer le contraire. Un peu comme ses autres livres, celui-là raconte aussi une époque d'apprentissage.
Après quelques pages de ma troisième rencontre avec cette auteure islandaise, je me suis dit que j'en avais sans doute assez, que ces histoires avec le minimum d'action n'étaient pas ce dont j'avais besoin ces jours-ci et pourtant... j'ai lu la dernière moitié plus rapidement que la dernière. Parce qu'un tel livre fait du bien. Il n'y a pas de bons ni de méchants dans de telles livres, mais que des personnages qui sont aux prises avec eux-mêmes et qui tentent de se définir. Ça nous rejoint toujours inévitablement. Ce côté introspectif est, je le découvre au fil de mes lectures, très scandinave. On dirait que ces auteurs du Nord n'ont pas peur de s'arrêter pour penser, se remettre en question, de partager leurs pensées profondes et même moins profondes. L'action, ici, est secondaire. C'est aussi le paysage qui dicte le cours des choses, parce que très présent, fort, dur, mais apaisant.
La petite histoire d'Agustina ne change pas la vie, mais comme les autres livres d'Audur Ava, elle permet de passer un bon moment à oublier la sienne, sa vie. Pour les amateurs d'histoire simples, profondes mais pas mièvres. Et pour qui connait l'auteur, si j'en crois mon expérience, vous ne serez pas déçus.
À travers ça, Agustina rencontrera un garçon de son âge qui prendra partie de la protéger, elle s'interrogera souvent sur la rencontre fortuite de ses parents qui conduira à sa naissance, puis elle élaborera le projet de monter avec ses béquilles la montagne qui surplombe son village.
Ce livre serait donc le premier que cette auteur a écrit, ceci avant le fameux Rosa Candida qui l'a fait connaître des lecteurs francophones. On y retrouve la même sensibilité, le même lien entre les personnages et la terre et aussi la même vulnérabilité de personnages qui font pourtant tout pour démontrer le contraire. Un peu comme ses autres livres, celui-là raconte aussi une époque d'apprentissage.
Après quelques pages de ma troisième rencontre avec cette auteure islandaise, je me suis dit que j'en avais sans doute assez, que ces histoires avec le minimum d'action n'étaient pas ce dont j'avais besoin ces jours-ci et pourtant... j'ai lu la dernière moitié plus rapidement que la dernière. Parce qu'un tel livre fait du bien. Il n'y a pas de bons ni de méchants dans de telles livres, mais que des personnages qui sont aux prises avec eux-mêmes et qui tentent de se définir. Ça nous rejoint toujours inévitablement. Ce côté introspectif est, je le découvre au fil de mes lectures, très scandinave. On dirait que ces auteurs du Nord n'ont pas peur de s'arrêter pour penser, se remettre en question, de partager leurs pensées profondes et même moins profondes. L'action, ici, est secondaire. C'est aussi le paysage qui dicte le cours des choses, parce que très présent, fort, dur, mais apaisant.
La petite histoire d'Agustina ne change pas la vie, mais comme les autres livres d'Audur Ava, elle permet de passer un bon moment à oublier la sienne, sa vie. Pour les amateurs d'histoire simples, profondes mais pas mièvres. Et pour qui connait l'auteur, si j'en crois mon expérience, vous ne serez pas déçus.
lundi 14 novembre 2016
La jeune épouse, par Alessandro Baricco,éditions Gallimard
C'est l'histoire d'une famille qui vit dans un immense manoir en campagne. Chaque matin, ses membres encore endormis se tombent dans les bras les uns les autres, heureux de constater qu'ils ne sont pas morts pendant la nuit. Puis, ils s'installent à la table des petits déjeuners qu'ils prennent jusqu'à tard en fin d'après-midi. Tous les jours.
Mère et fille sont vives et d'une beauté référentielle. Le père est un industriel richissime. Un gérant doué s'occupe de ses affaires. Un oncle vit avec eux. Il dort tout le temps et dit des mots d'esprit entre deux sommeils. Et le fils, lui, est parti faire son apprentissage ailleurs. Mais on l'espère, parce qu'arrive la jeune épouse. À 18 ans, elle décide qu'il est temps de venir convoler avec le fils, qu'elle a connu il y a quelques années. Mais ce dernier n'est pas là. Alors la famille l'accueille et ce sont eux qui s'occuperont d'elle. Ils feront son apprentissage.
La table est mise. Le tableau est parfait. Tout au long de ce livre, en fait, il faut imaginer des situations parfaites, des corps, des esprits, des décors, des vies parfaites. Car tout est là: le trop. On s'y plait, on s'y délecte souvent, mais qu'arrive-t-il lorsqu'on n'en peux plus, et qu'est-ce qui fait qu'on s'y complaise?
Encore une fois, Baricco joue dans la métaphore. Cet auteur qui figure parmi mes préférés écrit des fables longues, fines et truculentes. Ses personnages sont excentriques, ses décors ne souffrent d'aucune imperfection et ses histoires nous tiennent en haleine. Et ses descriptions... Tiens, oui, parlons-en, parce qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Il y a un érotisme qui frôle le degré plus élevé... de l'érotisme.
Qui connait Baricco sait combien ses histoires sont sensuelles, finement sensuelles, juste assez. Avec lui, même les corps les plus flétris deviennent désirables. Avec la jeune épouse, l'auteur s'est lancé. Ses personnages étaient parfaitement dessinés pour que leur auteur les emmène là où il n'est jamais allé avant. La jeune épouse fera donc la découverte du désir avec à peu près chaque membre de la famille. Progressivement. Mais ici, il faut rappeler que le Fils, lui, n'est pas là. Déduisez-en ce que vous voulez mais bon, pour ma part, ça m'a surpris. La première scène du genre est justement une surprise. La seconde encore plus. Maintenant voilà... le fallait-il... Ma réponse: non. Ce n'était pas obligé. Même sans ces scènes, La jeune épouse aurait charmé. Bien sur, il y avait longtemps que Baricco nous y préparait. Depuis Soie. Maintenant que c'est fait, pour ma part, j'en souris. N'est pas donné à qui le veut l'art de décrire des scènes érotiques. Baricco y parvient, mais peut-être pas aussi fortement que tout ce qu'il écrit, pas aussi magnifiquement que l'ensemble de son oeuvre, chargée d'odeurs, de couleurs, et de tout ce que la littérature peut avoir de beau et de bon.
Je suis et je demeure un fan inconditionnel de Baricco. Sa façon de raconter est unique. Cette Jeune épouse ne restera pas mon préféré de lui. La raison: il a ouvert la porte d'une pièce dont le mystère faisait, jusqu'ici, ma joie. Ceci dit, ce n'est pas mal fait. Parce que n'oubliez pas, le fils n'est pas là. Reviendra-t-il? Et si oui, comment? Pour ces seules questions, il faut lire La jeune épouse.
Mère et fille sont vives et d'une beauté référentielle. Le père est un industriel richissime. Un gérant doué s'occupe de ses affaires. Un oncle vit avec eux. Il dort tout le temps et dit des mots d'esprit entre deux sommeils. Et le fils, lui, est parti faire son apprentissage ailleurs. Mais on l'espère, parce qu'arrive la jeune épouse. À 18 ans, elle décide qu'il est temps de venir convoler avec le fils, qu'elle a connu il y a quelques années. Mais ce dernier n'est pas là. Alors la famille l'accueille et ce sont eux qui s'occuperont d'elle. Ils feront son apprentissage.
La table est mise. Le tableau est parfait. Tout au long de ce livre, en fait, il faut imaginer des situations parfaites, des corps, des esprits, des décors, des vies parfaites. Car tout est là: le trop. On s'y plait, on s'y délecte souvent, mais qu'arrive-t-il lorsqu'on n'en peux plus, et qu'est-ce qui fait qu'on s'y complaise?
Encore une fois, Baricco joue dans la métaphore. Cet auteur qui figure parmi mes préférés écrit des fables longues, fines et truculentes. Ses personnages sont excentriques, ses décors ne souffrent d'aucune imperfection et ses histoires nous tiennent en haleine. Et ses descriptions... Tiens, oui, parlons-en, parce qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Il y a un érotisme qui frôle le degré plus élevé... de l'érotisme.
Qui connait Baricco sait combien ses histoires sont sensuelles, finement sensuelles, juste assez. Avec lui, même les corps les plus flétris deviennent désirables. Avec la jeune épouse, l'auteur s'est lancé. Ses personnages étaient parfaitement dessinés pour que leur auteur les emmène là où il n'est jamais allé avant. La jeune épouse fera donc la découverte du désir avec à peu près chaque membre de la famille. Progressivement. Mais ici, il faut rappeler que le Fils, lui, n'est pas là. Déduisez-en ce que vous voulez mais bon, pour ma part, ça m'a surpris. La première scène du genre est justement une surprise. La seconde encore plus. Maintenant voilà... le fallait-il... Ma réponse: non. Ce n'était pas obligé. Même sans ces scènes, La jeune épouse aurait charmé. Bien sur, il y avait longtemps que Baricco nous y préparait. Depuis Soie. Maintenant que c'est fait, pour ma part, j'en souris. N'est pas donné à qui le veut l'art de décrire des scènes érotiques. Baricco y parvient, mais peut-être pas aussi fortement que tout ce qu'il écrit, pas aussi magnifiquement que l'ensemble de son oeuvre, chargée d'odeurs, de couleurs, et de tout ce que la littérature peut avoir de beau et de bon.
Je suis et je demeure un fan inconditionnel de Baricco. Sa façon de raconter est unique. Cette Jeune épouse ne restera pas mon préféré de lui. La raison: il a ouvert la porte d'une pièce dont le mystère faisait, jusqu'ici, ma joie. Ceci dit, ce n'est pas mal fait. Parce que n'oubliez pas, le fils n'est pas là. Reviendra-t-il? Et si oui, comment? Pour ces seules questions, il faut lire La jeune épouse.
samedi 22 octobre 2016
Le poids de la neige, par Christian Guay-Poliquin, éditions La Peuplade
J'étais heureux de retrouver l'auteur du superbe Fil des kilomètres. Pour son deuxième roman, j'avais entendu parler d'un huis clos avec une relation aidant/aidé. C'est bel et bien le cas, et quel plaisir de constater après quelques pages que je lisais la suite du premier roman de Christian Guay-Poliquin.
Après l'histoire "road movie", c'est l'enfermement. Le contexte "général" demeure: des événements non identifiés font que le monde dans lequel évolue l'histoire se retrouve sans électricité. Les villes sont proies au saccage et tous se retrouvent en mode survie. Mais le terrain est connu. Le narrateur et personnage principal est revenu dans son village d'origine, et comme le titre l'indique, on est en plein hiver, dans un monde de lacs et de forêts denses. Les habitants des latitudes hivernales s'y retrouveront.
Confiné à une convalescence après un accident, le narrateur se retrouve sous la supervision d'un personnage inconnu beaucoup plus âgé que lui. Ce dernier veut quitter le lieu où il se retrouve, comme, d'ailleurs, à peu près tous les habitants du petit village. Mais pour quitter le village au printemps, alors que les routes redeviendront praticables, ce personnage devra s'occuper du narrateur convalescent dont les deux jambes ont été cassées, en retour d'une promesse dans une expédition de départ. Le long rétablissement du blessé deviendra l'espoir de l'aidant à s'en aller. Les deux apprendront à se connaître, pour le meilleur comme pour le pire. Et l'hiver s'étirera jusqu'à ce que le printemps s'amène. Qui s'en sortira le mieux du jeune blessé et du vieux soigneur? Est-ce plutôt l'hiver qui l'emportera? L'espoir d'une vie meilleure? La peur de l'inconnu? Et comment survivront-ils dans un monde devenu sans ressources? Comme avec son premier livre, l'auteur a trouvé le parfait filon pour décrire les relations interpersonnelles d'une manière originale: et si la société s'arrêtait de fonctionner, comment fonctionnerions-nous entre nous? Il y a les besoins de base, et le désir de continuer, de vivre. Or, lorsqu'il n'y a plus d'artifices, il ne reste que le principal, le vrai, le cru. C'est un retour aux monde du "tel quel", parfois dur, parfois simple, mais toujours, pour le lecteur, très nouveau, d'où l'originalité du ton de Christian Guay-Poliquin.
Cet auteur a une écriture simple. Ses histoires ne s'élèvent donc pas par le style, mais par une trame narrative simple et efficace et surtout, une émotion aussi dure et crue que le monde dans lequel tout cette histoire évolue. Le poids le neige est ici celui du désir de vivre, celui de la fatalité et bien souvent le sien propre, son poids, tant en matière de corps que de pensées, d'anxiété, d'espoir. Il existe une tension tout au long de ce livre qui nous rend les personnages attachants et circonspects à la fois. Et c'est sans compter une autre des forces de cet auteur: ses descriptions superbes du temps, de l'environnement, du paysage. On comprendra que l'hiver prend ici toute la place, tellement qu'il en devient aussi un personnage. Les amants de cette saison y retrouveront la beauté et le caractère implacable. Les dénigreurs de l'hiver y trouveront plutôt la raideur et les silences lourds qui poussent à l'introspection. Mais personne ne restera indifférent à ce thriller lent, dur et beau.
Aussi réussi que le Fil des kilomètres, le Poids de la neige confirme le talent d'un auteur qui se démarque par son originalité et qu'il fera bon relire dès que possible.
À lire cet hiver, pour l'ambiance et pour de bons moments de lecture.
Après l'histoire "road movie", c'est l'enfermement. Le contexte "général" demeure: des événements non identifiés font que le monde dans lequel évolue l'histoire se retrouve sans électricité. Les villes sont proies au saccage et tous se retrouvent en mode survie. Mais le terrain est connu. Le narrateur et personnage principal est revenu dans son village d'origine, et comme le titre l'indique, on est en plein hiver, dans un monde de lacs et de forêts denses. Les habitants des latitudes hivernales s'y retrouveront.
Confiné à une convalescence après un accident, le narrateur se retrouve sous la supervision d'un personnage inconnu beaucoup plus âgé que lui. Ce dernier veut quitter le lieu où il se retrouve, comme, d'ailleurs, à peu près tous les habitants du petit village. Mais pour quitter le village au printemps, alors que les routes redeviendront praticables, ce personnage devra s'occuper du narrateur convalescent dont les deux jambes ont été cassées, en retour d'une promesse dans une expédition de départ. Le long rétablissement du blessé deviendra l'espoir de l'aidant à s'en aller. Les deux apprendront à se connaître, pour le meilleur comme pour le pire. Et l'hiver s'étirera jusqu'à ce que le printemps s'amène. Qui s'en sortira le mieux du jeune blessé et du vieux soigneur? Est-ce plutôt l'hiver qui l'emportera? L'espoir d'une vie meilleure? La peur de l'inconnu? Et comment survivront-ils dans un monde devenu sans ressources? Comme avec son premier livre, l'auteur a trouvé le parfait filon pour décrire les relations interpersonnelles d'une manière originale: et si la société s'arrêtait de fonctionner, comment fonctionnerions-nous entre nous? Il y a les besoins de base, et le désir de continuer, de vivre. Or, lorsqu'il n'y a plus d'artifices, il ne reste que le principal, le vrai, le cru. C'est un retour aux monde du "tel quel", parfois dur, parfois simple, mais toujours, pour le lecteur, très nouveau, d'où l'originalité du ton de Christian Guay-Poliquin.
Cet auteur a une écriture simple. Ses histoires ne s'élèvent donc pas par le style, mais par une trame narrative simple et efficace et surtout, une émotion aussi dure et crue que le monde dans lequel tout cette histoire évolue. Le poids le neige est ici celui du désir de vivre, celui de la fatalité et bien souvent le sien propre, son poids, tant en matière de corps que de pensées, d'anxiété, d'espoir. Il existe une tension tout au long de ce livre qui nous rend les personnages attachants et circonspects à la fois. Et c'est sans compter une autre des forces de cet auteur: ses descriptions superbes du temps, de l'environnement, du paysage. On comprendra que l'hiver prend ici toute la place, tellement qu'il en devient aussi un personnage. Les amants de cette saison y retrouveront la beauté et le caractère implacable. Les dénigreurs de l'hiver y trouveront plutôt la raideur et les silences lourds qui poussent à l'introspection. Mais personne ne restera indifférent à ce thriller lent, dur et beau.
Aussi réussi que le Fil des kilomètres, le Poids de la neige confirme le talent d'un auteur qui se démarque par son originalité et qu'il fera bon relire dès que possible.
À lire cet hiver, pour l'ambiance et pour de bons moments de lecture.
samedi 8 octobre 2016
La conjuration des imbéciles, par John Kennedy Toole, éditions 10/18 - Domaine étranger
Ignatius J. Really est un personnage, et là, vous mettez le sens que vous voulez au mot "personnage". Qu'importe ce sens, il sera bon. Bardé de diplômes, Ignatius ne travaille pas et vit chez sa mère. Ignatius ne fout rien et s'en vante. Le travail n'est pas pour lui, ni la télé qu'il regarde toute la journée, ni la vie de sa mère, ni rien de ce qui se passe en ce bas monde, qu'il observe et critique sans cesse. Ignatius critique tout, lui seul a raison, toujours, en toutes choses. Ignatius est docte et vertueux, il joue du luth, il cite des auteurs, et le reste du monde ne vaut rien.
Vivant à la Nouvelle-Orléans, Ignatius et sa mère ne sont pas riches. Évidemment, puisque Ignatius est le défenseur des marginaux, un modèle à suivre, etc. etc. Or voilà, il vit aux crochets de sa mère, qui, elle, vit d'une maigre pension, et voilà que des circonstances font que Mme Reilly et Ignatius auront bientôt besoin d'argent. Ignatius ira donc travailler. Le reste, c'est la Conjuration des imbéciles, vécue par Ignatius J. Reilly.
Vous croirez qu'Ignatius est sans doute un super troll sur Facebook, un assisté social caricatural ou une victime de l'ouragan Katrina. Eh bien non puisque ce livre a été écrit dans les années 70. Son auteur est mort faute de n'avoir pas trouvé d'éditeur pour son livre. Qui s'en est chargé après sa mort? Je vous le donne en mille: sa mère. Et ce fut le succès, voir même le seul prix Pullitzer jamais accordé à un auteur à titre posthume. Récit unique s'il en est un, on le lit sur le bout de sa chaise comme on regarderait un immense vaudeville monté au quart de tour sur une immense scène. Les personnages, les dialogues, les décors: tout est imposant, vif, large. Certaines scènes sont aussi pathétiques que croulantes de rire. Et si on rit, on rit jaune, parce que la misère y est racontée avec tellement de couleurs qu'on en est parfois étourdi. Jamais la Nouvelle-Orléans n'aura été aussi bien racontée et jamais peut-être n'aurez-vous suivi avec autant de délectation les aventures d'un personnage aussi détestable.
Autre tour de force de ce livre: sa traduction. Toutes les revues et les critiques sur ce livre parlent de la langue particulière utilisée par son auteur. J'aurais voulu le lire en anglais pour en voir la facture. En français, en tout cas, il fallait le faire. Parce que Toole donne la parole à de petites gens, souvent sans éducation, par oppositions à d'autres, plus mondains ou comme Ignatius, carrément littéraires. Or, ces dialogues de petites gens sont écrits, et traduits, avec force apostrophes et mots de la langue parlée. Tout Québécois y reconnaîtra inévitablement des traces de Tremblay et de joual tel qu'on l'écrivait dans les années 70 ou 80. Mais attention, c'est traduit par un Français, et c'est très bien fait! Si au début on tique sur "bouligne" ou "bèsebole", on s'apercevra, au fil des pages, que ces mots tiennent beaucoup plus d'une forte ironie et collent très exactement à l'image qu'on peut avoir des personnages. Première fois que je vois ça!
Critique de la société? Peut-être. Mais j'irais plutôt pour "portraits d'un fin observateur de l'espèce humaine", à moins que chacun des personnages, incluant l'infâme Ignatius, soient des pendants de l'auteur lui-même? Allez savoir. Reste qu'on en déduit qu'un tel livre est inévitablement un classique parce qu'il reste vraiment très actuel. Ignatius sévit toujours, sous d'autres identités, et il nous tape énormément. Alors aussi bien en rire... et lire La conjuration des imbéciles.
Qu'il soit précisé que l'édition que j'ai lue date de 1995. Depuis sa parution, internet en recense plusieurs en français. Une des plus récentes semble dater de 2012, chez le même éditeur. Comme quoi le succès se poursuit.
À lire absolument, pour se faire bousculer très fort, mais en riant jaune... et de bon coeur.
Vivant à la Nouvelle-Orléans, Ignatius et sa mère ne sont pas riches. Évidemment, puisque Ignatius est le défenseur des marginaux, un modèle à suivre, etc. etc. Or voilà, il vit aux crochets de sa mère, qui, elle, vit d'une maigre pension, et voilà que des circonstances font que Mme Reilly et Ignatius auront bientôt besoin d'argent. Ignatius ira donc travailler. Le reste, c'est la Conjuration des imbéciles, vécue par Ignatius J. Reilly.
Vous croirez qu'Ignatius est sans doute un super troll sur Facebook, un assisté social caricatural ou une victime de l'ouragan Katrina. Eh bien non puisque ce livre a été écrit dans les années 70. Son auteur est mort faute de n'avoir pas trouvé d'éditeur pour son livre. Qui s'en est chargé après sa mort? Je vous le donne en mille: sa mère. Et ce fut le succès, voir même le seul prix Pullitzer jamais accordé à un auteur à titre posthume. Récit unique s'il en est un, on le lit sur le bout de sa chaise comme on regarderait un immense vaudeville monté au quart de tour sur une immense scène. Les personnages, les dialogues, les décors: tout est imposant, vif, large. Certaines scènes sont aussi pathétiques que croulantes de rire. Et si on rit, on rit jaune, parce que la misère y est racontée avec tellement de couleurs qu'on en est parfois étourdi. Jamais la Nouvelle-Orléans n'aura été aussi bien racontée et jamais peut-être n'aurez-vous suivi avec autant de délectation les aventures d'un personnage aussi détestable.
Autre tour de force de ce livre: sa traduction. Toutes les revues et les critiques sur ce livre parlent de la langue particulière utilisée par son auteur. J'aurais voulu le lire en anglais pour en voir la facture. En français, en tout cas, il fallait le faire. Parce que Toole donne la parole à de petites gens, souvent sans éducation, par oppositions à d'autres, plus mondains ou comme Ignatius, carrément littéraires. Or, ces dialogues de petites gens sont écrits, et traduits, avec force apostrophes et mots de la langue parlée. Tout Québécois y reconnaîtra inévitablement des traces de Tremblay et de joual tel qu'on l'écrivait dans les années 70 ou 80. Mais attention, c'est traduit par un Français, et c'est très bien fait! Si au début on tique sur "bouligne" ou "bèsebole", on s'apercevra, au fil des pages, que ces mots tiennent beaucoup plus d'une forte ironie et collent très exactement à l'image qu'on peut avoir des personnages. Première fois que je vois ça!
Critique de la société? Peut-être. Mais j'irais plutôt pour "portraits d'un fin observateur de l'espèce humaine", à moins que chacun des personnages, incluant l'infâme Ignatius, soient des pendants de l'auteur lui-même? Allez savoir. Reste qu'on en déduit qu'un tel livre est inévitablement un classique parce qu'il reste vraiment très actuel. Ignatius sévit toujours, sous d'autres identités, et il nous tape énormément. Alors aussi bien en rire... et lire La conjuration des imbéciles.
Qu'il soit précisé que l'édition que j'ai lue date de 1995. Depuis sa parution, internet en recense plusieurs en français. Une des plus récentes semble dater de 2012, chez le même éditeur. Comme quoi le succès se poursuit.
À lire absolument, pour se faire bousculer très fort, mais en riant jaune... et de bon coeur.
dimanche 18 septembre 2016
Zero K, par Don De Lillo, éditions Scribner
Un homme descend d'un avion. Le vol a été long et comprenait plusieurs escales. Sans trop savoir où, sur la planète, il a atterri, il se retrouve dans un bâtiment ultra-moderne, un complexe vaste, hyper-techno mais sobre et pur où se retrouvent son père, le commanditaire de ce voyage, et sa conjointe mourante. L'endroit accueille des gens en fin de vie, mais dont la vie se terminera pas. On y exploite un processus de cryogénisation censé faire renaître dans de meilleurs jours et sous de meilleures auspices.
Ce père est un homme d'affaire pour qui tout a réussi. L'idée de perdre sa compagne de vie, belle-mère du narrateur, est pour lui impossible, d'où le recours à ce procédé. C'est son fils qui raconte comment lui et son père se sont retrouvé à cet endroit. Il essaie de comprendre. Entre son père et lui, ça n'a jamais été simple, ne serait-ce que par ce qui s'est passé pour sa mère, première femme de son père, qui l'a laissé tomber il y a plusieurs années. A côté de son père, le fils se sent perdu, voire diminué, sans ambition. Son père était immense, il a toujours décidé de ce qui lui arriverait... jusque dans la mort... C'est le retour du Don De Lillo de White Noize. Il décrit ici, par une métaphore vraiment efficace, le désir de contrôle, le pouvoir inutile de l'argent, la superficialité qu'il entraine. Dans le complexe "mortuaire", se succèdent des personnages franchement fascinants qui, à peu près tous, donnent une impression de malaise vraiment puissante. Parce qu'il est aussi question du rapport de cette société de l'argent avec le religieux, bref, avec tout ce qui représente le contrôle.
L'atmosphère st digne du film Gattaca. Futuriste mais pas trop, on est parachuté dans un monde tellement parfait qu'on en a le vertige et qu'on désire s'en sortir, parce qu'on y étouffe. Le désire de contrôle affronte la liberté, le premier empêche l'autre, et le personnage principal est en plein centre de cette confrontation. C'est le choc des générations, mais aussi celui de deux mondes, le sien et celui de son père. J'y vois aussi une critique brillante de la société américaine actuelle.
Dur, lent, très intérieur, brillant, ce livre de De Lillo saura ravir ses fans, et fera découvrir un grand auteur à ceux qui ne le connaissent pas encore. Zero K n'est pas encore traduit en français.
Ce père est un homme d'affaire pour qui tout a réussi. L'idée de perdre sa compagne de vie, belle-mère du narrateur, est pour lui impossible, d'où le recours à ce procédé. C'est son fils qui raconte comment lui et son père se sont retrouvé à cet endroit. Il essaie de comprendre. Entre son père et lui, ça n'a jamais été simple, ne serait-ce que par ce qui s'est passé pour sa mère, première femme de son père, qui l'a laissé tomber il y a plusieurs années. A côté de son père, le fils se sent perdu, voire diminué, sans ambition. Son père était immense, il a toujours décidé de ce qui lui arriverait... jusque dans la mort... C'est le retour du Don De Lillo de White Noize. Il décrit ici, par une métaphore vraiment efficace, le désir de contrôle, le pouvoir inutile de l'argent, la superficialité qu'il entraine. Dans le complexe "mortuaire", se succèdent des personnages franchement fascinants qui, à peu près tous, donnent une impression de malaise vraiment puissante. Parce qu'il est aussi question du rapport de cette société de l'argent avec le religieux, bref, avec tout ce qui représente le contrôle.
L'atmosphère st digne du film Gattaca. Futuriste mais pas trop, on est parachuté dans un monde tellement parfait qu'on en a le vertige et qu'on désire s'en sortir, parce qu'on y étouffe. Le désire de contrôle affronte la liberté, le premier empêche l'autre, et le personnage principal est en plein centre de cette confrontation. C'est le choc des générations, mais aussi celui de deux mondes, le sien et celui de son père. J'y vois aussi une critique brillante de la société américaine actuelle.
Dur, lent, très intérieur, brillant, ce livre de De Lillo saura ravir ses fans, et fera découvrir un grand auteur à ceux qui ne le connaissent pas encore. Zero K n'est pas encore traduit en français.
lundi 15 août 2016
L'arbre du pays Toraja, par Philippe Claudel, éditions Stock
Une autre histoire racontée au "je". En fait, l'auteur se raconte à travers sa relation avec un ami proche qui lui annonce qu'il a un cancer et qu'il n'en a plus pour longtemps. Secoué, l'auteur vit, parallèlement à cet événement, une rencontre avec une fille beaucoup plus jeune que lui. Entre tout ça, il y a sa vie, qu'il décrit sans trop de tabous dans ses réussites comme ses échecs.
Intime, un peu impudique mais pas trop, Claudel m'a surpris. De lui, je n'avais lu que Le rapport de Brodeck dont l'atmosphère m'a hanté longtemps. On est loin de ça ici. Bien écrit, L'arbre... nous emmène dans les questionnements de l'auteur sur le deuil, la vieillesse, notre rapport au travail, notre contribution au monde.
À première vue, ça ressemble étrangement au ton de D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan. Perso, de tels auto-récits, qu'ils soient fictifs ou pas, tendent à m'agacer un peu. Amateur de fictions, ce mélange de réalité et d'histoires inventées me ne m'attire pas. Je me trouve voyeur en lisant ça, je n'y suis pas super à l'aise. J'avoue avoir ressenti ça tout au long de ce livre, mais j'ai été charmé malgré tout. Parler de deuil n'est plus tellement commun. Le sujet devient de plus en plus tabou. La vieillesse est rarement valorisée, c'est ce que Claudel m'a fait réaliser, mais aussi, que la vieillesse en question, c'est beaucoup plus dans l'oeil de l'autre que dans le sien. On "reste jeune" plus longtemps beaucoup plus grâce à nos esprits ouverts, mois hermétiques qu'avant, et ça, c'est le secret d'une certaine jeunesse éternelle. Le désir de vivre va avec le désir d'apprendre, de découvrir. C'est ce que le narrateur/auteur découvrira en racontant son ami, puis en se racontant lui-même, qui se surprend lui-même à "tomber" dans des histoires que d'aucuns pourraient juger vaines pour toutes sortes de raison.
Philippe Claudel possède une écriture qui rend la réflexion facile. Son ton est sympathique, jamais prétentieux, bref, malgré la profondeur du sujet, il fait du bien de cheminer avec lui. Le titre à lui seul indique une recherche qui rend aussi cet ouvrage encore plus sympathique. Il commence en effet par la description d'une coutume funéraire d'un peuple indonésien inconnu. C'est une belle approche douce pour un sujet qui pourrait pourtant être rude.
Reste que bon... vivement une fiction de Philippe Claudel. Se mettre en scène, oui, mais pas seulement.
Intime, un peu impudique mais pas trop, Claudel m'a surpris. De lui, je n'avais lu que Le rapport de Brodeck dont l'atmosphère m'a hanté longtemps. On est loin de ça ici. Bien écrit, L'arbre... nous emmène dans les questionnements de l'auteur sur le deuil, la vieillesse, notre rapport au travail, notre contribution au monde.
À première vue, ça ressemble étrangement au ton de D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan. Perso, de tels auto-récits, qu'ils soient fictifs ou pas, tendent à m'agacer un peu. Amateur de fictions, ce mélange de réalité et d'histoires inventées me ne m'attire pas. Je me trouve voyeur en lisant ça, je n'y suis pas super à l'aise. J'avoue avoir ressenti ça tout au long de ce livre, mais j'ai été charmé malgré tout. Parler de deuil n'est plus tellement commun. Le sujet devient de plus en plus tabou. La vieillesse est rarement valorisée, c'est ce que Claudel m'a fait réaliser, mais aussi, que la vieillesse en question, c'est beaucoup plus dans l'oeil de l'autre que dans le sien. On "reste jeune" plus longtemps beaucoup plus grâce à nos esprits ouverts, mois hermétiques qu'avant, et ça, c'est le secret d'une certaine jeunesse éternelle. Le désir de vivre va avec le désir d'apprendre, de découvrir. C'est ce que le narrateur/auteur découvrira en racontant son ami, puis en se racontant lui-même, qui se surprend lui-même à "tomber" dans des histoires que d'aucuns pourraient juger vaines pour toutes sortes de raison.
Philippe Claudel possède une écriture qui rend la réflexion facile. Son ton est sympathique, jamais prétentieux, bref, malgré la profondeur du sujet, il fait du bien de cheminer avec lui. Le titre à lui seul indique une recherche qui rend aussi cet ouvrage encore plus sympathique. Il commence en effet par la description d'une coutume funéraire d'un peuple indonésien inconnu. C'est une belle approche douce pour un sujet qui pourrait pourtant être rude.
Reste que bon... vivement une fiction de Philippe Claudel. Se mettre en scène, oui, mais pas seulement.
jeudi 4 août 2016
Nord Alice, de Marc Séguin, éditions Leméac
Le narrateur vient de gagner Kuujjuaq, où il travaillera comme médecin d'urgence à l'hôpital. Son arrivée dans le Grand Nord s'est fait rapidement, sur un coup de tête, après avoir rompu avec son Alice. Tous deux vivaient à New York. Ils y étaient médecins, lui, Québécois, elle, Inuit. Elle est est resté à New York. Lui a décidé d'aller vivre là d'où elle vient, pour l'oublier et travailler comme un déchainé.
Le narrateur se raconte: son bout de vie avec cette femme, sa passion, leur rupture; sa vie dans le Grand Nord, son travail, ses patients, le quotidien à Kuujjuaq, et en parallèle, il nous offre aussi le récit de ses ancêtres, à partir de son arrière-grand père, jusqu'à son père. Ces trois histoires n'en font qu'une et le résultat est absolument brillant.
Lire Marc Séguin ne me tentait pourtant pas tellement. La foi du braconnier, que j'avais lu il y a longtemps, m'avait laissé une impression de "tapage sur les nerfs". Puis bon, aussi, faut bien se l'avouer, c'est de genre de personnage "qui a tout": peintre de talent hyper-reconnu, totalement intéressant en entrevue, beau mec, intelligent, je n'avais sans doute pas envie de le voir aussi réussir en littérature. Et pourtant oui, il le fait, et fort bien.
Son écriture est d'abord très particulière. Les phrases sont courtes. On lit Marc Séguin lentement. On entend son narrateur raconter lentement, on l'entend prendre de grandes respirations entre ses phrases, ses pensées. Avec lui, on est triste dès le départ, fortement triste. Puis on se détache un peu de la difficile rupture en plongeant dans le passé de ses aïeux, en se demandant un peu ce que ça fait là. Puis on retourne au temps présent, où son passé récent avec Alice et son présent de célibataire à Kuujjuaq nous captivent. Les descriptions de la vie dans cette région trop peu connue sont saisissantes. Bon, peut-être que les mésaventures de médecin urgentistes semblent parfois un peu "trop". Tant de drames dans une si petite communauté surprennent un peu. Mais on s'en fout parce qu'au fil des pages, il y a au-delà. On voudrait partir pêcher le saumon ou l'omble de l'Arctique avec lui. On aurait voulu avoir connu son père et au bout du compte, on aimerait qu'il la revoit, son Alice, et qu'il lui dise tout ce qu'il voudrait lui dire. Parce qu'à force, Marc Séguin fait une vibrante démonstration: au fil des siècles et au fil de la vie de son narrateur, oui, le temps fait bien les choses. Il faut lui faire confiance.
J'avoue que ce livre m'a happé. Calme et fort, son ton et son histoire plaira à ceux qui savent ce que vaut une peine pour apprendre sur soi.
Superbe, vraiment.
Le narrateur se raconte: son bout de vie avec cette femme, sa passion, leur rupture; sa vie dans le Grand Nord, son travail, ses patients, le quotidien à Kuujjuaq, et en parallèle, il nous offre aussi le récit de ses ancêtres, à partir de son arrière-grand père, jusqu'à son père. Ces trois histoires n'en font qu'une et le résultat est absolument brillant.
Lire Marc Séguin ne me tentait pourtant pas tellement. La foi du braconnier, que j'avais lu il y a longtemps, m'avait laissé une impression de "tapage sur les nerfs". Puis bon, aussi, faut bien se l'avouer, c'est de genre de personnage "qui a tout": peintre de talent hyper-reconnu, totalement intéressant en entrevue, beau mec, intelligent, je n'avais sans doute pas envie de le voir aussi réussir en littérature. Et pourtant oui, il le fait, et fort bien.
Son écriture est d'abord très particulière. Les phrases sont courtes. On lit Marc Séguin lentement. On entend son narrateur raconter lentement, on l'entend prendre de grandes respirations entre ses phrases, ses pensées. Avec lui, on est triste dès le départ, fortement triste. Puis on se détache un peu de la difficile rupture en plongeant dans le passé de ses aïeux, en se demandant un peu ce que ça fait là. Puis on retourne au temps présent, où son passé récent avec Alice et son présent de célibataire à Kuujjuaq nous captivent. Les descriptions de la vie dans cette région trop peu connue sont saisissantes. Bon, peut-être que les mésaventures de médecin urgentistes semblent parfois un peu "trop". Tant de drames dans une si petite communauté surprennent un peu. Mais on s'en fout parce qu'au fil des pages, il y a au-delà. On voudrait partir pêcher le saumon ou l'omble de l'Arctique avec lui. On aurait voulu avoir connu son père et au bout du compte, on aimerait qu'il la revoit, son Alice, et qu'il lui dise tout ce qu'il voudrait lui dire. Parce qu'à force, Marc Séguin fait une vibrante démonstration: au fil des siècles et au fil de la vie de son narrateur, oui, le temps fait bien les choses. Il faut lui faire confiance.
J'avoue que ce livre m'a happé. Calme et fort, son ton et son histoire plaira à ceux qui savent ce que vaut une peine pour apprendre sur soi.
Superbe, vraiment.
dimanche 26 juin 2016
Il est de retour, par Timur Vermes, éditions Belfond
Il se réveille en 2011 au beau milieu d'un terrain vague de Berlin. C'est lui dans toute son allure et sa pensée, Adolf Hitler, sauf que les gens qui le rencontrent ne le croient pas trop. Or, lui, c'est le pragmatique par excellence: il n'est que ce qu'il est il trouve aberrant qu'on ne le prenne pas au sérieux. Or, le fil de ses rencontres le mènera vers une équipe de télévision qui verra en ce personnage si bien interprété (on le prend pour un comédien), un filon fort exploitable. Dans ce milieu, Hitler trouvera le respect dont il a besoin pour reprendre sa carrière là où il l'a laissée en 1945.
Fallait le faire, c'est indéniable. Bien raconté, Il est de retour est un livre intelligent. Facile? À première vue, je dirais oui, mais il y a quelque chose là qui porte à réflexion. Le livre contient plusieurs scènes où des gens "embarquent" dans le personnage Hitler. Parce que le personnage est connu, bien sur, et la publicité qu'on lui fait est à préparer avec beaucoup de précautions. Or, on dirait que l'époque s'avère propice pour son exploitation. La question qu'on se pose c'est: ah oui, vraiment? La réponse vous appartient. Quant à moi, ça m'effraie.
Si ce livre est d'abord une critique de la société allemande, on ne l'a pas traduit pour rien, puisqu'il rejoint tout le monde. Ça ramène n'importe quel pékin de ce siècle à ce qui est en train de lui arriver, au siècle. Brillant, l'auteur laisse planer un air de jemenfoutisme tout au long de son livre, sauf pour certains, motivés par des visées d'affaires. Si les politiciens ont l'air assez inoffensifs, les faiseurs d'images et les animateurs télés y prennent beaucoup de place. Pendant que la populace laisse aller et que les personnages publics privilégient leurs intérêts personnels et leur image aux détriments du bien commun, d'autres en profitent pour combler le vide en procurant du divertissement dont le but avoué est de se remonter le moral en se moquant des autres. Au bout du compte, l'argent l'emporte bien avant les idées.
Bien traduit, le livre est raconté au "je". C'est Hitler en personne qui raconte ses aventures, tantôt avec perfidie, tantôt avec lucidité. Divertissant, il contient certaines scènes assez épiques comme par exemple, Hitler qui va rencontrer les "dirigeants" d'un parti d'extrême-droite en les engueulant comme c'est pas permis. D'autres personnages valent eux aussi leur pesant d'or, dont sa secrétaire, dont les services sont offerts par la maison de production qui a fini par embaucher Le "comédien" Hitler.
Il est certain que l'auteur nous communique son idée à lui du personnage. On en fait ce qu'on veut. Donner la parole aux morts, en fonction de ce qu'ils ont été, est un peu comme de continuer un tableau qui était pourtant terminé. Pour ne rien gâcher, on en conserve le style, oui, mais le résultat est-il vraiment ce que l'auteur original aurait créé? À chacun de s'en faire une idée. Ne serait-ce que pour ces réflexions, ce livre vaut la peine d'être lu. Si le personnage est historique, le récit, lui, est vraiment de notre époque.
Ah, et pour ceux que ça intéresse, devant le succès du livre, on l'a adapté en film, Er ist wieder da. Sorti en 2015, en voici une bande-annonce d'un peu plus d'une minute (en allemand). Ça donne une bonne idée de l'ambiance.
Fallait le faire, c'est indéniable. Bien raconté, Il est de retour est un livre intelligent. Facile? À première vue, je dirais oui, mais il y a quelque chose là qui porte à réflexion. Le livre contient plusieurs scènes où des gens "embarquent" dans le personnage Hitler. Parce que le personnage est connu, bien sur, et la publicité qu'on lui fait est à préparer avec beaucoup de précautions. Or, on dirait que l'époque s'avère propice pour son exploitation. La question qu'on se pose c'est: ah oui, vraiment? La réponse vous appartient. Quant à moi, ça m'effraie.
Si ce livre est d'abord une critique de la société allemande, on ne l'a pas traduit pour rien, puisqu'il rejoint tout le monde. Ça ramène n'importe quel pékin de ce siècle à ce qui est en train de lui arriver, au siècle. Brillant, l'auteur laisse planer un air de jemenfoutisme tout au long de son livre, sauf pour certains, motivés par des visées d'affaires. Si les politiciens ont l'air assez inoffensifs, les faiseurs d'images et les animateurs télés y prennent beaucoup de place. Pendant que la populace laisse aller et que les personnages publics privilégient leurs intérêts personnels et leur image aux détriments du bien commun, d'autres en profitent pour combler le vide en procurant du divertissement dont le but avoué est de se remonter le moral en se moquant des autres. Au bout du compte, l'argent l'emporte bien avant les idées.
Bien traduit, le livre est raconté au "je". C'est Hitler en personne qui raconte ses aventures, tantôt avec perfidie, tantôt avec lucidité. Divertissant, il contient certaines scènes assez épiques comme par exemple, Hitler qui va rencontrer les "dirigeants" d'un parti d'extrême-droite en les engueulant comme c'est pas permis. D'autres personnages valent eux aussi leur pesant d'or, dont sa secrétaire, dont les services sont offerts par la maison de production qui a fini par embaucher Le "comédien" Hitler.
Il est certain que l'auteur nous communique son idée à lui du personnage. On en fait ce qu'on veut. Donner la parole aux morts, en fonction de ce qu'ils ont été, est un peu comme de continuer un tableau qui était pourtant terminé. Pour ne rien gâcher, on en conserve le style, oui, mais le résultat est-il vraiment ce que l'auteur original aurait créé? À chacun de s'en faire une idée. Ne serait-ce que pour ces réflexions, ce livre vaut la peine d'être lu. Si le personnage est historique, le récit, lui, est vraiment de notre époque.
Ah, et pour ceux que ça intéresse, devant le succès du livre, on l'a adapté en film, Er ist wieder da. Sorti en 2015, en voici une bande-annonce d'un peu plus d'une minute (en allemand). Ça donne une bonne idée de l'ambiance.
mardi 21 juin 2016
L'angoisse du paradis, par Yann Fortier, éditions Marchands de feuilles
C'est l'histoire d'Ivan Zolotov, un citoyen soviétique "bien ordinaire" né et grandi dans la ville de Gorki, ex et future Nijni-Novgorod. Dans une des premières scènes du livre, le jeune Ivan, 10 ans, a réussi à convaincre de son père d'aller au parc d'attractions local pour monter dans la fameuse Terreur de Gorki, une montagne... russe. Son père, un ouvrier "bon employé" d'une méga-usine locale qui fera sa place dans la hiérarchie de l'entreprise, réussit à s'esquiver au moment de monter dans cette chose qui le terrorise. Le tour du petit Ivan dans les montagnes russes est épique. On monte avec lui, on descend, on remonte, sa voisine crie à s'en fendre l'âme puis, quelque chose arrive et on se dit: ok, ce bouquin-là ne sera absolument pas ennuyant.
Et c'est ainsi que s'étale la vie d'Ivan Solotov, à coups de scènes incroyables vécues dans son enfance et sa jeunesse soviétique, puis, plus tard, dans sa vie post-soviétique où une carrière de spécialiste de l'histoire... soviétique l'amène à voyager de par le monde. On va de scène en scène avec la même délectation que dans les montagnes russes. Le ton est celui d'un conteur. À peu de choses près, on est presque chez Jean Échenoz.
Ce premier roman donne le goût d'un second. L'histoire ici dépeinte est celle d'une époque et d'un lieu, la fin du communisme et la Russie, qui n'ont rien de banal mais auxquels on a presque toujours donné une teinte plutôt grisâtre. Les histoires rocambolesques du personnage donnent une toute autre couleur à l'ensemble. C'est comme si on avait recréé un décor à l'image du personnage, comme si on avait décidé de donner de grands coups de pinceaux à une scène terne parce qu'un certain bonhomme y évoluera. Pas que ce soit drôle, enfin, pas seulement, parce qu'en certaines occasions, on ne peut que s'esclaffer. Mais il y a aussi plusieurs choses dans cette histoire qui nous font nous demander quelle est notre place dans le monde, aussi modeste soit-elle. Comme Zolotov, qui traverse continents et situations bizarres avec une naïveté souvent déconcertante, on finit par se rendre compte que eh, nous aussi on fait l'Histoire. Chacun à notre façon, comme lui, finalement. L'angoisse du paradis de Yann Fortier donne aussi son opinion sur ce que devient le monde, et ce particulièrement à la fin où un des derniers chapitres donne place au monologue d'un personnage qui, du Nijni Novgorod où il n'est jamais sorti, s'étend, du haut de ses 90 et quelques années, au début des années 2000, sur la société de consommation dans laquelle son monde est tombé. Ces quelques pages surprennent par le ton différent du reste du livre, comme si l'auteur avait tenu à glisser, dans son histoire complètement divertissante, une critique sociale "obligée", quelque chose qu'il s'était dit qu'il publierait coute que coute. Cette portion du livre est un peu comme si son roman devenait prétexte à y insérer un pamphlet. J'avoue que ça déstabilise, comme si on interrompait un film de Chaplin pour un cinq minutes de messages "retenus et payés par le gouvernement national".
Mais outre ce pamphlet dans le livre, L'angoisse du paradis permet d'espérer un autre ouvrage d'un auteur à l'écriture fleurie et à l'imagination vraiment étourdissante, dans le meilleur des sens.
Vivement d'autres personnages de beaux fous comme ceux-ci. Ah... et mention honorable à la couverture superbe et au format tout en longueur, étroit et extrêmement de cet autre livre des Marchands de feuilles, qui avait déjà frappé fort avec La femme qui fuit.
Et c'est ainsi que s'étale la vie d'Ivan Solotov, à coups de scènes incroyables vécues dans son enfance et sa jeunesse soviétique, puis, plus tard, dans sa vie post-soviétique où une carrière de spécialiste de l'histoire... soviétique l'amène à voyager de par le monde. On va de scène en scène avec la même délectation que dans les montagnes russes. Le ton est celui d'un conteur. À peu de choses près, on est presque chez Jean Échenoz.
Ce premier roman donne le goût d'un second. L'histoire ici dépeinte est celle d'une époque et d'un lieu, la fin du communisme et la Russie, qui n'ont rien de banal mais auxquels on a presque toujours donné une teinte plutôt grisâtre. Les histoires rocambolesques du personnage donnent une toute autre couleur à l'ensemble. C'est comme si on avait recréé un décor à l'image du personnage, comme si on avait décidé de donner de grands coups de pinceaux à une scène terne parce qu'un certain bonhomme y évoluera. Pas que ce soit drôle, enfin, pas seulement, parce qu'en certaines occasions, on ne peut que s'esclaffer. Mais il y a aussi plusieurs choses dans cette histoire qui nous font nous demander quelle est notre place dans le monde, aussi modeste soit-elle. Comme Zolotov, qui traverse continents et situations bizarres avec une naïveté souvent déconcertante, on finit par se rendre compte que eh, nous aussi on fait l'Histoire. Chacun à notre façon, comme lui, finalement. L'angoisse du paradis de Yann Fortier donne aussi son opinion sur ce que devient le monde, et ce particulièrement à la fin où un des derniers chapitres donne place au monologue d'un personnage qui, du Nijni Novgorod où il n'est jamais sorti, s'étend, du haut de ses 90 et quelques années, au début des années 2000, sur la société de consommation dans laquelle son monde est tombé. Ces quelques pages surprennent par le ton différent du reste du livre, comme si l'auteur avait tenu à glisser, dans son histoire complètement divertissante, une critique sociale "obligée", quelque chose qu'il s'était dit qu'il publierait coute que coute. Cette portion du livre est un peu comme si son roman devenait prétexte à y insérer un pamphlet. J'avoue que ça déstabilise, comme si on interrompait un film de Chaplin pour un cinq minutes de messages "retenus et payés par le gouvernement national".
Mais outre ce pamphlet dans le livre, L'angoisse du paradis permet d'espérer un autre ouvrage d'un auteur à l'écriture fleurie et à l'imagination vraiment étourdissante, dans le meilleur des sens.
Vivement d'autres personnages de beaux fous comme ceux-ci. Ah... et mention honorable à la couverture superbe et au format tout en longueur, étroit et extrêmement de cet autre livre des Marchands de feuilles, qui avait déjà frappé fort avec La femme qui fuit.
dimanche 22 mai 2016
Les humeurs insolubles, par Paolo Giordano, éditions du Seuil
Le narrateur et sa compagne ont eu besoin d'un peu d'aide après la naissance de leur premier enfant. Aussi ont-ils engagés Madame A. comme femme à tout faire pour s'occuper de leur logis, puis bientôt de leur enfant. Discrète dans son quotidien, vivant dans un monde on ne peut plus simple, cette veuve un peu rustre s'avérera une aide précieuse, et petit à petit, exaspérante et un peu lourdaude, elle deviendra essentielle à la vie de ce couple de professionnels italiens fort occupés. En fait, ils prendront pleinement conscience de la place de madame A. dans leur vie lorsque cette dernière leur apprendra qu'elle quitte son emploi. Cette nouvelle choc sera précédée d'une autre encore bien plus grave: bientôt, Madame A. va mourrir.
Ce court livre est un petit trésor. Écrit tout en retenue, émotif sans tomber dans le sirupeux, il aborde un sujet dont on ne sait plus tellement que penser: le deuil.
Avec l'orée de la mort, viennent les bilans plus ou moins utiles, les questions qu'on se pose sur celui qui va mourir et par le fait même, sur soi. On constate des choses, comme si la fin d'une vie donnait plus de place à la nôtre. C'est ce que raconte le narrateur, un scientifique dont la vie n'a rien d'extraordinaire. Comme celle da la bonne Madame A., sans éclats, qui s'éteint tranquillement sans rien demander, ni rien faire. Même son petit patrimoine, amassé au cours d'une vie où un court amour a empreint le reste de ses jours, restera sans attention. Le narrateur le lui reproche. Souvent, il dira de Madame A. qu'elle ne s'occupe pas assez de ses affaires, qu'elle va rater sa sortie, bref, il lui reprochera autant de choses qu'il vit ou qu'il pourrait bien vivre lui-même.
Puis il y a l'amour, celui d'un homme pour une femme, d'un couple pour son enfant, de deux jeunes professionnels pour une vieille dame de classe bien moins que moyenne. Tout ça dure-t-il? Et comme la vie, faut-il travailler et se battre pour poursuivre tout ça? Car sinon, que reste-t-il sinon la fin de quelque chose?
En peu de pages de mots, Paolo Giordano fait le tour de ces grandes questions avec énormément de grâce. La fin a quelque chose de celle de Paul à Québec. Les lecteurs de ce nouveau monument de la littérature québécoise ne peuvent que s'en souvenir. Ici, dans Les humeurs insolubles, on reste sur la même impression de tristesse et de grandeur, un sentiment fort, mais doux et vraiment très beau.
Hyper bien traduit, la langue est belle, berçante, et efficace parce qu'absolument pas ennuyante. En ce sens, Paolo Giordano me ramène à Baricco, Calvino et de ces quelques auteurs italiens que j'aime énormément.
Quelle belle découverte à faire pendant l'été!
Ce court livre est un petit trésor. Écrit tout en retenue, émotif sans tomber dans le sirupeux, il aborde un sujet dont on ne sait plus tellement que penser: le deuil.
Avec l'orée de la mort, viennent les bilans plus ou moins utiles, les questions qu'on se pose sur celui qui va mourir et par le fait même, sur soi. On constate des choses, comme si la fin d'une vie donnait plus de place à la nôtre. C'est ce que raconte le narrateur, un scientifique dont la vie n'a rien d'extraordinaire. Comme celle da la bonne Madame A., sans éclats, qui s'éteint tranquillement sans rien demander, ni rien faire. Même son petit patrimoine, amassé au cours d'une vie où un court amour a empreint le reste de ses jours, restera sans attention. Le narrateur le lui reproche. Souvent, il dira de Madame A. qu'elle ne s'occupe pas assez de ses affaires, qu'elle va rater sa sortie, bref, il lui reprochera autant de choses qu'il vit ou qu'il pourrait bien vivre lui-même.
Puis il y a l'amour, celui d'un homme pour une femme, d'un couple pour son enfant, de deux jeunes professionnels pour une vieille dame de classe bien moins que moyenne. Tout ça dure-t-il? Et comme la vie, faut-il travailler et se battre pour poursuivre tout ça? Car sinon, que reste-t-il sinon la fin de quelque chose?
En peu de pages de mots, Paolo Giordano fait le tour de ces grandes questions avec énormément de grâce. La fin a quelque chose de celle de Paul à Québec. Les lecteurs de ce nouveau monument de la littérature québécoise ne peuvent que s'en souvenir. Ici, dans Les humeurs insolubles, on reste sur la même impression de tristesse et de grandeur, un sentiment fort, mais doux et vraiment très beau.
Hyper bien traduit, la langue est belle, berçante, et efficace parce qu'absolument pas ennuyante. En ce sens, Paolo Giordano me ramène à Baricco, Calvino et de ces quelques auteurs italiens que j'aime énormément.
Quelle belle découverte à faire pendant l'été!
mardi 17 mai 2016
D'après une histoire vraie, par Delphine de Vigan, éditions JCLattès
Delphine de Vigan a remporté le prix Renaudot pour ce livre en 2015. Dans un certain sens, c'est assez étonnant. Dans un autre, ce l'est peut-être un peu moins, mais je n'en suis pas certain.
En tout cas on en disait beaucoup de bien. Déjà que Rien ne s'oppose à la nuit, son dernier ouvrage, était tout simplement renversant, on s'imaginait mal une récidive aussi forte. C'est peut-être le cas. de Vigan écrit de façon limpide, claire, avec assez peu de dialogues et beaucoup de descriptions. J'adore. Quant à l'histoire, il faut bien le dire, c'est fort. Très fort, mais n'empêche, j'ai eu un peu de mal à avaler. J'ai beau y repenser, me tâter, et encore, y'a un os.
L'auteure raconte une histoire autobiographique qui lui est justement arrivée juste après la parution de son dernier roman. Il faut savoir que ce dernier racontait la vie mouvementée de sa mère, ce qui a irrémédiablement eu des conséquences sur les proches des deux protagonistes, sujet et auteure. Cette dernière trouve difficile de vivre la forte réception qu'on fait à son livre. C'est alors qu'elle rencontre celle qui deviendra sa nouvelle amie. Enfin, si on peut dire, puisque cette nouvelle amie s'immiscera petit à petit dans la vie de l'auteure jusqu'à en prendre le contrôle. L'intérêt là-dedans est que de Vigan parle de comment elle vit le succès, comment elle perçoit son métier d'écrivain et aussi, et surtout, comment elle fait s'affronter fiction et réalité. Sa "nouvelle amie" lui reproche ses livres antérieurs qui donnent dans la fiction. Selon elle, Delphine devrait faire une suite à Rien ne s'oppose... et poursuivre ses confidences parce que la fiction, eh ben c'est out, les gens n'aiment plus.
Bon.
Quelle histoire, il faut se l'avouer. J'ai pourtant lu le premier tiers de ce livre en me demandant si je me rendrais jusqu'à la fin. Il y avait dans tout ça une part d'invraisemblable qui m'énervait au possible. "Comment, me demandais-je, une femme pouvait se laisser entrainer dans un tel bordel. Pourtant, la narratrice avoue avoir vécu une dépression, épisode pendant laquelle elle a été particulièrement vulnérable. Et pourtant, ni son amoureux ni ses deux enfants, récemment partis de la maison, ne sauront rien. N'empêche qu'à force, j'ai embarqué dans son histoire, jusqu'à passer un après-midi complet à en lire le dernier tiers. Je voulais voir où ça menait. À la fin, oui, ok, j'ai décrété que c'était un bon livre, mais pour une raison particulière, je reste avec un malaise. Et si une telle histoire était invraisemblable pour une raison culturelle, à moins qu'il ne s'agisse de genre? Pourquoi ai-je lu tout ça sans total abandon? En fait,l'auteure a-t-elle écrit une fiction ou est-ce le récit d'une histoire vraie?
Ce livre provoque inévitablement la discussion, et c'en est là toute l'intelligence. Si l'auteure a voulu me laisser avec toutes ces questions: chapeau. Sinon, ben voilà, chapeau quand même.
Si vous désirez en savoir plus, laissez Delphine de Vigan vous l'expliquer elle-même!
En tout cas on en disait beaucoup de bien. Déjà que Rien ne s'oppose à la nuit, son dernier ouvrage, était tout simplement renversant, on s'imaginait mal une récidive aussi forte. C'est peut-être le cas. de Vigan écrit de façon limpide, claire, avec assez peu de dialogues et beaucoup de descriptions. J'adore. Quant à l'histoire, il faut bien le dire, c'est fort. Très fort, mais n'empêche, j'ai eu un peu de mal à avaler. J'ai beau y repenser, me tâter, et encore, y'a un os.
L'auteure raconte une histoire autobiographique qui lui est justement arrivée juste après la parution de son dernier roman. Il faut savoir que ce dernier racontait la vie mouvementée de sa mère, ce qui a irrémédiablement eu des conséquences sur les proches des deux protagonistes, sujet et auteure. Cette dernière trouve difficile de vivre la forte réception qu'on fait à son livre. C'est alors qu'elle rencontre celle qui deviendra sa nouvelle amie. Enfin, si on peut dire, puisque cette nouvelle amie s'immiscera petit à petit dans la vie de l'auteure jusqu'à en prendre le contrôle. L'intérêt là-dedans est que de Vigan parle de comment elle vit le succès, comment elle perçoit son métier d'écrivain et aussi, et surtout, comment elle fait s'affronter fiction et réalité. Sa "nouvelle amie" lui reproche ses livres antérieurs qui donnent dans la fiction. Selon elle, Delphine devrait faire une suite à Rien ne s'oppose... et poursuivre ses confidences parce que la fiction, eh ben c'est out, les gens n'aiment plus.
Bon.
Quelle histoire, il faut se l'avouer. J'ai pourtant lu le premier tiers de ce livre en me demandant si je me rendrais jusqu'à la fin. Il y avait dans tout ça une part d'invraisemblable qui m'énervait au possible. "Comment, me demandais-je, une femme pouvait se laisser entrainer dans un tel bordel. Pourtant, la narratrice avoue avoir vécu une dépression, épisode pendant laquelle elle a été particulièrement vulnérable. Et pourtant, ni son amoureux ni ses deux enfants, récemment partis de la maison, ne sauront rien. N'empêche qu'à force, j'ai embarqué dans son histoire, jusqu'à passer un après-midi complet à en lire le dernier tiers. Je voulais voir où ça menait. À la fin, oui, ok, j'ai décrété que c'était un bon livre, mais pour une raison particulière, je reste avec un malaise. Et si une telle histoire était invraisemblable pour une raison culturelle, à moins qu'il ne s'agisse de genre? Pourquoi ai-je lu tout ça sans total abandon? En fait,l'auteure a-t-elle écrit une fiction ou est-ce le récit d'une histoire vraie?
Ce livre provoque inévitablement la discussion, et c'en est là toute l'intelligence. Si l'auteure a voulu me laisser avec toutes ces questions: chapeau. Sinon, ben voilà, chapeau quand même.
Si vous désirez en savoir plus, laissez Delphine de Vigan vous l'expliquer elle-même!
samedi 7 mai 2016
Les nouvelles enquêtes de Monsieur Proust, par Pierre-Yves Leprince, éditions Gallimard
Prenez ce titre tel qu'il est. Chaque mot y est exact: il s'agit bien d'enquêtes, ce ne sont pas les premières, et elles sont bel et bien menées par Marcel Proust. Tout ce qu'il manque à ce titre, c'est quelque chose comme: ... avec Noël.
Il va bientôt avoir cent ans. Noël se remémore sa rencontre avec Marcel Proust. L'écrivain avait dans la trentaine, Noël, presque 20 ans. Jeune employé dans une entreprise de détectives privés, il mènera, à temps perdu (mots choisis) des enquêtes sur des personnages connus par Monsieur Proust. Mais pourquoi, me demanderez-vous? C'est que le Noël en question est devenu ami avec l'écrivain. Ce dernier l'a pris en amitié et malgré leur différence d'âge, mais aussi, et surtout, malgré leur différence de milieu, chacun intriguera l'autre.
Ce récit est on ne peut plus sympathique, charmant, et passionnant. Oui, il est question de la personnalité jugée "originale" de Monsieur Proust. Oui, son jeune ami sera au fait des préférences de son ami et non, il ne se passera rien, sans pour autant qu'il n'en soit pas question. Ce livre stupéfiant de récits stupéfiants est un réquisitoire pour l'ouverture d'esprit. À travers les petites enquêtes plus ou moins policières, on découvrira surtout l'amour d'un auteur pour un autre auteur, et juste pour ça, le livre vaut la peine d'être lu.
Et pourtant, j'avoue ne pas avoir lu Proust. Bon peut-être, oui, dans ma jeune vingtaine, je me souviens d'avoir tenu À la recherche du temps perdu dans mes mains mais je n'ai aucun souvenir ni de sa lecture ni de ce que j'ai bien pu faire de ce livre. Or, Leprince me fait réaliser ce qui a pu m'arriver. Il nous parle de Proust comme d'un homme tellement conscient de tout, tellement à l'écoute, à l'affut, que son oeuvre contient le résultat de ses observations. Or, si on n'est pas conscient de ça, on risque de le trouver soit pompeux, soit vraiment très lourd.
J'avoue que ça m'a donné envie de lire Proust... mais franc avec vous, je ne le pourrai pas, trop à l'affut moi-même de tout ce qui s'écrit de nos jours. Il y a tant à lire à notre époque... mais n'empêche. Cette incursion dans la pensée et l'époque de Marcel Proust m'a fait le visiter d'une bien jolie façon.
Tiens, si vous désirez en savoir plus sur ce qui a pu pousser Leprince à développer un tel thème, regardez cette courte entrevue où il parle du livre qui a précédé Les nouvelles enquêtes...
Il va bientôt avoir cent ans. Noël se remémore sa rencontre avec Marcel Proust. L'écrivain avait dans la trentaine, Noël, presque 20 ans. Jeune employé dans une entreprise de détectives privés, il mènera, à temps perdu (mots choisis) des enquêtes sur des personnages connus par Monsieur Proust. Mais pourquoi, me demanderez-vous? C'est que le Noël en question est devenu ami avec l'écrivain. Ce dernier l'a pris en amitié et malgré leur différence d'âge, mais aussi, et surtout, malgré leur différence de milieu, chacun intriguera l'autre.
Ce récit est on ne peut plus sympathique, charmant, et passionnant. Oui, il est question de la personnalité jugée "originale" de Monsieur Proust. Oui, son jeune ami sera au fait des préférences de son ami et non, il ne se passera rien, sans pour autant qu'il n'en soit pas question. Ce livre stupéfiant de récits stupéfiants est un réquisitoire pour l'ouverture d'esprit. À travers les petites enquêtes plus ou moins policières, on découvrira surtout l'amour d'un auteur pour un autre auteur, et juste pour ça, le livre vaut la peine d'être lu.
Et pourtant, j'avoue ne pas avoir lu Proust. Bon peut-être, oui, dans ma jeune vingtaine, je me souviens d'avoir tenu À la recherche du temps perdu dans mes mains mais je n'ai aucun souvenir ni de sa lecture ni de ce que j'ai bien pu faire de ce livre. Or, Leprince me fait réaliser ce qui a pu m'arriver. Il nous parle de Proust comme d'un homme tellement conscient de tout, tellement à l'écoute, à l'affut, que son oeuvre contient le résultat de ses observations. Or, si on n'est pas conscient de ça, on risque de le trouver soit pompeux, soit vraiment très lourd.
J'avoue que ça m'a donné envie de lire Proust... mais franc avec vous, je ne le pourrai pas, trop à l'affut moi-même de tout ce qui s'écrit de nos jours. Il y a tant à lire à notre époque... mais n'empêche. Cette incursion dans la pensée et l'époque de Marcel Proust m'a fait le visiter d'une bien jolie façon.
Tiens, si vous désirez en savoir plus sur ce qui a pu pousser Leprince à développer un tel thème, regardez cette courte entrevue où il parle du livre qui a précédé Les nouvelles enquêtes...
jeudi 28 avril 2016
Envoyée spéciale, par Jean Échenoz, éditions de Minuit
Louis vit fort bien de ses royalties. Il y a une vingtaine d'années, il a "commis" un tube, vous savez, le genre de truc qui a joué tout l'été à la radio, et qu'on a traduit ensuite dans toutes les langues... Maintenant, il vit assez calmement avec sa femme, l'interprète du succès en question, tout en rêvant d'un éventuel retour sous les projecteurs.
Or voilà, sa femme est enlevée et on demande rançon. Un peu préoccupé, quand même, Louis demandera conseil à son demi-frère d'avocat qui lui suggérera d'attendre un peu. Puis, les choses faisant que, il en viendra à oublier la pauvre victime, sa vie n'était finalement pas si compliquée que ça, quoi que...
Pendant ce temps-là, la victime en question est séquestrée par des ravisseurs qui s'avéreront charmants, même si un peu gauches et pas très fiables aux yeux de leurs patrons, les commanditaires de l'enlèvement. Or, pendant que victime et bourreaux revisitent le syndrome de Stockholm, les commanditaires, eux, sont satisfaits. Mais pourquoi, au fait, on-ils commandité cette affaire bizarre?
La suite vous tiendra sur le bout de votre chaise. Outre les personnages ci-haut décrit, d'autres s'ajouteront à ce qui deviendra bientôt un espèce de James Bond à tendance burlesque où des destins se retrouveront liés d'étranges façons. Parce qu'il s'agit de Jean Échenoz, on ne s'ennuie pas côté narration. Le narrateur, c'est nous, c'est à dire, lui, l'auteur, et nous, le lecteur, aussi se passe-t-on souvent des commentaires sur les personnages, ce qui est en train de se passer, sur ce qui va peut-être se passer, etc.
Passé maître dans l'art de raconter une histoire, Échenoz tombe ici dans le genre policier. Différent de ce que j'ai lu de lui avant, cette Envoyée spéciale constitue, à mon sens, son oeuvre la plus désopilante. Dans un style qui me rappelle beaucoup Eduardo Mendoza, ou se retrouvera souvent à rire bien que le sang coule à flots à quelques occasions. Cruels, mais épouvantablement pathétiques, les personnages les "pires" ne vous empêcheront pas de dormir. À tout le moins voudrez lire encore quelques pages pour savoir ce qu'il pourra bien arriver à la pauvre fille qu'on finira par emmener dans un des environnements les plus inusités qui soient sur Terre, en même temps que ses ravisseurs, victimes eux-mêmes de gens bien plus mal intentionnés qu'eux.
Histoire hilarante et hyper-active basée sur les relations dominants/dominés, Envoyée spéciale, en plus de nous divertir un bon coup, nous montre que dans nos vies, quelles qu'elles soient, si on a quelqu'un sur le dos, c'est qu'on l'a généralement choisi... à moins de vivre dans un régime totalitaire... mais je n'en dis pas plus.
Divertissement garanti, pour les fans d'Échenoz autant que pour ceux qui le découvriront une première fois.
Or voilà, sa femme est enlevée et on demande rançon. Un peu préoccupé, quand même, Louis demandera conseil à son demi-frère d'avocat qui lui suggérera d'attendre un peu. Puis, les choses faisant que, il en viendra à oublier la pauvre victime, sa vie n'était finalement pas si compliquée que ça, quoi que...
Pendant ce temps-là, la victime en question est séquestrée par des ravisseurs qui s'avéreront charmants, même si un peu gauches et pas très fiables aux yeux de leurs patrons, les commanditaires de l'enlèvement. Or, pendant que victime et bourreaux revisitent le syndrome de Stockholm, les commanditaires, eux, sont satisfaits. Mais pourquoi, au fait, on-ils commandité cette affaire bizarre?
La suite vous tiendra sur le bout de votre chaise. Outre les personnages ci-haut décrit, d'autres s'ajouteront à ce qui deviendra bientôt un espèce de James Bond à tendance burlesque où des destins se retrouveront liés d'étranges façons. Parce qu'il s'agit de Jean Échenoz, on ne s'ennuie pas côté narration. Le narrateur, c'est nous, c'est à dire, lui, l'auteur, et nous, le lecteur, aussi se passe-t-on souvent des commentaires sur les personnages, ce qui est en train de se passer, sur ce qui va peut-être se passer, etc.
Passé maître dans l'art de raconter une histoire, Échenoz tombe ici dans le genre policier. Différent de ce que j'ai lu de lui avant, cette Envoyée spéciale constitue, à mon sens, son oeuvre la plus désopilante. Dans un style qui me rappelle beaucoup Eduardo Mendoza, ou se retrouvera souvent à rire bien que le sang coule à flots à quelques occasions. Cruels, mais épouvantablement pathétiques, les personnages les "pires" ne vous empêcheront pas de dormir. À tout le moins voudrez lire encore quelques pages pour savoir ce qu'il pourra bien arriver à la pauvre fille qu'on finira par emmener dans un des environnements les plus inusités qui soient sur Terre, en même temps que ses ravisseurs, victimes eux-mêmes de gens bien plus mal intentionnés qu'eux.
Histoire hilarante et hyper-active basée sur les relations dominants/dominés, Envoyée spéciale, en plus de nous divertir un bon coup, nous montre que dans nos vies, quelles qu'elles soient, si on a quelqu'un sur le dos, c'est qu'on l'a généralement choisi... à moins de vivre dans un régime totalitaire... mais je n'en dis pas plus.
Divertissement garanti, pour les fans d'Échenoz autant que pour ceux qui le découvriront une première fois.
jeudi 7 avril 2016
La femme qui fuit, par Anaïs Barbeau-Lavalette, éditions du Marchand de feuilles
Depuis que je tiens ce blogue, c'est la première fois où tant de gens me parlent du même livre ou me le recommandent. Le fait est à noter, parce que la plupart de ces recommandations ne m'ont pas été faites à titre de blogueur mais de connaissance ou d'ami. Même une illustre inconnue, fait rare, a interrompu ma lecture dans le transport en commun pour me dire combien elle avait aimé ce livre.
Ce récit de la vie de l'aïeule de l'auteure n'a pourtant rien du scénario typique du best seller avec un happy end, parce qu'il s'agit d'une histoire dure, pas horrible, mais dure et aussi, et surtout, absolument fascinante.
La femme ici décrite a d'abord vécu des événements qui ont contribué à faire la société québécoise moderne, mais aussi l'américaine. Ces moments bien personnels de portions de l'Histoire collective me font inévitablement penser à L'année la plus longue, de Daniel Grenier, une oeuvre de fiction où un homme vit des moments marquants de l'Histoire nord-américaine... répartis sur environ 400 ans. Or ici, ça c'est bel et bien passé, mais sur quelque 80 ans, et ça c'est vécu fatalement, comme si cette femme avait été une espèce de bille dans une machine à boules, projetée dans le monde sans vraiment l'avoir voulu. Les conséquences seront tragiques pour elle et sa famille, oui, mais n'en demeure pas moins que ces circonstances auront aussi contribué à faire non seulement l'Histoire, mais aussi ces mêmes membres de sa famille, incluant l'auteure de ce récit. Hérédité, inspiration, je ne saurais dire, mais lorsqu'on regarde les oeuvres de la fille et de la petite fille de cette femme qui a fuit, on se dit qu'inévitablement, quelques chose a été transmis.
Femme d'un des signataires du Refus global, un manifeste réclamant plus de liberté au Québec, signé à Montréal à la fin des années 40 par des artistes considérés alors comme totalement dans la marge, la protagoniste se retrouvera ensuite en Europe et aux USA où elle participera à la Freedom Ride qui la mènera de New York jusqu'en Alabama. Riche de toutes ces histoires, revenue dans son pays natal, elle restera victime de la sienne, son histoire, et de l'interprétation qu'elle en fait, en fuyant constamment les gens et les événements. Voilà pourquoi ce récit réhabilite ni plus ni moins une femme qui s'est sans doute perçu comme une victime des mêmes gens et des mêmes événements. Incapable de vivre selon les normes de la société, elle donnera l'impression d'avoir été en avance sur son temps. Et pourtant non. Certains personnes comme elle sont seulement trop libres pour être portées par les conventions, et c'est d'autant plus remarquable lorsqu'il s'agit d'une femme ayant vécu les années 40 et 50 au Québec.
Cette histoire est donc racontée de la perspective de la petite fille de la femme en question. Le style surprend parce qu'écris au "tu". Au début, on se sent témoins d'un règlement de compte entre deux personnes assis l'une en face de l'autre. On ressent un malaise. Pour ma part, je ne savais pas trop si j'aimais ça. Puis l'histoire s'est développé, celle de la rencontre des gens du Refus global a embarqué et j'ai été totalement happé, jusqu'à ne plus être influencé par ce style particulier qui, avouons-le, ajoute au tragique. Oui, c'était un bon choix de la part de l'auteure.
Une dernière anecdote
Je suis content d'avoir lu Les maisons, de Fanny Britt, juste avant La femme qui fuit. Ces deux livres nous font vivre exactement les mêmes émotions de malaise en racontant pourtant des histoires tout aussi exactement opposées. Dans Les maisons, on a une femme trop en contrôle dans sa vie ordinaire qu'elle rêve de fuir en vivant plus de liberté. Dans La femme qui fuit, on en a une autre qui est tellement libre qu'elle ne veut que fuir tout ce qui pourrait l'empêcher de rester elle-même. Attendez... à moins qu'il ne s'agisse de la même histoire, mais raconté différemment? En tout cas, si vous pouvez lire les deux un à la suite de l'autre, je vous prédis une fort belle période de lecture.
Un livre de l'Histoire... avec une histoire à lire absolument.
Ce récit de la vie de l'aïeule de l'auteure n'a pourtant rien du scénario typique du best seller avec un happy end, parce qu'il s'agit d'une histoire dure, pas horrible, mais dure et aussi, et surtout, absolument fascinante.
La femme ici décrite a d'abord vécu des événements qui ont contribué à faire la société québécoise moderne, mais aussi l'américaine. Ces moments bien personnels de portions de l'Histoire collective me font inévitablement penser à L'année la plus longue, de Daniel Grenier, une oeuvre de fiction où un homme vit des moments marquants de l'Histoire nord-américaine... répartis sur environ 400 ans. Or ici, ça c'est bel et bien passé, mais sur quelque 80 ans, et ça c'est vécu fatalement, comme si cette femme avait été une espèce de bille dans une machine à boules, projetée dans le monde sans vraiment l'avoir voulu. Les conséquences seront tragiques pour elle et sa famille, oui, mais n'en demeure pas moins que ces circonstances auront aussi contribué à faire non seulement l'Histoire, mais aussi ces mêmes membres de sa famille, incluant l'auteure de ce récit. Hérédité, inspiration, je ne saurais dire, mais lorsqu'on regarde les oeuvres de la fille et de la petite fille de cette femme qui a fuit, on se dit qu'inévitablement, quelques chose a été transmis.
Femme d'un des signataires du Refus global, un manifeste réclamant plus de liberté au Québec, signé à Montréal à la fin des années 40 par des artistes considérés alors comme totalement dans la marge, la protagoniste se retrouvera ensuite en Europe et aux USA où elle participera à la Freedom Ride qui la mènera de New York jusqu'en Alabama. Riche de toutes ces histoires, revenue dans son pays natal, elle restera victime de la sienne, son histoire, et de l'interprétation qu'elle en fait, en fuyant constamment les gens et les événements. Voilà pourquoi ce récit réhabilite ni plus ni moins une femme qui s'est sans doute perçu comme une victime des mêmes gens et des mêmes événements. Incapable de vivre selon les normes de la société, elle donnera l'impression d'avoir été en avance sur son temps. Et pourtant non. Certains personnes comme elle sont seulement trop libres pour être portées par les conventions, et c'est d'autant plus remarquable lorsqu'il s'agit d'une femme ayant vécu les années 40 et 50 au Québec.
Cette histoire est donc racontée de la perspective de la petite fille de la femme en question. Le style surprend parce qu'écris au "tu". Au début, on se sent témoins d'un règlement de compte entre deux personnes assis l'une en face de l'autre. On ressent un malaise. Pour ma part, je ne savais pas trop si j'aimais ça. Puis l'histoire s'est développé, celle de la rencontre des gens du Refus global a embarqué et j'ai été totalement happé, jusqu'à ne plus être influencé par ce style particulier qui, avouons-le, ajoute au tragique. Oui, c'était un bon choix de la part de l'auteure.
Une dernière anecdote
Je suis content d'avoir lu Les maisons, de Fanny Britt, juste avant La femme qui fuit. Ces deux livres nous font vivre exactement les mêmes émotions de malaise en racontant pourtant des histoires tout aussi exactement opposées. Dans Les maisons, on a une femme trop en contrôle dans sa vie ordinaire qu'elle rêve de fuir en vivant plus de liberté. Dans La femme qui fuit, on en a une autre qui est tellement libre qu'elle ne veut que fuir tout ce qui pourrait l'empêcher de rester elle-même. Attendez... à moins qu'il ne s'agisse de la même histoire, mais raconté différemment? En tout cas, si vous pouvez lire les deux un à la suite de l'autre, je vous prédis une fort belle période de lecture.
Un livre de l'Histoire... avec une histoire à lire absolument.
mardi 29 mars 2016
Les maisons, par Fanny Britt, éditions Le Cheval d'août
Fanny Britt est surtout connue au Québec pour son apport au monde du théâtre. Pour ma part, j'ai surtout remarqué ses traductions de pièces d'auteurs britanniques. C'était toujours percutant, fort et sensible. Ce premier roman est marqué des mêmes sceaux.
J'ai beaucoup entendu parler de ce livre avant de le lire, aussi je savais déjà qu'il s'agissait de l'histoire d'une agent d'immeuble qui faisait la rencontre d'un ancien amant, pour ne pas dire d'un amour de jeunesse. Cette colonne vertébrale est ce qui, de toute évidence, a le plus retenu l'attention. Pour ma part, c'est toute la chaire autour de cet os qui m'a frappé. Bien plus que l'histoire d'amours fragiles, j'ai vu dans ce livre le portrait d'une époque, la nôtre, et j'ai trouvé ce portrait non seulement très juste mais aussi très vrai.
Oui, l'agent immeuble en question rencontrera son ancien amant. Ce gars-là est devenu, avec la distance amenée par le temps, un idéal, une histoire qu'elle n'a jamais pu terminer, enfin, qu'elle n'a pas vu se terminer comme elle l'aurait souhaité. Aussi l'a-t-elle magnifiée avec le temps. De toute évidence, cette histoire qu'elle s'était inventée, ce "et si ça avait continué", l'aidait à combler un vide, mais lequel?
La fille est pourtant aimée de ses enfants et de son conjoint. Sa carrière va bon train, bref, le présent lui sourit, jusqu'à ce qu'apparaisse ce mec surgit du passé. Alors l'auteure part explorer le passé de son personnage, un passé d'enfant du divorce, élevée, avec son frère, par une mère-courage misérabiliste. Sortie de sa petite ville de région (L'Abitibi) pour gagner Montréal, celle dernière vivra dans un perpétuel renoncement plus ou moins pathétique qui procurera le matériel dont ses enfants auront besoin, sauf peut-être un élément tout aussi essentiel: la faculté d'apprécier la vie.
Comme pour éviter de vivre le présent trop dur et trop morne de sa mère, la fille oubliera le sien, son présent et vivra dans le rêve jusqu'à ce que la réalité la frappe et qu'elle découvre enfin ce qu'est la vie, la sienne. Les maisons, ce sont des désillusions, mais aussi un appel au carpe diem.
Québécoise dans son décor, l'histoire est pourtant universelle, et, à mon sens, très particulière à notre époque. L'écriture de Fanny Britt est extrêmement efficace, concise, droit au but, et élégante en même temps. Il faut beaucoup de doigté pour ne pas faire de tels personnages des perdants intégraux ou des inconscients finis, comme c'est souvent le cas dans ce genre de chronique de société. Ici, l'auteure réussi à donner à chacun de ses personnages une certaine part de lumière, ce qui nous laisse ébahis à la fin du livre, ébahis comme le personnage, de sortir intact d'une histoire qui aurait pourtant pu nous débâtir.
Un livre superbe en plusieurs points.
J'ai beaucoup entendu parler de ce livre avant de le lire, aussi je savais déjà qu'il s'agissait de l'histoire d'une agent d'immeuble qui faisait la rencontre d'un ancien amant, pour ne pas dire d'un amour de jeunesse. Cette colonne vertébrale est ce qui, de toute évidence, a le plus retenu l'attention. Pour ma part, c'est toute la chaire autour de cet os qui m'a frappé. Bien plus que l'histoire d'amours fragiles, j'ai vu dans ce livre le portrait d'une époque, la nôtre, et j'ai trouvé ce portrait non seulement très juste mais aussi très vrai.
Oui, l'agent immeuble en question rencontrera son ancien amant. Ce gars-là est devenu, avec la distance amenée par le temps, un idéal, une histoire qu'elle n'a jamais pu terminer, enfin, qu'elle n'a pas vu se terminer comme elle l'aurait souhaité. Aussi l'a-t-elle magnifiée avec le temps. De toute évidence, cette histoire qu'elle s'était inventée, ce "et si ça avait continué", l'aidait à combler un vide, mais lequel?
La fille est pourtant aimée de ses enfants et de son conjoint. Sa carrière va bon train, bref, le présent lui sourit, jusqu'à ce qu'apparaisse ce mec surgit du passé. Alors l'auteure part explorer le passé de son personnage, un passé d'enfant du divorce, élevée, avec son frère, par une mère-courage misérabiliste. Sortie de sa petite ville de région (L'Abitibi) pour gagner Montréal, celle dernière vivra dans un perpétuel renoncement plus ou moins pathétique qui procurera le matériel dont ses enfants auront besoin, sauf peut-être un élément tout aussi essentiel: la faculté d'apprécier la vie.
Comme pour éviter de vivre le présent trop dur et trop morne de sa mère, la fille oubliera le sien, son présent et vivra dans le rêve jusqu'à ce que la réalité la frappe et qu'elle découvre enfin ce qu'est la vie, la sienne. Les maisons, ce sont des désillusions, mais aussi un appel au carpe diem.
Québécoise dans son décor, l'histoire est pourtant universelle, et, à mon sens, très particulière à notre époque. L'écriture de Fanny Britt est extrêmement efficace, concise, droit au but, et élégante en même temps. Il faut beaucoup de doigté pour ne pas faire de tels personnages des perdants intégraux ou des inconscients finis, comme c'est souvent le cas dans ce genre de chronique de société. Ici, l'auteure réussi à donner à chacun de ses personnages une certaine part de lumière, ce qui nous laisse ébahis à la fin du livre, ébahis comme le personnage, de sortir intact d'une histoire qui aurait pourtant pu nous débâtir.
Un livre superbe en plusieurs points.
jeudi 24 mars 2016
La puissance de la joie, par Frédéric Lenoir, éditions Fayard
On connait déjà la psycho-pop. Pour plusieurs, le genre provoque beaucoup d'appréhensions. Je suis de ceux-là. Or, si on parlait de philo-pop, devrait-on se crisper tout autant? Pas nécessairement, mais...
Moi qui lis peu d'essais, je me suis procuré celui-ci après avoir entendu Frédéric Lenoir en entrevue à la radio. Son propos m'avait séduit, je l'ai trouvé audacieux. Promouvoir la joie, proposer le bonheur en nos temps caverneux m'apparaît en effet complètement champ gauche. C'est pourtant ce que fait le bonhomme. Dans ce livre, Lenoir donne des pistes pour repérer la joie dans toutes les épisodes de nos vies. Ses démonstrations sont présentées à travers les exposés que d'autres philosophes ont faites avant lui, mais aussi à travers son expérience personnelle. Le livre commence avec une explication fort convaincante où on comprend la motivation de l'auteur. Puis, suivent les présentations de "philosophes de la joie" comme Spinoza et Nietsche.
Perso, philosopher, oui, je peux. M'intéresser aux pensées des autres, aussi. J'aime apprendre. Lenoir explique bien et vulgarise bien des systèmes de pensées qui, lorsqu'on les saisit bien, ont beaucoup de sens. Ça, j'aime. J'étais donc dans le public cible. Vers la fin du livre, l'auteur relate des expériences personnelles qui l'ont amené à se poser des questions et à réaliser des choses qui ont développé sa pensée. Là, on adhère ou pas et j'avoue m'être mis à tiquer un peu. Je comprend que l'expérience amène à structurer ses idées et à réaliser des choses. Ce que je comprends moins c'est pourquoi il faille se prendre soi-même comme exemple. Par exemple, les croyances de Lenoir ne me rejoignent pas toutes, mais ses interprétations, oui, souvent. Avec lui, je crois aussi qu'il faille tendre plutôt vers le bon que le mauvais côté des choses. Mais ses références ne me vont pas toutes. C'est normal, sans doute, de ne pas adhérer à l'ensemble des propos d'un philosophe. Mais un inconfort reste un inconfort, d'où ma propension à préférer la fiction. Là, au moins, j'ai la liberté d'interpréter comme je le veux.
J'ai pourtant pensé à plein de gens autour de moi qui auraient avantage à s'inspirer des idées d'un Frédéric Lenoir. Mais alors que j'avançais dans le livre, j'ai constaté que de tels livres "qui portent à réfléchir" s'adressent à un public de convertis. Ce que je veux dire, c'est que si Lenoir avait inclut ses idées philosophiques, ses concepts de joie et de lâcher prise à l'intérieur d'une fiction, non seulement j'y aurais plus facilement adhéré, mais je sais que d'autres auraient pu aussi se laisser toucher. Entre les propos doctes et les propos racontés, je préfère les seconds, et je ne crois pas être le seul.
Bref, voilà un essai qui vous propose quelque chose de bon. Si vous avez besoin d'un coup de main pour sortir de la morosité, La puissance de la joie pourrait vous donner de bonnes pistes.
Moi qui lis peu d'essais, je me suis procuré celui-ci après avoir entendu Frédéric Lenoir en entrevue à la radio. Son propos m'avait séduit, je l'ai trouvé audacieux. Promouvoir la joie, proposer le bonheur en nos temps caverneux m'apparaît en effet complètement champ gauche. C'est pourtant ce que fait le bonhomme. Dans ce livre, Lenoir donne des pistes pour repérer la joie dans toutes les épisodes de nos vies. Ses démonstrations sont présentées à travers les exposés que d'autres philosophes ont faites avant lui, mais aussi à travers son expérience personnelle. Le livre commence avec une explication fort convaincante où on comprend la motivation de l'auteur. Puis, suivent les présentations de "philosophes de la joie" comme Spinoza et Nietsche.
Perso, philosopher, oui, je peux. M'intéresser aux pensées des autres, aussi. J'aime apprendre. Lenoir explique bien et vulgarise bien des systèmes de pensées qui, lorsqu'on les saisit bien, ont beaucoup de sens. Ça, j'aime. J'étais donc dans le public cible. Vers la fin du livre, l'auteur relate des expériences personnelles qui l'ont amené à se poser des questions et à réaliser des choses qui ont développé sa pensée. Là, on adhère ou pas et j'avoue m'être mis à tiquer un peu. Je comprend que l'expérience amène à structurer ses idées et à réaliser des choses. Ce que je comprends moins c'est pourquoi il faille se prendre soi-même comme exemple. Par exemple, les croyances de Lenoir ne me rejoignent pas toutes, mais ses interprétations, oui, souvent. Avec lui, je crois aussi qu'il faille tendre plutôt vers le bon que le mauvais côté des choses. Mais ses références ne me vont pas toutes. C'est normal, sans doute, de ne pas adhérer à l'ensemble des propos d'un philosophe. Mais un inconfort reste un inconfort, d'où ma propension à préférer la fiction. Là, au moins, j'ai la liberté d'interpréter comme je le veux.
J'ai pourtant pensé à plein de gens autour de moi qui auraient avantage à s'inspirer des idées d'un Frédéric Lenoir. Mais alors que j'avançais dans le livre, j'ai constaté que de tels livres "qui portent à réfléchir" s'adressent à un public de convertis. Ce que je veux dire, c'est que si Lenoir avait inclut ses idées philosophiques, ses concepts de joie et de lâcher prise à l'intérieur d'une fiction, non seulement j'y aurais plus facilement adhéré, mais je sais que d'autres auraient pu aussi se laisser toucher. Entre les propos doctes et les propos racontés, je préfère les seconds, et je ne crois pas être le seul.
Bref, voilà un essai qui vous propose quelque chose de bon. Si vous avez besoin d'un coup de main pour sortir de la morosité, La puissance de la joie pourrait vous donner de bonnes pistes.
mardi 15 mars 2016
Boussole, par Mathias Enard, éditions Actes Sud
Amis lecteurs. Lorsque vous vous remémorez tout ce que vous avez lu, êtes-vous capables d'identifier la lecture d'un ouvrage en particulier que vous pourriez qualifier d'époque de votre vie? Est-ce que, le temps que vous avez lu ce ou ces livre(s(il peut bien en avoir plusieurs) vous avez l'impression d'avoir changé, grandi ou tant appris que vous en êtes sorti différent de ce que vous étiez avant sa lecture?
En voici un qu'il me sera plus facile d'évaluer plus tard, lorsqu'il aura fini de mijoter. Parce que Boussole est dense, très dense. Il se digère longtemps, mais avec délices.
Franz souffre d'insomnie. En une nuit, il se remémorera sa carrière de musicologue spécialiste des musiques orientales et par le fait même, de sa relation privilégiée avec une collègue, Sarah, une orientaliste renommée. Il est Autrichien, elle est Française. Il s'auront rencontrés partout, surtout à Istanbul, Damas, Palmyre, Téhéran. Ses souvenirs vont d'ne ville à l'autre, contiennent plusieurs autres collègues mais aussi, et surtout, font des liens entre les gens, les époques, les genres, entre Orient et Occident. Érudits à la puissance 10, les personnages de ce livre vous donneront l'impression de lire des chapitres entiers de l'Encyclopedia Britannicus ou de tout autre ouvrage de référence que vous préfériez. Dense, érudit, les mots sont faibles, mais par-dessus tout, il faut décrire ce livre comme fascinant.
Vous croyiez votre culture générale quand même assez vaste? Lisez Boussole et elle décuplera. Oui, absolument, cette lecture est parfois difficile, pas tant à cause du propos que du style de Mathias Enard. Ses phrases, longues, contiennent toutefois des perles qu'il vaut la peine de chercher. Si j'ai relu parfois quelques phrases, c'était souvent pour noter telle référence, tel compositeur, telle musique, tel ouvrage. Juste pour vous dire, je me suis procuré trois albums de compositeurs cités dans ce livre, et c'est bien peu! La quantité d'informations que contient ce livre est incroyable. Ici Beethoven est en récital, là Listz fait une tournée jusqu'en Turquie, puis Berlioz rencontre un orientaliste Allemand, Schumann vit ses derniers moments... Et pas besoin d'être amateur de musique pour apprécier. Suffit d'un esprit ouvert, et on embarque dans les chassés-croisés de l'Histoire.
Dans cet ouvrage, Enard, sans doute une montagne d'érudition lui-même, montre combien tout est relié, combien chacun influence et est influencé par l'autre, bref, que le monde se construit, s'améliore, s'ouvre, grâce aux mélanges, aux connaissances, à la curiosité des esprits.
Peut-être ai-je tort en disant (prétendant?) qu'un tel livre plaira à peu. La principale raison est qu'il fera trop peu à trop de gens. Tiens, juste cette description que j'en fais a dû en effrayer quelques uns. Et pourtant, comme un reportage télé à premier vue anodin qui a contribué à notre connaissance du onde lorsqu'on était enfant, comme un professeur qui a su rendre passionnante une matière aride à première vue, Mathias Enard a la bonhommie de nous livrer un ouvrage où nous, lecteurs, sommes considérés comme des êtres intelligents. Ne serait-ce que pour ça, le bien qu'on en retire est immense.
Attention! Si vous êtes un habitué des téléjournaux et un avide consommateur de médias, vous risquez d'être choqués, puisque ce livre raconte aussi les peuples du moyen orient, leur histoire, leur culture. Pas de généralités excessives ici. Oui, l'auteur en profite pour dénoncer ce qui se passe présentement dans les contrées traversées autrefois par les deux protagonistes. Il décrit d'ailleurs la révolution iranienne de 1979 d'une manière dont je n'en avais pas encore entendu parler.
Genre de livre qui vous élève. Bravo gens du Goncourt (Boussole en est le prix 2015). Vous ne nous l'avez pas fait facile cette année, mais vous savez ce que vous faites!
En voici un qu'il me sera plus facile d'évaluer plus tard, lorsqu'il aura fini de mijoter. Parce que Boussole est dense, très dense. Il se digère longtemps, mais avec délices.
Franz souffre d'insomnie. En une nuit, il se remémorera sa carrière de musicologue spécialiste des musiques orientales et par le fait même, de sa relation privilégiée avec une collègue, Sarah, une orientaliste renommée. Il est Autrichien, elle est Française. Il s'auront rencontrés partout, surtout à Istanbul, Damas, Palmyre, Téhéran. Ses souvenirs vont d'ne ville à l'autre, contiennent plusieurs autres collègues mais aussi, et surtout, font des liens entre les gens, les époques, les genres, entre Orient et Occident. Érudits à la puissance 10, les personnages de ce livre vous donneront l'impression de lire des chapitres entiers de l'Encyclopedia Britannicus ou de tout autre ouvrage de référence que vous préfériez. Dense, érudit, les mots sont faibles, mais par-dessus tout, il faut décrire ce livre comme fascinant.
Vous croyiez votre culture générale quand même assez vaste? Lisez Boussole et elle décuplera. Oui, absolument, cette lecture est parfois difficile, pas tant à cause du propos que du style de Mathias Enard. Ses phrases, longues, contiennent toutefois des perles qu'il vaut la peine de chercher. Si j'ai relu parfois quelques phrases, c'était souvent pour noter telle référence, tel compositeur, telle musique, tel ouvrage. Juste pour vous dire, je me suis procuré trois albums de compositeurs cités dans ce livre, et c'est bien peu! La quantité d'informations que contient ce livre est incroyable. Ici Beethoven est en récital, là Listz fait une tournée jusqu'en Turquie, puis Berlioz rencontre un orientaliste Allemand, Schumann vit ses derniers moments... Et pas besoin d'être amateur de musique pour apprécier. Suffit d'un esprit ouvert, et on embarque dans les chassés-croisés de l'Histoire.
Dans cet ouvrage, Enard, sans doute une montagne d'érudition lui-même, montre combien tout est relié, combien chacun influence et est influencé par l'autre, bref, que le monde se construit, s'améliore, s'ouvre, grâce aux mélanges, aux connaissances, à la curiosité des esprits.
Peut-être ai-je tort en disant (prétendant?) qu'un tel livre plaira à peu. La principale raison est qu'il fera trop peu à trop de gens. Tiens, juste cette description que j'en fais a dû en effrayer quelques uns. Et pourtant, comme un reportage télé à premier vue anodin qui a contribué à notre connaissance du onde lorsqu'on était enfant, comme un professeur qui a su rendre passionnante une matière aride à première vue, Mathias Enard a la bonhommie de nous livrer un ouvrage où nous, lecteurs, sommes considérés comme des êtres intelligents. Ne serait-ce que pour ça, le bien qu'on en retire est immense.
Attention! Si vous êtes un habitué des téléjournaux et un avide consommateur de médias, vous risquez d'être choqués, puisque ce livre raconte aussi les peuples du moyen orient, leur histoire, leur culture. Pas de généralités excessives ici. Oui, l'auteur en profite pour dénoncer ce qui se passe présentement dans les contrées traversées autrefois par les deux protagonistes. Il décrit d'ailleurs la révolution iranienne de 1979 d'une manière dont je n'en avais pas encore entendu parler.
Genre de livre qui vous élève. Bravo gens du Goncourt (Boussole en est le prix 2015). Vous ne nous l'avez pas fait facile cette année, mais vous savez ce que vous faites!
lundi 29 février 2016
Chemin Saint-Paul, de Lise Tremblay, éditions Boréal
L'auteure raconte les fins de vie de ses deux parents. Personnages différents qui n'ont pas vécu leur vie de la même façon bien qu'ils l'aient vécus ensemble, chacun a donné ce qu'il avait à ses enfants.
Que nous reste-t-il de ce que nos parents nous ont donné? C'est une question qu'on se pose à différents moments de notre vie. Ici, Lise Tremblay fait ce bilan au moment du décès de son père. Récit très personnel, il touche non seulement par son propos, mais aussi par sa forme.
C'est le deuxième livre de Lise Tremblay que je lis, et cette fois encore, je m'étonne de son écriture droite, dans le sens de "droit au but". Ici, peu de poésie ou d'envolées, mais une écriture pragmatique et simple qui, me semble-t-il, ajoute à la proximité qu'on peut imaginer avoir avec l'auteure. On croirait entendre quelqu'un assis derrière nous dans le bus au restaurant, en train de raconter une anecdote récemment vécue.
Et au même titre que ses parents qui l'ont faite, Lise Tremblay raconte, dans un livre pourtant court, des épisodes de la vie de ses parents qui les ont faits, eux aussi, chacun de leur côté. Ces histoires nous donnent à penser sur l'hérédité et nous font nous demander jusqu'à quel point nous ne sommes pas aussi le produit de notre environnement. C'est enfin un portrait de la vieillesse qu'une certaine pudeur, à moins qu'il ne s'agisse de rectitude politique (ou sociale, on voit ça comme on veut...) nous empêche souvent de regarder en face. Meurt-on comme on a vécu? Si oui, ça voudrait dire quoi?
Enfin, Chemin Saint-Paul contient aussi des pans de l'histoire québécoise, de l'histoire populaire, en fait, celle qui s'est vécue dans l'ombre mais qui, même si elle n'a pas fait de bruit, a quand même contribué à faire de ce peuple ce qu'il est devenu.
Un rare récit très personnel qui ne tombe pas dans l'introspection ennuyeuse, et dont certains passages sauront toucher tout le monde.
Que nous reste-t-il de ce que nos parents nous ont donné? C'est une question qu'on se pose à différents moments de notre vie. Ici, Lise Tremblay fait ce bilan au moment du décès de son père. Récit très personnel, il touche non seulement par son propos, mais aussi par sa forme.
C'est le deuxième livre de Lise Tremblay que je lis, et cette fois encore, je m'étonne de son écriture droite, dans le sens de "droit au but". Ici, peu de poésie ou d'envolées, mais une écriture pragmatique et simple qui, me semble-t-il, ajoute à la proximité qu'on peut imaginer avoir avec l'auteure. On croirait entendre quelqu'un assis derrière nous dans le bus au restaurant, en train de raconter une anecdote récemment vécue.
Et au même titre que ses parents qui l'ont faite, Lise Tremblay raconte, dans un livre pourtant court, des épisodes de la vie de ses parents qui les ont faits, eux aussi, chacun de leur côté. Ces histoires nous donnent à penser sur l'hérédité et nous font nous demander jusqu'à quel point nous ne sommes pas aussi le produit de notre environnement. C'est enfin un portrait de la vieillesse qu'une certaine pudeur, à moins qu'il ne s'agisse de rectitude politique (ou sociale, on voit ça comme on veut...) nous empêche souvent de regarder en face. Meurt-on comme on a vécu? Si oui, ça voudrait dire quoi?
Enfin, Chemin Saint-Paul contient aussi des pans de l'histoire québécoise, de l'histoire populaire, en fait, celle qui s'est vécue dans l'ombre mais qui, même si elle n'a pas fait de bruit, a quand même contribué à faire de ce peuple ce qu'il est devenu.
Un rare récit très personnel qui ne tombe pas dans l'introspection ennuyeuse, et dont certains passages sauront toucher tout le monde.
mardi 9 février 2016
10:04, de Ben Lerner, éditions McClelland & Stewart
Se raconter, c'est tout un art. Combien s'y essaient avec des résultats décevants parce qu'ennuyants, décalés, égocentriques, ou carrément inutiles. Aussi, lorsque ça réussit, ça cartonne. C'est ce qui est récemment arrivé avec le Norvégien Knaussgard. Me voici, avec Ben Lerner, face à ce qui ressemble le plus à ça.
Il est toujours assez stupéfiant de se surprendre soi-même à aimer un livre qui nous apparait à mille lieux de ce qu'on a l'habitude d'aimer. Et pourtant, si on aime un livre comme 10:04, c'est qu'on aime se faire raconter des choses. Et quelles choses? Qu'importe. Du moment que c'est bien raconté.
Le narrateur de ce livre habite New-York. L'inverse est aussi vrai: New-York l'habite. Célibataire dans la trentaine, il passe le plus clair de son temps avec sa meilleure amie qui, pour une raison que je ne vous dirai pas, décide qu'elle veut un enfant de lui, mais par fécondation in vitro. En même temps, le mec en question, enseignant et écrivain ayant connu un certain succès avec sa dernière parution, a une petite amie qu'il voit de temps en temps, une fille du milieu des arts, vaporeuse, distante mais présente en même temps.
Le narrateur fréquente aussi aussi des amis du milieu littéraire. Bref, ça fait beaucoup de monde, mais toujours, avec le personnage principal. Et tout ce beau monde est new-yorkais, mais alors là vraiment, et on a des opinions sur tous et sur tout, et on se pose des questions sur soi, un peu sur les autres aussi, mais surtout sur soi.
Bien sur, on pense à Woody Allen, parce que ça sent souvent la névrose, le "trop de ci" ou le "pas assez de ça". Puis surviennent, ici et là, des histoires racontées par d'autres qui, on le constatera, feront partie d'un livre que le narrateur est en train d'écrire, à moins que ce ne soit le contraire?
Lorsqu'on lit un peu sur Ben Lerner, on ose croire que sa vie ressemble à celle du personnage de ce livre. Aussi est-on souvent en train de se demander si ce qu'on lit est "vrai" ou " raconté". Rempli de scènes de la vie quotidienne, 10:04 captive par sa linéarité, comme si notre regard était happé par quelqu'un qui passe dans la rue, ou par un voisin, dans le métro, et qu'on le fixait involontairement, hypnotisé par quelque chose qu'on ignore. Ce type d'écriture m'attire irrésistiblement. On dirait un hyper-réalisme qui dépasse le journal écrit ou le carnet de voyage. Un tel livre transforme le lecteur en voyeur et c'est cette transformation qui me fascine.
Certaines scènes de 10:04 se passent lors des ouragans qui ont récemment passé par New-York, inondant quelques zones. Je dois dire que j'ai souvent ri pendant ces scènes et d'autres aussi, comme celle où le gars doit aller faire un don de sperme pour la fécondation à venir. Et c'est sans compter d'autres scènes très touchantes, dont certaines, brillantes, où la présence d'un enfant contaminé par les névroses des grands qui l'entourent nous donnent à penser sur beaucoup de choses.
Paru en 2014 dans sa langue d'origine, 10:04 n'est pas traduit en français. Seul son roman précédent, Au départ d'Atocha (que je n'ai pas lu), l'est. Bien qu'un peu docte par endroits, l'écriture de Lerner est très abordable et le style atypique de cet auteur américain mérite qu'on le lise dans sa langue d'origine. Très Américain, mais pas comme les Américains. Si ça vous titille, laissez-vous tenter!
Il est toujours assez stupéfiant de se surprendre soi-même à aimer un livre qui nous apparait à mille lieux de ce qu'on a l'habitude d'aimer. Et pourtant, si on aime un livre comme 10:04, c'est qu'on aime se faire raconter des choses. Et quelles choses? Qu'importe. Du moment que c'est bien raconté.
Le narrateur de ce livre habite New-York. L'inverse est aussi vrai: New-York l'habite. Célibataire dans la trentaine, il passe le plus clair de son temps avec sa meilleure amie qui, pour une raison que je ne vous dirai pas, décide qu'elle veut un enfant de lui, mais par fécondation in vitro. En même temps, le mec en question, enseignant et écrivain ayant connu un certain succès avec sa dernière parution, a une petite amie qu'il voit de temps en temps, une fille du milieu des arts, vaporeuse, distante mais présente en même temps.
Le narrateur fréquente aussi aussi des amis du milieu littéraire. Bref, ça fait beaucoup de monde, mais toujours, avec le personnage principal. Et tout ce beau monde est new-yorkais, mais alors là vraiment, et on a des opinions sur tous et sur tout, et on se pose des questions sur soi, un peu sur les autres aussi, mais surtout sur soi.
Bien sur, on pense à Woody Allen, parce que ça sent souvent la névrose, le "trop de ci" ou le "pas assez de ça". Puis surviennent, ici et là, des histoires racontées par d'autres qui, on le constatera, feront partie d'un livre que le narrateur est en train d'écrire, à moins que ce ne soit le contraire?
Lorsqu'on lit un peu sur Ben Lerner, on ose croire que sa vie ressemble à celle du personnage de ce livre. Aussi est-on souvent en train de se demander si ce qu'on lit est "vrai" ou " raconté". Rempli de scènes de la vie quotidienne, 10:04 captive par sa linéarité, comme si notre regard était happé par quelqu'un qui passe dans la rue, ou par un voisin, dans le métro, et qu'on le fixait involontairement, hypnotisé par quelque chose qu'on ignore. Ce type d'écriture m'attire irrésistiblement. On dirait un hyper-réalisme qui dépasse le journal écrit ou le carnet de voyage. Un tel livre transforme le lecteur en voyeur et c'est cette transformation qui me fascine.
Certaines scènes de 10:04 se passent lors des ouragans qui ont récemment passé par New-York, inondant quelques zones. Je dois dire que j'ai souvent ri pendant ces scènes et d'autres aussi, comme celle où le gars doit aller faire un don de sperme pour la fécondation à venir. Et c'est sans compter d'autres scènes très touchantes, dont certaines, brillantes, où la présence d'un enfant contaminé par les névroses des grands qui l'entourent nous donnent à penser sur beaucoup de choses.
Paru en 2014 dans sa langue d'origine, 10:04 n'est pas traduit en français. Seul son roman précédent, Au départ d'Atocha (que je n'ai pas lu), l'est. Bien qu'un peu docte par endroits, l'écriture de Lerner est très abordable et le style atypique de cet auteur américain mérite qu'on le lise dans sa langue d'origine. Très Américain, mais pas comme les Américains. Si ça vous titille, laissez-vous tenter!
dimanche 7 février 2016
Il était une ville, par Thomas B. Reverdy, éditions Flammarion
S'il est une ville qui mérite d'être racontée à notre époque, c'est bien Détroit, qui constitue le décor, tout à fait glauque et déglingué, de ce roman.
Le personnage principal est un Français qui y est parachuté par son entreprise pour y coordonner le début d'un projet industriel. C'est louche, puisqu'on est à la veille de la crise de 2008. C'est ce que le mec constate, lui qui revient tout juste d'un projet dont on l'a retiré en Chine, parce que ça n'allait pas. Mais il s'installe dans sa nouvelle ville et nous la fait découvrir avec son oeil d'expatrié. C'est déjà fort intéressant, mais avec quelques "mais". J'y reviendrai.
En parallèle, on a l'histoire d'une petite gang de jeunes d'un quartier de la ville, à peine sortis de l'enfance. Familles non-traditionnelles, milieux défavorisés, ils trainent dans les rues et s'amusent bien en profitant du vide ambiant, jusqu'à ce qu'un événement les pousse à fuguer dans un endroit vraiment particulier. Traitée avec beaucoup de finesse, cette partie du livre se distingue par une sensibilité particulière, un regard différent et très touchant sur l'enfance.
Puis apparaît un policier, victime, administrativement parlant, de ce qui arrive à sa ville. Celui-là amènera au livre, déjà étonnant pour le tableau qu'il nous dresse d'une ville d'une ville en déclin, une enquête policière qui ajoute une couche de noir supplémentaire à un livre aux couleurs déjà pas mal foncées.
Il était une ville n'est pas pour autant un livre noir, mais gris avec, en son centre, une pointe de lumière amenée par une aventure que vivra le personnage principal. L'utilisation de Détroit et de ses quartiers qui s'écroulent aurait pu tomber dans le cliché, mais son utilisation, sauf exception, nous porte plutôt à réfléchir sur une échelle plus grand que celle de la seule ville de Détroit. Et si c'était plus qu'une ville qui était en train de s'écrouler? C'est en tout cas ce qu'on se dit en terminant ce livre, qui se termine pourtant sur une constatation porteuse: et malgré tout ça, la vie continue. Reverdy écrit bien et amène parfois des réflexions très justes à travers les yeux de ses personnages. Son livre est celui d'un observateur attentif et sans aucun doute fasciné par ce qu'il se passe là. C'est aussi le regard d'un Européen sur un pan récent de l'histoire d'un côté du monde qui est de moins en moins Nouveau... et c'est là où apparaissent quelques bémols. Attention, mes petits reproches ne seront sans doute appuyés que par les lecteurs vivant, comme moi, du même côté du monde que la ville de Détroit. Re-attention: petite alerte "ah-les-grands-espaces-recouverts-de-neige". Vous me voyez venir? L'oeil européen sur l'Amérique, surtout celui de qui s'en éprend, comporte toujours les mêmes bons vieux clichés. Et si l'auteur se laisse emporter plus ou moins naïvement, ça peut exaspérer un peu le lecteur nord-américain. Ainsi une scène ou le personnage principal traverse la frontière et va au Canada pour s'acheter un manteau chaud dans une boutique "spécialisée dans les expéditions polaires et la chasse à l'ours". On parle ici de Windsor, Ontario... Bon. Pour les Européens, si je voulais faire image, je dirais que c'est comme si un visiteur, arrivant en France par l'Espagne, cherchait à se procurer un ticket pour visiter la tour Eiffel dans un bar tabac de Perpignan. C'est foncièrement possible, mais extrêmement peu probable qu'il en trouve un, vous trouvez pas?
Puis cette scène, qui reviendra parfois, où les enfants jouent dans un champ un peu à l'écart de la ville, à être des... cowboys et des indiens. Or, on est quelque part autour de 2008. Oui, bon, il est possible que de petits Américains jouent encore aux cowboys et aux indiens et se prennent pour des Sioux (encore les Sioux, toujours les Sioux...), mais qu'on me permette de supposer qu'il sont vraiment, mais alors là vraiment très peu nombreux. Mais bon...
Outre ça, ce livre est très fort, très sensible aussi, mais aussi très dur, et ce surtout dans une scène, en fait dans la seule scène vraiment très dure, très violente, à la limite du supportable, qui, par son unicité, contribue à faire de ce livre un objet franchement étonnant.
Pour un regard nouveau sur notre époque et une écriture droite et sensible... et un beau voyage dans l'Amérique profonde: recommandé.
Le personnage principal est un Français qui y est parachuté par son entreprise pour y coordonner le début d'un projet industriel. C'est louche, puisqu'on est à la veille de la crise de 2008. C'est ce que le mec constate, lui qui revient tout juste d'un projet dont on l'a retiré en Chine, parce que ça n'allait pas. Mais il s'installe dans sa nouvelle ville et nous la fait découvrir avec son oeil d'expatrié. C'est déjà fort intéressant, mais avec quelques "mais". J'y reviendrai.
En parallèle, on a l'histoire d'une petite gang de jeunes d'un quartier de la ville, à peine sortis de l'enfance. Familles non-traditionnelles, milieux défavorisés, ils trainent dans les rues et s'amusent bien en profitant du vide ambiant, jusqu'à ce qu'un événement les pousse à fuguer dans un endroit vraiment particulier. Traitée avec beaucoup de finesse, cette partie du livre se distingue par une sensibilité particulière, un regard différent et très touchant sur l'enfance.
Puis apparaît un policier, victime, administrativement parlant, de ce qui arrive à sa ville. Celui-là amènera au livre, déjà étonnant pour le tableau qu'il nous dresse d'une ville d'une ville en déclin, une enquête policière qui ajoute une couche de noir supplémentaire à un livre aux couleurs déjà pas mal foncées.
Il était une ville n'est pas pour autant un livre noir, mais gris avec, en son centre, une pointe de lumière amenée par une aventure que vivra le personnage principal. L'utilisation de Détroit et de ses quartiers qui s'écroulent aurait pu tomber dans le cliché, mais son utilisation, sauf exception, nous porte plutôt à réfléchir sur une échelle plus grand que celle de la seule ville de Détroit. Et si c'était plus qu'une ville qui était en train de s'écrouler? C'est en tout cas ce qu'on se dit en terminant ce livre, qui se termine pourtant sur une constatation porteuse: et malgré tout ça, la vie continue. Reverdy écrit bien et amène parfois des réflexions très justes à travers les yeux de ses personnages. Son livre est celui d'un observateur attentif et sans aucun doute fasciné par ce qu'il se passe là. C'est aussi le regard d'un Européen sur un pan récent de l'histoire d'un côté du monde qui est de moins en moins Nouveau... et c'est là où apparaissent quelques bémols. Attention, mes petits reproches ne seront sans doute appuyés que par les lecteurs vivant, comme moi, du même côté du monde que la ville de Détroit. Re-attention: petite alerte "ah-les-grands-espaces-recouverts-de-neige". Vous me voyez venir? L'oeil européen sur l'Amérique, surtout celui de qui s'en éprend, comporte toujours les mêmes bons vieux clichés. Et si l'auteur se laisse emporter plus ou moins naïvement, ça peut exaspérer un peu le lecteur nord-américain. Ainsi une scène ou le personnage principal traverse la frontière et va au Canada pour s'acheter un manteau chaud dans une boutique "spécialisée dans les expéditions polaires et la chasse à l'ours". On parle ici de Windsor, Ontario... Bon. Pour les Européens, si je voulais faire image, je dirais que c'est comme si un visiteur, arrivant en France par l'Espagne, cherchait à se procurer un ticket pour visiter la tour Eiffel dans un bar tabac de Perpignan. C'est foncièrement possible, mais extrêmement peu probable qu'il en trouve un, vous trouvez pas?
Puis cette scène, qui reviendra parfois, où les enfants jouent dans un champ un peu à l'écart de la ville, à être des... cowboys et des indiens. Or, on est quelque part autour de 2008. Oui, bon, il est possible que de petits Américains jouent encore aux cowboys et aux indiens et se prennent pour des Sioux (encore les Sioux, toujours les Sioux...), mais qu'on me permette de supposer qu'il sont vraiment, mais alors là vraiment très peu nombreux. Mais bon...
Outre ça, ce livre est très fort, très sensible aussi, mais aussi très dur, et ce surtout dans une scène, en fait dans la seule scène vraiment très dure, très violente, à la limite du supportable, qui, par son unicité, contribue à faire de ce livre un objet franchement étonnant.
Pour un regard nouveau sur notre époque et une écriture droite et sensible... et un beau voyage dans l'Amérique profonde: recommandé.
mardi 19 janvier 2016
D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds, par Jon Kalman Stefansson, éditions Gallimard
Je ne peux juste pas croire que je viens de terminer ce livre. Déjà!?
Ari reviens dans son pays après quelques années d'exil, un départ survenu après sa rupture d'avec sa femme, un événement provoqué par lui et qui, de toute évidence, lui fait encore mal. Il arrive dans la petite ville où il a grandi. Il y arrive au sens le plus propre du terme: c'est Keflavik, la ville où est situé l'aéroport international islandais. C'est le Orly, le Heathrow, le Dorval islandais. C'est, à en croire le narrateur, l'endroit le plus désolé qui soit. Or, Ari n'ira pas plus loin de tout le livre, sauf peut-être dans son passé.
Trois époques se chevauchent: celle de l'arrivée d'Ari, aujourd'hui, celle d'une page de son passé, dans le même Keflavik, en 1980, et enfin celle d'Oddur et de Margret, dans l'est de l'Islande, environ 100 ans plus tôt. On assistera à leur rencontre, à l'avènement de leur petite famille, puis à sa vie à elle qui suivra le cours de sa vie à lui. Et pendant ce temps, Ari revoit son adolescence et se remémore un premier amour.
Ce scénario tout simple, ficelé par la dentelle des mots magnifiquement traduits par Éric Boury, est tout simplement remarquable. C'est un hommage incroyable à la simplicité, qui contient des scènes qu'on ne peut pas oublier. Peintre hors pair du langage, Jon Kalman Stefansson pourrait vous donner la description d'un mur blanc à vous tenir en haleine tellement c'est beau. C'est ainsi que même les choses, les événements les plus durs vous traversent sans vous heurter trop durement. Quant aux événements heureux... je n'ose même pas vous les décrire.
Avec cet auteur, prendre la mer après la tempête devient une entrée dans le clair de lune, un enfant mort-né devient un petit personnage né endormi qui ne se réveillera jamais. Avec ce livre, vous prendrez inévitablement la peine d'écouter Wish You Were Here, de Pink Floyd, pour l'écouter comme l'a fait le personnage de ce livre, et dans les dix dernières pages, vous ressentirez de la douleur en même temps qu'un immense bien-être.
Oui, cet Islandais écrit divinement bien. Oui, c'est encore de l'Islande, de cette terre dure et de cette mer omniprésente, mais je ne m'en lasse pas. C'est un fan fini qui vous dit ça. Cette écriture me prend, pas seulement pour ce qu'elle décrit mais pour les sentiments qu'elle me fait éprouver. Cet auteur a le don de me ramener loin au fond de moi, dans mes souvenirs d'émotions passées, puis dans les questions que je me pose au quotidien. Ajoutez à ça une histoire touchante, actuelle et aussi et surtout, crédible, et vous avez, à mon sens, le meilleur de la littérature.
Avant D'ailleurs, les poissons... Jon Kalman Stefansson a écrit une trilogie qui commence par le fabuleux Entre ciel et Terre. Si vous n'avez encore rien lu de lui et que cet article a allumé quelque chose en vous, je vous suggère fortement de commencer par ce dernier bouquin. Puis, si, comme moi, vous tombez sous le charme, réservez-vous les trois livres précédents: Entre ciel et Terre, La tristesse des anges, et Le coeur de l'homme.
Chanceux, va. Vous les lirez pour la première fois!
Ari reviens dans son pays après quelques années d'exil, un départ survenu après sa rupture d'avec sa femme, un événement provoqué par lui et qui, de toute évidence, lui fait encore mal. Il arrive dans la petite ville où il a grandi. Il y arrive au sens le plus propre du terme: c'est Keflavik, la ville où est situé l'aéroport international islandais. C'est le Orly, le Heathrow, le Dorval islandais. C'est, à en croire le narrateur, l'endroit le plus désolé qui soit. Or, Ari n'ira pas plus loin de tout le livre, sauf peut-être dans son passé.
Trois époques se chevauchent: celle de l'arrivée d'Ari, aujourd'hui, celle d'une page de son passé, dans le même Keflavik, en 1980, et enfin celle d'Oddur et de Margret, dans l'est de l'Islande, environ 100 ans plus tôt. On assistera à leur rencontre, à l'avènement de leur petite famille, puis à sa vie à elle qui suivra le cours de sa vie à lui. Et pendant ce temps, Ari revoit son adolescence et se remémore un premier amour.
Ce scénario tout simple, ficelé par la dentelle des mots magnifiquement traduits par Éric Boury, est tout simplement remarquable. C'est un hommage incroyable à la simplicité, qui contient des scènes qu'on ne peut pas oublier. Peintre hors pair du langage, Jon Kalman Stefansson pourrait vous donner la description d'un mur blanc à vous tenir en haleine tellement c'est beau. C'est ainsi que même les choses, les événements les plus durs vous traversent sans vous heurter trop durement. Quant aux événements heureux... je n'ose même pas vous les décrire.
Avec cet auteur, prendre la mer après la tempête devient une entrée dans le clair de lune, un enfant mort-né devient un petit personnage né endormi qui ne se réveillera jamais. Avec ce livre, vous prendrez inévitablement la peine d'écouter Wish You Were Here, de Pink Floyd, pour l'écouter comme l'a fait le personnage de ce livre, et dans les dix dernières pages, vous ressentirez de la douleur en même temps qu'un immense bien-être.
Oui, cet Islandais écrit divinement bien. Oui, c'est encore de l'Islande, de cette terre dure et de cette mer omniprésente, mais je ne m'en lasse pas. C'est un fan fini qui vous dit ça. Cette écriture me prend, pas seulement pour ce qu'elle décrit mais pour les sentiments qu'elle me fait éprouver. Cet auteur a le don de me ramener loin au fond de moi, dans mes souvenirs d'émotions passées, puis dans les questions que je me pose au quotidien. Ajoutez à ça une histoire touchante, actuelle et aussi et surtout, crédible, et vous avez, à mon sens, le meilleur de la littérature.
Avant D'ailleurs, les poissons... Jon Kalman Stefansson a écrit une trilogie qui commence par le fabuleux Entre ciel et Terre. Si vous n'avez encore rien lu de lui et que cet article a allumé quelque chose en vous, je vous suggère fortement de commencer par ce dernier bouquin. Puis, si, comme moi, vous tombez sous le charme, réservez-vous les trois livres précédents: Entre ciel et Terre, La tristesse des anges, et Le coeur de l'homme.
Chanceux, va. Vous les lirez pour la première fois!
Inscription à :
Articles (Atom)