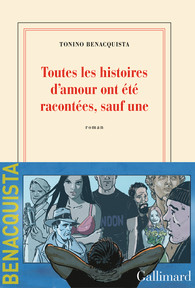J'ai lu la presque entièreté de ce livre en me demandant si je me trompais. Ce questionnement est devenu intéressant lorsque je me suis rendu compte qu'il m'avait permis de me terminer le livre.
"C'est un Goncourt, me disais-je. Alors pourquoi plus je le lis, moins je l'aime?" Je crois avoir compris une fois le livre terminé. Voici pourquoi.
L'histoire ici racontée se passe en majeure partie au Québec. L'écrivain français raconte l'émigration d'un Français qui traversera l'Atlantique pour retrouver son père, qui a suivi le même chemin avant lui. L'expat en question s'enracinera aisément dans sa terre d'accueil. On remarque là les atomes crochus que l'auteur nourrit envers ce bout de terre où, dit-on, il passe beaucoup de temps.
Mais tout ça se terminera plutôt mal parce que le narrateur raconte son histoire de la prison de Bordeaux, à Montréal, où il purge sa peine. Ce livre est donc le récit de ce séjour en prison en même temps que celui de la vie du narrateur où on passera de Toulouse à Montréal via le Danemark et Thetford Mines, au Québec. Un famille franco-danoise, une conjointe amérindienne (bien que l'auteur en parle plutôt comme une indienne), des personnages québécois avec ces noms de rues de Montréal (Lorimier, DuLaurier) et d'autres anglos-canadiens avec des noms exotiques construiront le récit.
Bon. Voilà pour l'essentiel de l'histoire. Quand à la façon dont c'est raconté...
J'ai mis plus de temps qu'à l'habitude entre le moment où j'ai terminé ce livre et mon article de blogue où j'en parle. Je me suis dit qu'avec le temps, je me remettrais de ma première impression, que j'aurais oublié les clichés enjolivés par l'écriture fine de Jean-Paul Dubois. J'ai pensé qu'avec le temps, un sentiment désagréable que je n'avais pas vécu depuis longtemps tant en littérature qu'en toute autre forme de rapports, s'évaporerait. Ce sentiment, c'est celui de se faire raconter des généralités bancales par un Européen débarqué chez-vous comme dans une ancienne colonie, cette petite condescendance cousue de fil blanc qui vous fait vous demander si on se moque de vous ou si votre interlocuteur est tout bonnement naïf, bref, ce malaise, cette déception... ben voilà, tout est dit.
Le narrateur de Jean-Paul Dubois est en prison au Québec. Il partage sa cellule avec un Hell's Angels amateur de motos. Au Québec, ce personnage est bien connu. C'est le truand par excellence, l'incarnation du hors-la-loi, du tueur, de tout ça. Or, lui donner la parole dans une langue qui n'est pas la sienne, comme le fait Dubois, fait décrocher tout lecteur ayant déjà vu défiler ce type de personnage sur son écran de télé ou dans son journal quotidien. Pour un lecteur Européen, comme parallèle, essayez d'imaginer un film comme la Haine ou Les misérables avec un casting s'exprimant avec un phrasé de Neuilly... Bon oui, bien sur, il y a quelques expressions "typiques" ici et là et puis ouais, fallait que tous les lecteurs comprennent, bien entendu...
Mais ce seul personnage est bien peu si on pense à tous ces éléments préfabriqués qui ont réussi à éblouir le jury du prix Goncourt 2019. Que la conjointe du narrateur soit amérindienne, bon, ok, pourquoi pas. Ç'auait pu être un pesonnage riche, fort. Mais vu du côté ouest de l'Atlantique, on se demande un peu pourquoi Dubois parle "d"indiens" lorsqu'il parle du peuple de ce personnage. Est-ce intentionnel ou simplement une image qui colle encore aux fameux grands espaces que le livre traversera régulièrement en hydravion? Ah, les grands espaces canadiens... Tiens, parlant d'espace, allons à Thetford Mines, où se déroule une partie de l'histoire. On est à la fin des années 70, début 80. Un épisode marquant de l'Histoire de cette partie du monde passe d'ailleurs par là en trois coups de cuillère à pot, bref en un ou deux paragraphes. Bon, disons que ce n'est pas là la spécialité de l'auteur. Dubois excelle plutôt dans les descriptions d'un orgue électronique, d'un moteur d'avion ou de l'architecture d'un édifice patrimonial. Bon, c'est vrai que sa description d'une église de Thetford Mines ressemble étrangement à celle du
Répertoire du patrimoine culturel du Québec, mais bon... coïncidence, il faut croire.
Et le Danemark. Même là, y'a quelque chose du même ingrédient... Le père du narrateur est Danois. Alors pour coller à l'esprit de l'auteur, sa ville d'origine est... tout au bout du Danemark, là où y'a pas plus danois. Regardez bien sur la carte du pays, allez tout au nord, c'est Skagen. Ben voilà, ÇA, c'est danois, non? Eh bien notre personnage vient tout droit de là! Bon. Vous me direz que j'exagère, mais pris dans le contexte des autres coins tournés rondement de cet ouvrage, celui-là m'a tout autant exaspéré.

Une importante tempête de verglas? Ah oui, c'est très canadien, ça. Il faut du froid. Alors voilà, on en a une, une tempête de verglas, dans ce livre, à la suite de laquelle d'importantes coupures de courant auront de graves conséquences sur les habitants et les bâtiments. Ça tombe bien, parce que le Québec a justement vécu la même chose à la fin des années 90. Bon, ici, ça se passe une dizaine d'années plus tard, mais c'est pas grave. Le jury du Goncourt doit pas connaître cet autre épisode tragique de ce pays si pittoresque... C'est un détail...
Je pourrais en dire plus, d'un livre finement écrit par un écrivain brillant qui m'a pourtant donné l'impression d'un ouvrage bâclé et truffé de facilités charmantes pour un public déjà fan de l'auteur. Il y a là soit beaucoup de naïveté, soit une incompréhension choquante qui me laissent toutes deux pantois. Les injustices vécues par les personnages, leurs luttes, je les ai bien vues, mais niet, nada, rien: je n'ai pas été touché. Quelle tristesse.
Je n'ai pas envie de recommander cette oeuvre de Jean-Paul Dubois et ne comprends pas qu'on lui ai attribué le prix le plus prestigieux du monde littéraire francophone. Oui, certains passages, principalement ceux vécus dans la France des fameuses années autour de 1968, sont captivants, mais au final, on a aussi une flopée de petites imprécisions sur d'autres parties de l'histoire qui m'ont outrageusement agacé. Mis ensemble, ces bémols discréditent toute l'oeuvre. C'est vraiment très, énormément, immensément décevant.