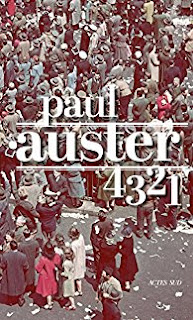Dans le département d'anglais de la faculté des arts libéraux (Liberal Arts), la majorité des profs ont plus de 15 ans d'ancienneté. Chacun se connaît depuis longtemps. Plusieurs sont même voisins non seulement de bureau, mais de résidence. Ils se connaissent beaucoup, voir même peut-être trop, ce qui implique autant de vieilles amitiés que de vieilles rancoeurs. C'est avec ce bagage émotionnel commun que chacun affrontera une période trouble où l'université menace de couper des postes de profs dans le département.
Les angoisses de chacun sont racontées par le narrateur, un des profs du département, occupant, de façon intérimaire, le poste de responsable du département. Mais voilà, intérimaire ou pas, tous les autres croient dur comme fer que c'est lui qui tient l'avenir du département entre ses mains et donc, une fameuse liste des noms à couper.
C'est dans ce contexte original que Richard Russo raconte les angoisses de chacun des membres du département et à travers elles, les relations entre amis, collègues, voisins, mais aussi de couples et parents-enfants. Car ce prof a une lourde hérédité en la personne de ses parents, eux-mêmes deux anciens érudits issus eux aussi du monde universitaire. Son père est un vieil académicien reconnu en son temps avec tout ce qui va de pédanterie. Et il y a sa mère, un femme bafouée mais fière, et sa femme, prof au secondaire, que tout le monde aime, volontaire, issue d'un milieu de cols bleus avec une hérédité tout aussi lourde, mais pour d'autres raisons. Le couple a deux filles, dont l'une entre dans l'âge adulte avec difficulté.
Cette ribambelle de personnages tourne autour du narrateur, un bonhomme haut en couleur dont le seul but est de se distinguer des autres. Or pourquoi jouer les originaux dans un tel milieu où tout pourrait pourtant si bien aller tout seul? Lui-même se le demande, surtout en cette période où tout semble lui tomber sur la tête.
Sous la plume de Russo, ces questionnements porteurs d'angoisse deviennent autant de portraits décrits par un stand-up comique. Il est difficile de ne pas rire à toutes les 2 ou 3 pages. Ironique, sarcastique à la puissance 10, Russo est un raconteur hors pair. Rarement ai-je lu des réparties aussi savoureuses. Bien sur, on voit là plusieurs références aux sitcoms américains. Ici, il est important de préciser que ce roman a été écrit en 1997. Les amateurs de séries télé feront sûrement le lien avec un style de produits télévisuels propres à l'époque. certains scènes font même (déjà) sourire où des répondeurs et des cabines téléphoniques semblent déjà dépassées.
Le Straight Man de Russo est celui, comme le dit le narrateur à un moment du livre, que tout le monde, dans le département d'anglais tente d'être, comme désir de se distinguer des autres, mais à l'envers. Et cette distinction devient tout aussi intéressante... et universelle lorsqu'elle concerne nos liens de parenté. Qui sommes-nous par rapport à ce que nos parents ont été? Un passage savoureux décrit d'ailleurs le monde en deux groupes, soit ceux qui ont rêvé d'être comme leurs parents et l'autre, qui ont rêvé ne jamais le devenir. Dans les deux cas, ces rêves ont échoué...
Ce sont des réflexions comme celles-là, irrésistibles parce que drôles mais combien vraies, qui rendent ce livre extrêmement agréable. Hors des schémas conventionnels de romans avec scènes d'amour ou d'action classiques, Straight Man nous emmène dans un monde peut-être inconnu, mais pas si complexe parce ce qu'au fond, ne serions-nous pas tous pareils, c'est à dire... complexes?
Une joyeuse lecture qui me confirme combien la littérature américaine est essentielle à cette culture obnubilée par l'image. Vivement l'imagination et la sagacité d'auteurs comme Richard Russo.
J'ai lu ce livre dans sa version originale anglaise. Il est traduit en français sous le (mauvais?) titre: Un rôle qui me convient, aux éditions 10/18.
mardi 18 décembre 2018
lundi 19 novembre 2018
L'abîme, par Kim Leine, éditions Gallimard
Deux jumeaux danois s'en vont en guerre.Jeunes, ils quittent leur terre natale pour s'engager en tant que volontaires pour lutter aux côtés de ceux qui combattent les bolchéviques dans la guerre civile en Finlande. On est en 1918, le monde est dans un état lamentable, et les deux jeunes gens aussi.
Leur mère est morte il y a longtemps. Ils en gardent un souvenir romantique. Leur père n'a trop que faire d'eux et se félicite de leur courage. Il s'installera confortablement, prendra une bonne qui prendra une certaine place, et dont il s'entichera du fils.
Puis les jumeaux reviendront, et ainsi ira le cours de leur existence, marqué par ce qu'ils ont vécu. D'aucuns diront qu'ils deviendront des êtres abjects, alors que d'autres les verront plutôt se transformer en personnages respectables. Héros ou brutes, ou les deux? Voilà tout l'Univers de Kim Leine.
Ce second livre est à l'image de l'excellent Prophètes du fjord de la liberté, où le bien sublime côtoie le mal extrême dans un récit historique où les lieux sont aussi mystérieux que les époques.
D'une violence rare mais vraiment pas gratuite, l'écriture de Leine est tranchante et superbement efficace. L'époque est si bien rendue que le livre devient rapidement un documentaire sur une période et un lieu qui nous était inconnus et qu'on s'étonne de découvrir avec fascination. Or ce qui fascine n'est pas toujours beau, et c'est là où excelle Leine, car bien qu'il nous brasse, il ne nous blesse pas pour autant. Bien sur, les adeptes du politiquement correct n'aimeront pas. Qu'il soit dit qu'on fume ici cigarette sur cigarette, qu'on baise souvent, qu'on tue aussi atrocement qu'une guerre puisse le permettre, et que les bons deviennent parfois des goujats. On est loin d'un fleuve tranquille.
L'histoire des frères Gottlieb est celle d'une époque, mais aussi un portrait de ce qu'est un monde sans amour. L'histoire est celle de gens qui cherchent toute leur vie de ce dont ils ont manqué. On ne peut qu'imaginer des résultats douloureux, car qui a souffert sait faire souffrir. Des deux frères, on en suivra surtout un. Avec lui, on traversera l'Europe des années 20, surtout l'Allemagne et le Danemark, mais aussi la France, la Suède. La période est trouble, les personnages aussi, et encore une fois, c'est littéralement enlevant. Ce qui ressemble au début à une chronique se transforme, pour la dernière partie du livre, en un thriller bien ficelé bien que peut-être un peu moins original puisqu'on est rendu aux temps de l'occupation nazie, période décrite tant et tant. Mais le décor est différent. Leine prend Copenhague comme les auteurs Français l'ont fait pour Paris, en décrivant la ville par le détail, en allant presque jusqu'à mythifier certains endroits ou événements.
Qui aime compléter une telle lecture par des références à des cartes (de la ville de Copenhague) ou des références historiques (sur l'occupation nazie et la résistance danoise) passera comme moi un excellent moment dans ce livre dur, touffu et fouillé. S'il s'attarde sur certains événements, Leine en évacuera d'autres tout aussi facilement. Aussi un premier lecteur de son oeuvre sera surpris de constater qu'on passe rapidement d'un lieu à un autre, ou d'un personnage à un autre assez rudement. C'est là le côté non-conventionnel de l'écriture de ce Norvégo-danois que j'aime de plus en plus.
Rude, limpide, dense et prenant, L'abîme me donne déjà l'envie d'un nouveau Kim Leine, ne serait-ce que pour savoir où il nous emmènera, et avec qui, bien qu'on sache déjà comment: brutalement.
Leur mère est morte il y a longtemps. Ils en gardent un souvenir romantique. Leur père n'a trop que faire d'eux et se félicite de leur courage. Il s'installera confortablement, prendra une bonne qui prendra une certaine place, et dont il s'entichera du fils.
Puis les jumeaux reviendront, et ainsi ira le cours de leur existence, marqué par ce qu'ils ont vécu. D'aucuns diront qu'ils deviendront des êtres abjects, alors que d'autres les verront plutôt se transformer en personnages respectables. Héros ou brutes, ou les deux? Voilà tout l'Univers de Kim Leine.
Ce second livre est à l'image de l'excellent Prophètes du fjord de la liberté, où le bien sublime côtoie le mal extrême dans un récit historique où les lieux sont aussi mystérieux que les époques.
D'une violence rare mais vraiment pas gratuite, l'écriture de Leine est tranchante et superbement efficace. L'époque est si bien rendue que le livre devient rapidement un documentaire sur une période et un lieu qui nous était inconnus et qu'on s'étonne de découvrir avec fascination. Or ce qui fascine n'est pas toujours beau, et c'est là où excelle Leine, car bien qu'il nous brasse, il ne nous blesse pas pour autant. Bien sur, les adeptes du politiquement correct n'aimeront pas. Qu'il soit dit qu'on fume ici cigarette sur cigarette, qu'on baise souvent, qu'on tue aussi atrocement qu'une guerre puisse le permettre, et que les bons deviennent parfois des goujats. On est loin d'un fleuve tranquille.
L'histoire des frères Gottlieb est celle d'une époque, mais aussi un portrait de ce qu'est un monde sans amour. L'histoire est celle de gens qui cherchent toute leur vie de ce dont ils ont manqué. On ne peut qu'imaginer des résultats douloureux, car qui a souffert sait faire souffrir. Des deux frères, on en suivra surtout un. Avec lui, on traversera l'Europe des années 20, surtout l'Allemagne et le Danemark, mais aussi la France, la Suède. La période est trouble, les personnages aussi, et encore une fois, c'est littéralement enlevant. Ce qui ressemble au début à une chronique se transforme, pour la dernière partie du livre, en un thriller bien ficelé bien que peut-être un peu moins original puisqu'on est rendu aux temps de l'occupation nazie, période décrite tant et tant. Mais le décor est différent. Leine prend Copenhague comme les auteurs Français l'ont fait pour Paris, en décrivant la ville par le détail, en allant presque jusqu'à mythifier certains endroits ou événements.
Qui aime compléter une telle lecture par des références à des cartes (de la ville de Copenhague) ou des références historiques (sur l'occupation nazie et la résistance danoise) passera comme moi un excellent moment dans ce livre dur, touffu et fouillé. S'il s'attarde sur certains événements, Leine en évacuera d'autres tout aussi facilement. Aussi un premier lecteur de son oeuvre sera surpris de constater qu'on passe rapidement d'un lieu à un autre, ou d'un personnage à un autre assez rudement. C'est là le côté non-conventionnel de l'écriture de ce Norvégo-danois que j'aime de plus en plus.
Rude, limpide, dense et prenant, L'abîme me donne déjà l'envie d'un nouveau Kim Leine, ne serait-ce que pour savoir où il nous emmènera, et avec qui, bien qu'on sache déjà comment: brutalement.
mercredi 24 octobre 2018
Walden, par Henry David Thoreau, éditions Gallmeister
Qu'un livre soit classé parmi les "classiques" le rend pompeux, impressionnant et souvent peu attrayant. Hors, le propos de celui-là m'appelait depuis longtemps. J'ai compris pourquoi. À partir de maintenant, Walden me suivra longtemps.
Généralement, ce qu'on sait de Walden est qu'il raconte l'expérience d'un homme qui part vivre dans les bois. C'est la première couche du livre. La seconde couche est superbe. C'est celle d'un homme qui propose sa version du bonheur, et c'est là où toutes mes appréhensions ont été chassées, d'autantplus qu'il n'y a rien là d'ésotérique.
Pourtant on sent que le bonhomme n'est pas parfait. Au début de son livre, on comprend que le monde qui l'entoure l'énerve parce que tous ne cessent de se plaindre, qui de ce que la vie est trop dure, on travaille trop, on n'a pas de temps pour autre chose, etc, qui parce que les autres sont trop rustres, pauvres, inintéressants alors qu'ailleurs c'est tellement mieux, etc. Les gens, selon Thoreau, ne sont jamais contents. Alors il leur propose cette démonstration: il ira, lui, vivre en autarcie dans la forêt, sur le bord d'un vaste étang, Walden, pas trop loin quand même de sa chère ville de Concord, Massachusetts, parce que ce monde-là, mes amis, il y a moyen de faire sans lui
Il racontera les petits métiers qui lui ont permis d'amasser assez d'argent pour se doter des matériaux avec lesquels il construit une petite cabane. Et il y a ses plants d'haricots qui lui tirent quelques profits. Puis viennent les chapitres où Thoreau décrit ce qui l'entoure, les saisons, l'environnement, mais aussi les gens qui lui rendent visite, bref, sa vie. Il y a dans ces pages d'étonnants ravissements.
Ce qui étonne d'abord, c'est l'oeil intéressé de l'observateur. Thoreau est l'exact contraire du blasé. Tout l'intéresse, car il faut dire que cet original est d'abord un érudit. Le bonhomme a lu plein de choses et il continue à le faire. Ce sont là ses voyages, et à travers le récit de sa vie solitaire, il raconte les parallèles qu'il fait entre son existence et ses connaissances. Écrit en 1845-47, Walden contient plusieurs références à des écrivains antérieurs à cette époque, tout particulièrement des passages de livres hindous. Moi qui n'y connaît rien, j'ai trouvé ça passionnant. L'édition de Gallmeister est particulièrement bien faite parce qu'elle contient des notes en bas de page juste assez nombreuses pour bien expliquer certaines références, voir certaines expressions de Thoreau. Du coup, le récit devient non seulement source d'inspiration, mais aussi de connaissances.
Et tout ça sans aucune prétention. C'est d'ailleurs un des mantras de Thoreau: les prétentieux n'ont rien d'intéressant. Rester vrai, être conscient de ce qui nous entoure, voilà toute la beauté du monde. Pour Thoreau, l'être le plus libre est le plus heureux, et qui que l'on soit, on choisit bien souvent ses propres chaines, qu'on soit pauvre comme Job ou riche comme Crésus. Il exprime ces idées en parlant de personnes rencontrées au gré de ses promenades ou des visites de curieux. Les classes sociales n'expriment rien pour lui. Seul le désir de vivre le moment présent et de savoir en retirer toute la richesse exprime la valeur d'une personne.
Pour terminer, il faut noter les dernières pages du livre, écrites par Ralph Waldo Emerson, un contemporain de Thoreau, qui parle de ce dernier et de son oeuvre. Le regard d'un ami aide à comprendre celui qu'on vient de lire. Le bonhomme n'était pas parfait, mais immensément sincère. L'apprendre ajoute à la valeur de ses mots.
Lire Walden plaira à qui sait qu'un temps d'arrêt n'équivaut pas pour autant à de l'immobilisme. J'ai pris mon temps pour le lire, et je suis content de l'avoir lu parce que oui, pour différentes raisons, il me suivra longtemps.
Généralement, ce qu'on sait de Walden est qu'il raconte l'expérience d'un homme qui part vivre dans les bois. C'est la première couche du livre. La seconde couche est superbe. C'est celle d'un homme qui propose sa version du bonheur, et c'est là où toutes mes appréhensions ont été chassées, d'autantplus qu'il n'y a rien là d'ésotérique.
Pourtant on sent que le bonhomme n'est pas parfait. Au début de son livre, on comprend que le monde qui l'entoure l'énerve parce que tous ne cessent de se plaindre, qui de ce que la vie est trop dure, on travaille trop, on n'a pas de temps pour autre chose, etc, qui parce que les autres sont trop rustres, pauvres, inintéressants alors qu'ailleurs c'est tellement mieux, etc. Les gens, selon Thoreau, ne sont jamais contents. Alors il leur propose cette démonstration: il ira, lui, vivre en autarcie dans la forêt, sur le bord d'un vaste étang, Walden, pas trop loin quand même de sa chère ville de Concord, Massachusetts, parce que ce monde-là, mes amis, il y a moyen de faire sans lui
Il racontera les petits métiers qui lui ont permis d'amasser assez d'argent pour se doter des matériaux avec lesquels il construit une petite cabane. Et il y a ses plants d'haricots qui lui tirent quelques profits. Puis viennent les chapitres où Thoreau décrit ce qui l'entoure, les saisons, l'environnement, mais aussi les gens qui lui rendent visite, bref, sa vie. Il y a dans ces pages d'étonnants ravissements.
Ce qui étonne d'abord, c'est l'oeil intéressé de l'observateur. Thoreau est l'exact contraire du blasé. Tout l'intéresse, car il faut dire que cet original est d'abord un érudit. Le bonhomme a lu plein de choses et il continue à le faire. Ce sont là ses voyages, et à travers le récit de sa vie solitaire, il raconte les parallèles qu'il fait entre son existence et ses connaissances. Écrit en 1845-47, Walden contient plusieurs références à des écrivains antérieurs à cette époque, tout particulièrement des passages de livres hindous. Moi qui n'y connaît rien, j'ai trouvé ça passionnant. L'édition de Gallmeister est particulièrement bien faite parce qu'elle contient des notes en bas de page juste assez nombreuses pour bien expliquer certaines références, voir certaines expressions de Thoreau. Du coup, le récit devient non seulement source d'inspiration, mais aussi de connaissances.
Et tout ça sans aucune prétention. C'est d'ailleurs un des mantras de Thoreau: les prétentieux n'ont rien d'intéressant. Rester vrai, être conscient de ce qui nous entoure, voilà toute la beauté du monde. Pour Thoreau, l'être le plus libre est le plus heureux, et qui que l'on soit, on choisit bien souvent ses propres chaines, qu'on soit pauvre comme Job ou riche comme Crésus. Il exprime ces idées en parlant de personnes rencontrées au gré de ses promenades ou des visites de curieux. Les classes sociales n'expriment rien pour lui. Seul le désir de vivre le moment présent et de savoir en retirer toute la richesse exprime la valeur d'une personne.
Pour terminer, il faut noter les dernières pages du livre, écrites par Ralph Waldo Emerson, un contemporain de Thoreau, qui parle de ce dernier et de son oeuvre. Le regard d'un ami aide à comprendre celui qu'on vient de lire. Le bonhomme n'était pas parfait, mais immensément sincère. L'apprendre ajoute à la valeur de ses mots.
Lire Walden plaira à qui sait qu'un temps d'arrêt n'équivaut pas pour autant à de l'immobilisme. J'ai pris mon temps pour le lire, et je suis content de l'avoir lu parce que oui, pour différentes raisons, il me suivra longtemps.
lundi 15 octobre 2018
À son image, par Jérome Ferrari, éditions Actes sud
C'est l'histoire d'une jeune femme à travers les photos qu'elle a prises. Ce sont aussi des histoires de photographes qui ont contribué à la reconnaissance de ce qu'est devenu la photographie. C'est enfin qui nous permet de distinguer ce qui dure, dans notre vie, en comparaison de ce qui passe ou de ce qui a passé, de l'éternel en fonction de l'éphémère, du long en comparaison à ce qui est court.
Décédée précocement dans un accident de voiture, et ce dès le début du livre, une jeune femme laisse dans le deuil des membres d'une famille tristement traditionnelle et de rares amis plus ou moins proches. De sa vie, on aura retenu son intérêt pour la photo, seule chose qui l'aura fait sortir du cadre très étroit de sa vie personnelle, où rien ni personne n'a su ni pu mettre une couleur particulière, si ce ne sont que quelques images qui sont restées après elle.
Cette histoire se passe en Corse, à l'époque où des mouvements indépendantistes faisaient sentir leur présence dans une population plus ou moins complaisante à leur égard. Mêlée à eux tant dans sa vie amoureuse que professionnelle, elle vivra les longues attentes et les espoirs inassouvis des choses qui durent sans jamais vouloir aboutir. Cette vie personnelle deviendra vite presque pathétique alors que du côté de son intérêt pour la photo, s'ouvriront des possibilités de s'en sortir.
Parallèlement à cette jeune femme, l'auteur met en scène son parrain, le jeune frère de sa mère, prêtre catholique qui, malgré sa profession, sera celui par qui arrivera le changement, genre de démon tentateur voulant faire le bien en détournant sa nièce de sa vie sans issue, dans un monde qui l'inspire, lui, de moins en moins.
Jérome Ferrari écrit magnifiquement bien. Chaque mot a sa place dans chacune de ses phrases, sans superflu, sans omission. C'est rare. Un tel style permet de décrire en douceur les pires atrocités et en détails les choses les plus enfouies. Documenté, il est allé chercher, pour cet ouvrage, des bribes peu ou pas connues de l'histoire de la photographie à travers des personnages vraiment captivants. Deux "histoires dans l'histoire" se démarquent particulièrement. Un peu déstabilisantes, parce que différents de l'histoire qu'on est en train de lire, ces portions du livre ajoutent toutefois à l'atmosphère générale de passion latente, de désir d'aller plus loin, de se laisser aller à découvrir le monde et de capter des images, comme on capte des instants de vie.
Étonnant à plusieurs égards, À son image ravira ceux qui avaient aimé les livres précédents de Jérome Ferrari, décidément un grand auteur à suivre.
Décédée précocement dans un accident de voiture, et ce dès le début du livre, une jeune femme laisse dans le deuil des membres d'une famille tristement traditionnelle et de rares amis plus ou moins proches. De sa vie, on aura retenu son intérêt pour la photo, seule chose qui l'aura fait sortir du cadre très étroit de sa vie personnelle, où rien ni personne n'a su ni pu mettre une couleur particulière, si ce ne sont que quelques images qui sont restées après elle.
Cette histoire se passe en Corse, à l'époque où des mouvements indépendantistes faisaient sentir leur présence dans une population plus ou moins complaisante à leur égard. Mêlée à eux tant dans sa vie amoureuse que professionnelle, elle vivra les longues attentes et les espoirs inassouvis des choses qui durent sans jamais vouloir aboutir. Cette vie personnelle deviendra vite presque pathétique alors que du côté de son intérêt pour la photo, s'ouvriront des possibilités de s'en sortir.
Parallèlement à cette jeune femme, l'auteur met en scène son parrain, le jeune frère de sa mère, prêtre catholique qui, malgré sa profession, sera celui par qui arrivera le changement, genre de démon tentateur voulant faire le bien en détournant sa nièce de sa vie sans issue, dans un monde qui l'inspire, lui, de moins en moins.
Jérome Ferrari écrit magnifiquement bien. Chaque mot a sa place dans chacune de ses phrases, sans superflu, sans omission. C'est rare. Un tel style permet de décrire en douceur les pires atrocités et en détails les choses les plus enfouies. Documenté, il est allé chercher, pour cet ouvrage, des bribes peu ou pas connues de l'histoire de la photographie à travers des personnages vraiment captivants. Deux "histoires dans l'histoire" se démarquent particulièrement. Un peu déstabilisantes, parce que différents de l'histoire qu'on est en train de lire, ces portions du livre ajoutent toutefois à l'atmosphère générale de passion latente, de désir d'aller plus loin, de se laisser aller à découvrir le monde et de capter des images, comme on capte des instants de vie.
Étonnant à plusieurs égards, À son image ravira ceux qui avaient aimé les livres précédents de Jérome Ferrari, décidément un grand auteur à suivre.
mardi 25 septembre 2018
Jeune homme, par Karl Ove Knaussgard, éditions Folio (Poche)
Knaussgard est sans doute le seul auteur dont je me demande encore pourquoi je le lis. Et pourtant, ce troisième livre de sa série Mon combat ne sera pas mon dernier. Je lirai le quatrième, parce qu'à mon avis, ce troisième était encore meilleur... non, c'est plutôt que j'ai préféré ce troisième aux deux précédents.
On dirait que je me demande si le livre est bon. C'est bel et bien le cas. En lisant Knaussgard, je suis littéralement un chien dans une allée de quilles. Au risque de me répéter, je n'ai aucune raison d'aimer cette série de livres et si on ne m'avait pas offert le premier, je n'aurait jamais rien lu de lui, surtout à voir tout ce qu'on dit sur lui.
Le Norvégien Knaussgard est très connu en Scandinavie pour cette série où il raconte sa vie. Or il ne s'agit pas d'une biographie. On dirait plutôt le script d'une télé-réalité. Moi qui n'ait jamais écouté que de petits extraits par-ci par-là de ce type d'émission, j'en ai assez vu pour savoir que le genre est à 10 000 lieues de ce qui puisse me divertir. Bon, un livre ne peut pas raconter le temps réel, bien entendu, mais voilà, Knaussgard a trouvé la formule qui s'en rapproche le mieux. Le style est simplissime, la traduction est correcte. Le décor est simplissime, les personnages sont corrects. Rien n'est éloquent, rien ne s'emporte, mais rien ne descend non plus. On lit Knaussgard comme on écoute une logorrhée interminable mais fascinante. Cette personne, fort bien avisée, qui m'avait remis La mort d'un père, son premier livre, m'avait dit de lui qu'il écrivait de la drogue. C'est exactement ça, on point de divertir un blogueur aussi prétentieux (?) que moi.
Après avoir parlé de la relation avec son père, puis de celle avec sa conjointe, l'auteur aborde maintenant son enfance, entre 8 et 13 ans environ. Ici, l'entourage prend toute son importance les enfants du quartier, la famille nucléaire, les grands-parents. Son histoire comprend toutes les fascinations et les peurs du monde des enfants, soit autant de sentiments qu'on a tous éprouvés, quelque soit notre histoire personnelle. Qui plus est, son contexte d'enfant élevé dans une petite ville du Nord (de la planète) dans les années 70-80 a tout pour rejoindre celui qui vous lisez présentement. Outre ses relations avec les autres, Knaussgard aborde aussi de très belle façon sa relation avec son environnement. Il sait vous décrire un petit lundi matin triste dans une cuisine familiale qu'un vendredi soir plein de promesse dans une chambre de pré-ado, tout comme l'odeur et la couleur d'un sentier, d'un couloir d'école ou de la maison de grands-parents. Un peu plus et je vous lâche l'expressions "écriture réconfortante". Or attention, Knaussgard n'a aucun filtre ni aucune notion de politiquement correcte. On pourra aussi lui reprocher quelques énumérations de personnages connus de son pays, ou de villes, de régions qui nous sont inconnues. Bien que rares, ces énumérations peuvent sembler lourdes. Pourtant, elles ajoutent au caractère authentique de l'écriture. En fait, cet auteur écrit comme une personne connue vous raconterait un événement plutôt anodin avec juste assez de détails pour qu'il sache capter votre attention du début à la fin.
Réel phénomène, Karl Ove Knaussgard a l'immense mérite de me sortir de ma zone de confort... pour m'en faire découvrir une nouvelle. Ça devrait m'inquiéter, mais non, je n'achèterai pas de magazine people pour autant. Ses livres sont bien meilleurs que ça.
On dirait que je me demande si le livre est bon. C'est bel et bien le cas. En lisant Knaussgard, je suis littéralement un chien dans une allée de quilles. Au risque de me répéter, je n'ai aucune raison d'aimer cette série de livres et si on ne m'avait pas offert le premier, je n'aurait jamais rien lu de lui, surtout à voir tout ce qu'on dit sur lui.
Le Norvégien Knaussgard est très connu en Scandinavie pour cette série où il raconte sa vie. Or il ne s'agit pas d'une biographie. On dirait plutôt le script d'une télé-réalité. Moi qui n'ait jamais écouté que de petits extraits par-ci par-là de ce type d'émission, j'en ai assez vu pour savoir que le genre est à 10 000 lieues de ce qui puisse me divertir. Bon, un livre ne peut pas raconter le temps réel, bien entendu, mais voilà, Knaussgard a trouvé la formule qui s'en rapproche le mieux. Le style est simplissime, la traduction est correcte. Le décor est simplissime, les personnages sont corrects. Rien n'est éloquent, rien ne s'emporte, mais rien ne descend non plus. On lit Knaussgard comme on écoute une logorrhée interminable mais fascinante. Cette personne, fort bien avisée, qui m'avait remis La mort d'un père, son premier livre, m'avait dit de lui qu'il écrivait de la drogue. C'est exactement ça, on point de divertir un blogueur aussi prétentieux (?) que moi.
Après avoir parlé de la relation avec son père, puis de celle avec sa conjointe, l'auteur aborde maintenant son enfance, entre 8 et 13 ans environ. Ici, l'entourage prend toute son importance les enfants du quartier, la famille nucléaire, les grands-parents. Son histoire comprend toutes les fascinations et les peurs du monde des enfants, soit autant de sentiments qu'on a tous éprouvés, quelque soit notre histoire personnelle. Qui plus est, son contexte d'enfant élevé dans une petite ville du Nord (de la planète) dans les années 70-80 a tout pour rejoindre celui qui vous lisez présentement. Outre ses relations avec les autres, Knaussgard aborde aussi de très belle façon sa relation avec son environnement. Il sait vous décrire un petit lundi matin triste dans une cuisine familiale qu'un vendredi soir plein de promesse dans une chambre de pré-ado, tout comme l'odeur et la couleur d'un sentier, d'un couloir d'école ou de la maison de grands-parents. Un peu plus et je vous lâche l'expressions "écriture réconfortante". Or attention, Knaussgard n'a aucun filtre ni aucune notion de politiquement correcte. On pourra aussi lui reprocher quelques énumérations de personnages connus de son pays, ou de villes, de régions qui nous sont inconnues. Bien que rares, ces énumérations peuvent sembler lourdes. Pourtant, elles ajoutent au caractère authentique de l'écriture. En fait, cet auteur écrit comme une personne connue vous raconterait un événement plutôt anodin avec juste assez de détails pour qu'il sache capter votre attention du début à la fin.
Réel phénomène, Karl Ove Knaussgard a l'immense mérite de me sortir de ma zone de confort... pour m'en faire découvrir une nouvelle. Ça devrait m'inquiéter, mais non, je n'achèterai pas de magazine people pour autant. Ses livres sont bien meilleurs que ça.
lundi 24 septembre 2018
L'Archipel du Chien, de Philippe Claudel, éditions Stock
C'est une petite île isolée où la vie est rude et les gens aussi. Dans le petit village, tous se connaissent. Le maire emploie aussi beaucoup de monde, le docteur est son grand ami, et il y a le curé, l'enseignante à la retraite et... le nouvel enseignant, nouvel arrivé avec sa famille. Voilà qu'ils feront une découverte qui risque de changer le cours de l'histoire de leur île paisible. Sans dire exactement de quoi il s'agit, disons que le fait est fortement inspiré d'événements qui touchent les plages de plusieurs pays d'Europe du Sud ces derniers temps.
Ces personnages sont très typés. Comme dans Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel utilise des personnages aux traits tout droit tirés d'une bande dessinée. Chez cet auteur, l'identité est très importante, et par le fait même, la différence, qui est le thème de ce livre. Qu'est-ce qu'on fait avec la différence? Qui dérange-t-elle vraiment?
Dans ce qui ressemble un peu à une fable, sous certains aspects, l'auteur oppose deux sociétés: la conservatrice, celle qui préfère que tout reste tel quel, et la progressiste, celle qui participe au monde et à son évolution. À la limite de la caricature, les tenants du premier groupe n'ont pas la part belle, mais quels personnages on a là! De mauvaise foi, hypocrites, fourbes, on leur donnerait difficilement le bon dieu sans confession. Mais derrière tout ça, il y a une misère, un mal de vivre que Claudel nous fait ressentir grâce à ses descriptions efficaces, très imagées. L'autre camp, représenté par l'enseignant et un autre personnage, venu d'ailleurs lui aussi, est aussi décrit dans ses forces et ses faiblesses, ce qui rend ces personnages aussi forts que leurs opposants.
Certains diront que c'est gros. Claudel a en effet un style que je dirais très imagé, théâtral, même, loin de la description d'un lieu ou d'un personnage complètement réel. J'avoue prendre beaucoup de plaisir à le lire, parce ses dialogues ou ses descriptions font parfois sourire et beaucoup réfléchir. Aussi, la fin peut paraître un peu grosse, ce qui peut en laisser certains pantois. Pour ma part, c'est tout à fait en ligne avec la narration de cette histoire qui nous montre combien ce monde a encore bien des croûtes à manger pour prétendre être parfait. Mais si joliment raconté, ça nous dérange un peu moins.
Ces personnages sont très typés. Comme dans Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel utilise des personnages aux traits tout droit tirés d'une bande dessinée. Chez cet auteur, l'identité est très importante, et par le fait même, la différence, qui est le thème de ce livre. Qu'est-ce qu'on fait avec la différence? Qui dérange-t-elle vraiment?
Dans ce qui ressemble un peu à une fable, sous certains aspects, l'auteur oppose deux sociétés: la conservatrice, celle qui préfère que tout reste tel quel, et la progressiste, celle qui participe au monde et à son évolution. À la limite de la caricature, les tenants du premier groupe n'ont pas la part belle, mais quels personnages on a là! De mauvaise foi, hypocrites, fourbes, on leur donnerait difficilement le bon dieu sans confession. Mais derrière tout ça, il y a une misère, un mal de vivre que Claudel nous fait ressentir grâce à ses descriptions efficaces, très imagées. L'autre camp, représenté par l'enseignant et un autre personnage, venu d'ailleurs lui aussi, est aussi décrit dans ses forces et ses faiblesses, ce qui rend ces personnages aussi forts que leurs opposants.
Certains diront que c'est gros. Claudel a en effet un style que je dirais très imagé, théâtral, même, loin de la description d'un lieu ou d'un personnage complètement réel. J'avoue prendre beaucoup de plaisir à le lire, parce ses dialogues ou ses descriptions font parfois sourire et beaucoup réfléchir. Aussi, la fin peut paraître un peu grosse, ce qui peut en laisser certains pantois. Pour ma part, c'est tout à fait en ligne avec la narration de cette histoire qui nous montre combien ce monde a encore bien des croûtes à manger pour prétendre être parfait. Mais si joliment raconté, ça nous dérange un peu moins.
lundi 20 août 2018
Naufrage, de Biz, éditions Leméac
C'est une histoire terrible, horrible, mais magnifiquement écrite. Le sentiment qu'on éprouve à la fin du livre, pas très long d'ailleurs, il faut le dire, donc chapeau pour la force de l'émotion quand même ressentie, est la même qu'au sortir de l'Adversaire, d'Emmanuel Carrère. Coeur sensibles s'abstenir, et amateurs de grande littérature québécoise, se précipiter.
Un homme travaille dans la fonction publique. On parle ici d'un travail de bureau, comme tant d'autres, qu'importe ce qu'il fabrique, le milieu est celui dépeint sur la couverture du livre. Victime de "mesures administratives", cet homme se retrouve relégué dans les oubliettes de l'administration publique. D'autres diront qu'il est "tabletté". S'ensuit une remise en question, une dévalorisation, une descente aux abimes jusqu'à ce qu'un drame horrible survienne dans la vie de cet homme. Quelque chose d'épouvantable.
Débute alors ce qui est pratiquement un deuxième livre. La mesure de l'événement est telle qu'on en vient presqu'à oublier sa prémisse. Certains pourront reprocher cette cassure dans le fil narratif. J'ai failli le faire. Mais j'ai oublié les reproches au bout des petites conquêtes par lesquelles Biz est venu me chercher malgré cette histoire qui n'a rien de jojo. J'ai été conquis par ses mots bien choisis, pas ses descriptions d'un souvenir, d'une analogie, d'un personnage, dont il fait le tour en deux coups de cuillère à pot, en deux phrases ou en un seul paragraphe. Précis, Biz sait plaider sa cause en allant chercher notre assentiment par ces petites choses semées ici et là qui nous font réaliser que oui, c'est vrai, j'aurais décris ça comme ça ou oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça comme ça.
Bien sur, on sort secoué, d'autant plus que la situation ici décrite rejoint beaucoup celle décrite, encore plus succinctement, dans Dérives. On pourrait croire que Biz a trouvé un pattern avec les histoires de mal à l'âme, mais c'est beaucoup plus que ça. Je crois qu'on a avec cet auteur un fin observateur de notre société, même dans ce qu'elle a de plus caché, de plus tabou. En parler dérange toujours, et le plus souvent, ça heurte. Mais lorsque c'est écrit finement comme ça, on est prêt à en reprendre encore... si le chapeau nous fait, bien entendu.
Un homme travaille dans la fonction publique. On parle ici d'un travail de bureau, comme tant d'autres, qu'importe ce qu'il fabrique, le milieu est celui dépeint sur la couverture du livre. Victime de "mesures administratives", cet homme se retrouve relégué dans les oubliettes de l'administration publique. D'autres diront qu'il est "tabletté". S'ensuit une remise en question, une dévalorisation, une descente aux abimes jusqu'à ce qu'un drame horrible survienne dans la vie de cet homme. Quelque chose d'épouvantable.
Débute alors ce qui est pratiquement un deuxième livre. La mesure de l'événement est telle qu'on en vient presqu'à oublier sa prémisse. Certains pourront reprocher cette cassure dans le fil narratif. J'ai failli le faire. Mais j'ai oublié les reproches au bout des petites conquêtes par lesquelles Biz est venu me chercher malgré cette histoire qui n'a rien de jojo. J'ai été conquis par ses mots bien choisis, pas ses descriptions d'un souvenir, d'une analogie, d'un personnage, dont il fait le tour en deux coups de cuillère à pot, en deux phrases ou en un seul paragraphe. Précis, Biz sait plaider sa cause en allant chercher notre assentiment par ces petites choses semées ici et là qui nous font réaliser que oui, c'est vrai, j'aurais décris ça comme ça ou oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça comme ça.
Bien sur, on sort secoué, d'autant plus que la situation ici décrite rejoint beaucoup celle décrite, encore plus succinctement, dans Dérives. On pourrait croire que Biz a trouvé un pattern avec les histoires de mal à l'âme, mais c'est beaucoup plus que ça. Je crois qu'on a avec cet auteur un fin observateur de notre société, même dans ce qu'elle a de plus caché, de plus tabou. En parler dérange toujours, et le plus souvent, ça heurte. Mais lorsque c'est écrit finement comme ça, on est prêt à en reprendre encore... si le chapeau nous fait, bien entendu.
lundi 30 juillet 2018
4321, de Paul Auster, éditions Actes Sud
C'est l'histoire de Ferguson, un Américain né au New Jersey, dans la banlieue newyorkaise dans les années 40. Ses parents se rencontrent, se marient, le conçoivent. Il naît, grandi, vieillit... quatre fois. Chapitre 1.2: première histoire de Ferguson. Chapitre 1.2: seconde histoire, et ainsi de suite. Puis ça se poursuit à 2.1, 2.2, etc. À chaque histoire, c'est le même Ferguson avec les mêmes parents, mais l'histoire de chacun différera légèrement. Les personnages les entourant différeront aussi un peu d'une histoire à l'autre, leurs destins prendront des directions différentes d'un Ferguson à l'autre.
Chaque Ferguson proviendra du même terroir, à proximité de New York, vers lequel tendra chacun des Ferguson adolescents. Chacun traversera la même époque, avec les mêmes bouleversements, les mêmes espoirs, le même environnement. La banlieue, les amis, le baseball, les livres, les années 50, puis 60. Kennedy, MLK, mai 68. Tout ça quatre fois.
Pourquoi? Tout le livre est dans cette question qui contient la réponse dans les dernières pages. Comment? En 1018 pages.
D'habitude, de telles briques ne m'attirent pas nécessairement. Dans ce cas précis, c'est plutôt Paul Auster qui m'a attiré. Pourtant, j'ai eu beau essayer de me rappeler tous ses derniers livres que j'avais lu, je n'ai pas réussi. Seuls quelques une me revenaient en tête, par bribes. Si peu m'ont marqué, m'est resté une atmosphère. Les livres de Paul Auster laissent toujours une impression de beauté étrange, de meilleur à venir. Ces 1018 pages me semblaient prétentieuses. Je ne voyais pas pourquoi, outre son âge avancé, Auster se permettait une telle fantaisie. Avec autant de pages, je m'attends généralement à ce que plusieurs soient de trop. Inévitablement. Lire un tel livre, c'est comme entrer en relation à long terme, enfin, si on le compare aux autres: il y aura des longueurs, mais il faudra au moins de l'amour pour que ça tienne.
Ça a tenu. Le début est fascinant. Puis on avance et on constate qu'on vivra, avec ce personnage reproduit quatre fois, dans un décor qu'on devra aimer parce qu'il sera lui aussi un des personnages principaux. Ce décor, c'est l'histoire de cette partie du monde dans les années 50 et 60, principalement, l'histoire d'une époque où tout semblait permis jusqu'à ce que ça se mettre à sérieusement déraper. On sentira le désir de vie de banlieue des parents et celui d'en sortir des plus jeunes. On sentira le New York disparate, riche et pauvre, bigarré, sous tension. On vivra les émeutes raciales d'alors, mai 68 à l'université Columbia, Kennedy se fera assassiner plus d'une fois.
Pendant ce temps, Ferguson vivra entre sport et littérature. On croira voir la naissance d'un écrivain, ou d'un journaliste, ou d'un intellectuel raté. On visitera des appartements d'étudiants, on ira même à Paris. C'est Paul Auster: non seulement on se divertit, mais on apprend, aussi.
À force, on devient accro. On est contaminé par ce livre qui nous donne envie d'aller au cinéma, voir de vieux films, lire des classiques, écouter le baseball à la radio... même si le baseball ne nous dit rien, qu'on connaît peu les classiques de cinéma... ou qu'on ait eu une enfance sans histoire.
J'aime que 4321 ne soit pas recommandable aux plus politiquement corrects. Parce que Paul Auster ne donne ni dans les licornes, ni dans le maquillage épais. On y fume à presque chaque page et à partir d'un moment, on y baise allègrement. On va même dans des directions qu'on n'aurait pas cru qu'Auster prenne. Mais justement c'est Paul Auster, et encore une fois, c'est étrangement beau, jamais trop, toujours bien tourné, et on tourne les pages en espérant toujours mieux, on se demande toujours où on ira avec lui. Puis paf! Il nous sort de notre enchantement d'un grand coup en pleine gueule. On perd le souffle... et on recommence, et on repart pour une autre centaine de pages.
Ce livre me suivra longtemps. Sa fin est sublime parce que crédible, intelligente. Oui, c'était prétentieux de sa part. c'était risqué aussi. Plusieurs n'aimeront pas et abandonneront à force de pincer les lèvres ou de soulever les sourcils. Mais si on aime, on rira avec lui, on s'essuiera parfois les yeux, et à la fin, on déposera ce livre, pour longtemps, au rayon de ceux qu'on a préféré depuis qu'on lit.
Toute une expérience!
Chaque Ferguson proviendra du même terroir, à proximité de New York, vers lequel tendra chacun des Ferguson adolescents. Chacun traversera la même époque, avec les mêmes bouleversements, les mêmes espoirs, le même environnement. La banlieue, les amis, le baseball, les livres, les années 50, puis 60. Kennedy, MLK, mai 68. Tout ça quatre fois.
Pourquoi? Tout le livre est dans cette question qui contient la réponse dans les dernières pages. Comment? En 1018 pages.
D'habitude, de telles briques ne m'attirent pas nécessairement. Dans ce cas précis, c'est plutôt Paul Auster qui m'a attiré. Pourtant, j'ai eu beau essayer de me rappeler tous ses derniers livres que j'avais lu, je n'ai pas réussi. Seuls quelques une me revenaient en tête, par bribes. Si peu m'ont marqué, m'est resté une atmosphère. Les livres de Paul Auster laissent toujours une impression de beauté étrange, de meilleur à venir. Ces 1018 pages me semblaient prétentieuses. Je ne voyais pas pourquoi, outre son âge avancé, Auster se permettait une telle fantaisie. Avec autant de pages, je m'attends généralement à ce que plusieurs soient de trop. Inévitablement. Lire un tel livre, c'est comme entrer en relation à long terme, enfin, si on le compare aux autres: il y aura des longueurs, mais il faudra au moins de l'amour pour que ça tienne.
Ça a tenu. Le début est fascinant. Puis on avance et on constate qu'on vivra, avec ce personnage reproduit quatre fois, dans un décor qu'on devra aimer parce qu'il sera lui aussi un des personnages principaux. Ce décor, c'est l'histoire de cette partie du monde dans les années 50 et 60, principalement, l'histoire d'une époque où tout semblait permis jusqu'à ce que ça se mettre à sérieusement déraper. On sentira le désir de vie de banlieue des parents et celui d'en sortir des plus jeunes. On sentira le New York disparate, riche et pauvre, bigarré, sous tension. On vivra les émeutes raciales d'alors, mai 68 à l'université Columbia, Kennedy se fera assassiner plus d'une fois.
Pendant ce temps, Ferguson vivra entre sport et littérature. On croira voir la naissance d'un écrivain, ou d'un journaliste, ou d'un intellectuel raté. On visitera des appartements d'étudiants, on ira même à Paris. C'est Paul Auster: non seulement on se divertit, mais on apprend, aussi.
À force, on devient accro. On est contaminé par ce livre qui nous donne envie d'aller au cinéma, voir de vieux films, lire des classiques, écouter le baseball à la radio... même si le baseball ne nous dit rien, qu'on connaît peu les classiques de cinéma... ou qu'on ait eu une enfance sans histoire.
J'aime que 4321 ne soit pas recommandable aux plus politiquement corrects. Parce que Paul Auster ne donne ni dans les licornes, ni dans le maquillage épais. On y fume à presque chaque page et à partir d'un moment, on y baise allègrement. On va même dans des directions qu'on n'aurait pas cru qu'Auster prenne. Mais justement c'est Paul Auster, et encore une fois, c'est étrangement beau, jamais trop, toujours bien tourné, et on tourne les pages en espérant toujours mieux, on se demande toujours où on ira avec lui. Puis paf! Il nous sort de notre enchantement d'un grand coup en pleine gueule. On perd le souffle... et on recommence, et on repart pour une autre centaine de pages.
Ce livre me suivra longtemps. Sa fin est sublime parce que crédible, intelligente. Oui, c'était prétentieux de sa part. c'était risqué aussi. Plusieurs n'aimeront pas et abandonneront à force de pincer les lèvres ou de soulever les sourcils. Mais si on aime, on rira avec lui, on s'essuiera parfois les yeux, et à la fin, on déposera ce livre, pour longtemps, au rayon de ceux qu'on a préféré depuis qu'on lit.
Toute une expérience!
mardi 24 juillet 2018
L'ombre des chats, par Arni Thorarinsson, éditions Points
Voici un roman policier islandais qui ravira les amateurs d'élucidation d'intrigues où il est question d'au moins trois crimes majeurs: deux morts simultanées suspectes, une agression grave et un cas de cyber intimidation. Tout ça gravite autour du journaliste d'un quotidien local, qui enquêtera, parfois malgré lui, sur tous ces fronts à la fois.
Comme pour la quantité de crimes commis (j'omets aussi un vol et des détournements de fonds), il y a beaucoup de monde dans la vie du journaliste, dont un enquêteur de la police, une ex-conjointe et des collègues de travail. Et bien que tout ce beau monde soit islandais pour la plupart, tous proviennent de milieux différents. C'est là où l'intrigue devient intéressante. D'une communauté gay plutôt bobo en passant par la société politique locale et les employés d'un snack bar, Arni campe l'action loin de certains clichés du style polar comme des lieux sordides, policiers ou teintés de maladies psychiques. Ici, tout le monde est banal au premier rapport, mais voilà que les événements qui impliquent ces gens ne sont pas banals. C'en est même un peu surprenant, et on ne peut pas accuser l'auteur de manquer d'originalité. Mais, me direz-vous, c'est un roman policier. On ne peut quand même pas faire comme si la vie y était un long fleuve tranquille! C'est pourtant ce que je peux apprécier dans ce type de roman que je n'apprécie toujours pas tant que ça: l'absence d'absurdités. On n'en est pas là avec L'ombre des chats, enfin, pas trop. Si les situations autour desquelles gravitent les crimes sont parfois incongrues, elles n'en sont pas pour autant loufoques.
Chose certaine, l'amateur de résolution d'énigmes sera ravi. Les prétextes pour se poser des questions comme: Qui? Pourquoi? Comment? ou Quand? pullulent. Il me semble qu'un crime ou deux en moins auraient pu tout aussi bien faire l'affaire, mais bon...
Avec des personnages sympathiques, dont un issu d'une aventure antérieure à ce roman du personnage principal (qui ne l'a pas lu se demandera un peu ce que cette personne fait là), un environnement adéquat et des intrigues à profusion, on dirait bien qu'il s'agit là d'un bon polar... ceci dit de la part d'un blogueur qui préfère ne pas en lire trop souvent.
Comme pour la quantité de crimes commis (j'omets aussi un vol et des détournements de fonds), il y a beaucoup de monde dans la vie du journaliste, dont un enquêteur de la police, une ex-conjointe et des collègues de travail. Et bien que tout ce beau monde soit islandais pour la plupart, tous proviennent de milieux différents. C'est là où l'intrigue devient intéressante. D'une communauté gay plutôt bobo en passant par la société politique locale et les employés d'un snack bar, Arni campe l'action loin de certains clichés du style polar comme des lieux sordides, policiers ou teintés de maladies psychiques. Ici, tout le monde est banal au premier rapport, mais voilà que les événements qui impliquent ces gens ne sont pas banals. C'en est même un peu surprenant, et on ne peut pas accuser l'auteur de manquer d'originalité. Mais, me direz-vous, c'est un roman policier. On ne peut quand même pas faire comme si la vie y était un long fleuve tranquille! C'est pourtant ce que je peux apprécier dans ce type de roman que je n'apprécie toujours pas tant que ça: l'absence d'absurdités. On n'en est pas là avec L'ombre des chats, enfin, pas trop. Si les situations autour desquelles gravitent les crimes sont parfois incongrues, elles n'en sont pas pour autant loufoques.
Chose certaine, l'amateur de résolution d'énigmes sera ravi. Les prétextes pour se poser des questions comme: Qui? Pourquoi? Comment? ou Quand? pullulent. Il me semble qu'un crime ou deux en moins auraient pu tout aussi bien faire l'affaire, mais bon...
Avec des personnages sympathiques, dont un issu d'une aventure antérieure à ce roman du personnage principal (qui ne l'a pas lu se demandera un peu ce que cette personne fait là), un environnement adéquat et des intrigues à profusion, on dirait bien qu'il s'agit là d'un bon polar... ceci dit de la part d'un blogueur qui préfère ne pas en lire trop souvent.
jeudi 31 mai 2018
Entrez dans la danse, par Jean Teulé, éditions Julliard
Je suis loin d'avoir tout lu de Teulé, mais son Charly 9 m'avait énormément plu. Avec Entrez dans la danse, j'ai retrouvé l'auteur qui sait marier style loufoque, scènes horribles et contexte historique.
Dès l'entrée, deux scènes se succèdent où horreur et révulsion sont les moindres des sentiments qu'on éprouve. Disons-le, c'est rébarbatif. Puis, sans trop de flafla, on entre sitôt après dans le vif du sujet, c'est à dire qu'un personnage se met à danser dans la rue.
On est à Strasbourg en 1518. La ville, autrefois prospère, est en pleine canicule combinée à une sécheresse, fléaux qui en jouxtent bien d'autres: peste, famine, perte de récoltes, rien ne va plus pour le petit peuple. Cette misère extrême en poussera certains à l'accomplissement d'actes épouvantables comme ceux décrits d'entrée de jeu et dont je vous épargne la description. C'est à la suite d'un tel acte qu'un personnage prendra la rue et se mettra à danser comme une folle, comme ça, sans raison. À sa vue, plusieurs la suivent et font pareil. Et voilà que le mouvement grossit et que ça ne s'arrête plus. Bientôt, une majeure partie de la ville passe son temps à danser sans arrêt dans les rues, et bien souvent jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais qu'est-ce qui explique ça?
Teulé fait sa propre interprétation de ce fait tiré de l'histoire réelle de la ville de Strasbourg en mettant en scène des personnages existants et sans doute inventés. Parmi les existants, on remarque le maire, bien embêté, et l'évêque, scandalisé. Or, les greniers de ce dernier débordent et le maire le sait. S'ensuivent les affrontements que l'on devine entre le civil et le religieux. Avec les mots de Jean Teulé, ceci constitue les moments les plus truculents du livre. Cet auteur a des dialogues bédéesques où les expressions empruntées frôlent l'anachronisme, et c'est là, avec la recherche historique, ce que je préfère de Jean Teulé. Par contre, là où ça passe plus bizarrement, c'est dans l'histoire des pauvres victimes. Les situations décrites sont tragiques. On imagine que la situation l'était, oui, mais il y a quelque chose qui m'a fait souvent penser qu'on était dans le "trop". Oui, on en apprend un peu des métiers exercés, des conditions sociales de chacun, mais j'aurais aimé que Teulé développe davantage la psychologie de ces personnages sans doute inventés, mais pourtant au coeur de cet événement. On devrait ressentir une tristesse, de l'empathie, mais non...
Bref, pour l'ambiance historique, l'anecdote historique et la forme écrite: oui, mais pour le scénario, je reste un peu sur ma faim. Si vous ne connaissez pas Jean Teulé, je vous suggère fortement Charly 9. Un personnage historique réel (le roi français Charles IX) qui ne l'a pas eu facile. Raconté par Teulé, c'est jouissif.
Dès l'entrée, deux scènes se succèdent où horreur et révulsion sont les moindres des sentiments qu'on éprouve. Disons-le, c'est rébarbatif. Puis, sans trop de flafla, on entre sitôt après dans le vif du sujet, c'est à dire qu'un personnage se met à danser dans la rue.
On est à Strasbourg en 1518. La ville, autrefois prospère, est en pleine canicule combinée à une sécheresse, fléaux qui en jouxtent bien d'autres: peste, famine, perte de récoltes, rien ne va plus pour le petit peuple. Cette misère extrême en poussera certains à l'accomplissement d'actes épouvantables comme ceux décrits d'entrée de jeu et dont je vous épargne la description. C'est à la suite d'un tel acte qu'un personnage prendra la rue et se mettra à danser comme une folle, comme ça, sans raison. À sa vue, plusieurs la suivent et font pareil. Et voilà que le mouvement grossit et que ça ne s'arrête plus. Bientôt, une majeure partie de la ville passe son temps à danser sans arrêt dans les rues, et bien souvent jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais qu'est-ce qui explique ça?
Teulé fait sa propre interprétation de ce fait tiré de l'histoire réelle de la ville de Strasbourg en mettant en scène des personnages existants et sans doute inventés. Parmi les existants, on remarque le maire, bien embêté, et l'évêque, scandalisé. Or, les greniers de ce dernier débordent et le maire le sait. S'ensuivent les affrontements que l'on devine entre le civil et le religieux. Avec les mots de Jean Teulé, ceci constitue les moments les plus truculents du livre. Cet auteur a des dialogues bédéesques où les expressions empruntées frôlent l'anachronisme, et c'est là, avec la recherche historique, ce que je préfère de Jean Teulé. Par contre, là où ça passe plus bizarrement, c'est dans l'histoire des pauvres victimes. Les situations décrites sont tragiques. On imagine que la situation l'était, oui, mais il y a quelque chose qui m'a fait souvent penser qu'on était dans le "trop". Oui, on en apprend un peu des métiers exercés, des conditions sociales de chacun, mais j'aurais aimé que Teulé développe davantage la psychologie de ces personnages sans doute inventés, mais pourtant au coeur de cet événement. On devrait ressentir une tristesse, de l'empathie, mais non...
Bref, pour l'ambiance historique, l'anecdote historique et la forme écrite: oui, mais pour le scénario, je reste un peu sur ma faim. Si vous ne connaissez pas Jean Teulé, je vous suggère fortement Charly 9. Un personnage historique réel (le roi français Charles IX) qui ne l'a pas eu facile. Raconté par Teulé, c'est jouissif.
lundi 14 mai 2018
Dérives, par Biz, éditions Leméac (collection Nomade)
C'est loin d'être le premier livre de ce personnage bien connu dans le domaine public québécois. C'est pourtant la première fois que je le lis. C'est rare que je lis un auteur pour la première fois pour la seule raison que je le "connaisse", que cet auteur soit de notoriété publique. Le résultat est satisfaisant.
Dérives est court, à peine 94 pages, et je suis heureux de faire la découverte du monde littéraire de Biz par son dernier ouvrage. L'auteur y donne la parole à un homme qui s'enfonce dans la dépression. Raconté au "je", le livre tient, pour la moitié, d'un témoignage descriptif, et pour l'autre moitié, d'un genre de rêve éveillé où le narrateur se voit dériver dans un marais, belle métaphore de sa vie réelle. Les deux récits alternent sans nous perdre alors que c'est justement ce qu'on regarde: un homme se perdre.
Le ton est très intimiste, de celui de l'ami qui s'assoit devant soi pour nous raconter ce qu'il vient de vivre. Rien, hormis le rêve, n'est invraisemblable et même si on n'a jamais vécu une telle épisode, on ressent très fortement la détresse du narrateur. Les mots de Biz rendent les images claires, tirées du quotidien d'un Montréalais. Ce dernier trait est à préciser parce que quiconque connaît l'auteur dans ses interventions publiques connait son fort penchant politique. Biz nous balancera ses opinions en la matière en deux ou trois pages dans un des rares moments un peu incongrus du livre. Pas surprenant de Biz, mais un peu hors contexte.
POur le reste, ce livre décrit fort bien cet événement sans artifices d'un homme qui sombre. J'ai beaucoup pensé au Contre dieu, de Patrick Sénécal, pour la perte de repères vécue par le narrateur. Mais non, l'issue est toute autre. Si on l'a vécu avec tristesse et appréhension, on ressort de Dérives avec quelque chose comme de l'espoir ou du soulagement.
Excellent narrateur, un brin sarcastique mais très fin et sensible, Biz donne le goût de le découvrir par les mots qu'il écrits au-delà de ceux qu'il dit ou qu'il interprète.
Dérives est court, à peine 94 pages, et je suis heureux de faire la découverte du monde littéraire de Biz par son dernier ouvrage. L'auteur y donne la parole à un homme qui s'enfonce dans la dépression. Raconté au "je", le livre tient, pour la moitié, d'un témoignage descriptif, et pour l'autre moitié, d'un genre de rêve éveillé où le narrateur se voit dériver dans un marais, belle métaphore de sa vie réelle. Les deux récits alternent sans nous perdre alors que c'est justement ce qu'on regarde: un homme se perdre.
Le ton est très intimiste, de celui de l'ami qui s'assoit devant soi pour nous raconter ce qu'il vient de vivre. Rien, hormis le rêve, n'est invraisemblable et même si on n'a jamais vécu une telle épisode, on ressent très fortement la détresse du narrateur. Les mots de Biz rendent les images claires, tirées du quotidien d'un Montréalais. Ce dernier trait est à préciser parce que quiconque connaît l'auteur dans ses interventions publiques connait son fort penchant politique. Biz nous balancera ses opinions en la matière en deux ou trois pages dans un des rares moments un peu incongrus du livre. Pas surprenant de Biz, mais un peu hors contexte.
POur le reste, ce livre décrit fort bien cet événement sans artifices d'un homme qui sombre. J'ai beaucoup pensé au Contre dieu, de Patrick Sénécal, pour la perte de repères vécue par le narrateur. Mais non, l'issue est toute autre. Si on l'a vécu avec tristesse et appréhension, on ressort de Dérives avec quelque chose comme de l'espoir ou du soulagement.
Excellent narrateur, un brin sarcastique mais très fin et sensible, Biz donne le goût de le découvrir par les mots qu'il écrits au-delà de ceux qu'il dit ou qu'il interprète.
mardi 8 mai 2018
L'art d'être fragile, par Alessandro D'Avenia, éditions des Presses universitaires françaises
Voici un essai dont le sous titre est: Comment un poète peut sauver ta vie.
Écrit par un prof de niveau secondaire (lycée), cet est un réquisitoire sur l'importance d'être soi. Bien qu'il s'adresse à un public de l'âge de ses élèves, l'auteur rejoint tous les âges par la justesse et la passion de ses propos.
D'Avenia est d'abord un gars qui aime son travail et qui est conscient de son importance. Dans sa démonstration, il cite souvent des propos de jeunes lecteurs ou étudiants (il a publié d'autres livres avant celui-là). ON sent combien il les respecte et les connait. Pour lui, le début de l'âge adulte est une époque charnière où le désenchantement risque de prendre une place disproportionnée. Son message est le suivant: ne vous laissez pas avoir. Attachez-vous à ce que vous aimez et surtout, regardez autour de vous, il y a du beau. N'ayez ni peur ni honte de porter votre attention là-dessus.
À mille lieues de la psycho-pop, D'Avenia parle de tout ça à travers des lettres qu'il adresse à celui qui est, manifestement, son auteur préféré: le poète italien Giacomo Leopardi. Je m'y connais peu en poésie, voir à peu près pas, sauf pour quelques grands textes des auteurs français et québécois les plus connus. J'avoue ne m'être jamais procuré un livre de poésie, et je ne connaissais pas Leopardi, que ce livre m'a permis de découvrir comme étant le plus grand poète italien. Malgré toute mon incompétence en la matière, les mots d'Alessandro D'Avenia m'ont rejoint.
La vie de Leopardi fut difficile. Malade et sans le sou, il a toutefois bénéficié d'une éducation développée qui lui a donné non seulement le goût des mots, mais aussi la possibilité de découvrir d'autres mondes et de s'ouvrir l'esprit sur les autres, sur ce qui l'entoure. La fameux cliché du poète devant les étoiles, c'est lui. S'ouvrir l'esprit, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure et de ne pas se replier sur soi-même. C'est là toute la philosophie de D'Avenia, et dire franchement, c'est bon à lire.
D'Avenia est contre le pragmatisme étroit. Pour lui, l'imagination est un refuge comme nul autre. Il nous permet de nous renouveler. Pour stimuler les idées, il faut d'abord rêver.
Que le livre ait été écrit pour un public jeune n'enlève rien à sa qualité d'écriture. Bien au contraire, on est loin du ton infantilisant. C'est même assez érudit, du genre à relire parfois certains passages. Il faut dire que je lis peu d'essais. Aussi je constate que je décroche plus facilement à la lecture d'un tel livre. Reste que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Je le recommanderais à tout parent d'adolescent, à tout rêveur qui se trouve étouffé dans un monde trop formaté, à tout amoureux de la profession d'enseignant et à qui, comme moi, en sait peu sur la poésie, mais ne demande pas mieux que de la laisser entrer dans sa vie à la première bonne occasion. C'est ce que ce livre pourrait devenir.
Écrit par un prof de niveau secondaire (lycée), cet est un réquisitoire sur l'importance d'être soi. Bien qu'il s'adresse à un public de l'âge de ses élèves, l'auteur rejoint tous les âges par la justesse et la passion de ses propos.
D'Avenia est d'abord un gars qui aime son travail et qui est conscient de son importance. Dans sa démonstration, il cite souvent des propos de jeunes lecteurs ou étudiants (il a publié d'autres livres avant celui-là). ON sent combien il les respecte et les connait. Pour lui, le début de l'âge adulte est une époque charnière où le désenchantement risque de prendre une place disproportionnée. Son message est le suivant: ne vous laissez pas avoir. Attachez-vous à ce que vous aimez et surtout, regardez autour de vous, il y a du beau. N'ayez ni peur ni honte de porter votre attention là-dessus.
À mille lieues de la psycho-pop, D'Avenia parle de tout ça à travers des lettres qu'il adresse à celui qui est, manifestement, son auteur préféré: le poète italien Giacomo Leopardi. Je m'y connais peu en poésie, voir à peu près pas, sauf pour quelques grands textes des auteurs français et québécois les plus connus. J'avoue ne m'être jamais procuré un livre de poésie, et je ne connaissais pas Leopardi, que ce livre m'a permis de découvrir comme étant le plus grand poète italien. Malgré toute mon incompétence en la matière, les mots d'Alessandro D'Avenia m'ont rejoint.
La vie de Leopardi fut difficile. Malade et sans le sou, il a toutefois bénéficié d'une éducation développée qui lui a donné non seulement le goût des mots, mais aussi la possibilité de découvrir d'autres mondes et de s'ouvrir l'esprit sur les autres, sur ce qui l'entoure. La fameux cliché du poète devant les étoiles, c'est lui. S'ouvrir l'esprit, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure et de ne pas se replier sur soi-même. C'est là toute la philosophie de D'Avenia, et dire franchement, c'est bon à lire.
D'Avenia est contre le pragmatisme étroit. Pour lui, l'imagination est un refuge comme nul autre. Il nous permet de nous renouveler. Pour stimuler les idées, il faut d'abord rêver.
Que le livre ait été écrit pour un public jeune n'enlève rien à sa qualité d'écriture. Bien au contraire, on est loin du ton infantilisant. C'est même assez érudit, du genre à relire parfois certains passages. Il faut dire que je lis peu d'essais. Aussi je constate que je décroche plus facilement à la lecture d'un tel livre. Reste que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Je le recommanderais à tout parent d'adolescent, à tout rêveur qui se trouve étouffé dans un monde trop formaté, à tout amoureux de la profession d'enseignant et à qui, comme moi, en sait peu sur la poésie, mais ne demande pas mieux que de la laisser entrer dans sa vie à la première bonne occasion. C'est ce que ce livre pourrait devenir.
vendredi 13 avril 2018
Les loyautés, par Delphine de Vigan, éditions JC Lattès
Un jeune de 12 ans est repéré par une enseignante. Elle détecte chez-lui quelque chose qui ne va pas. Le radar de cette femme est fin puisqu'elle croit percevoir chez ce jeune les symptômes d'expériences qu'elle a elle-même vécues à son âge. Le jeune en question vit en garde partagée. Peu sociable, il n'a qu'un seul ami du même âge. La mère de ce dernier n'aime pas la fréquentation de son fils. En couple "stable", elle découvrira toutefois que le temps est en train de faire son oeuvre dans sa famille, et pas nécessairement pour le mieux.
Dans ce livre court et très dur au titre très à propos, Delphine de Vigan parle de relations, de celles qu'on s'oblige et de celles qu'on choisit. Elle nous fait nous demander la valeur des loyautés, et donne une vigoureuse claque aux ceux qui pourraient croire qu'être loyal n'entraîne que de bonnes choses. Sous son oeil, les loyautés sont plus souvent des relations dans lesquelles on a choisi de s'investir et sans lesquelles on choisit de demeurer... ou pas. Y rester implique un prix à payer, ce qui n'est pas toujours heureux. Bref, pour être loyal, il faut parfois piler sur ben des principes et renoncer à bien des choses. En voyant le résultat, ne reste que soi-même à féliciter... ou à blâmer.
Dans ce livre, on l'aura deviné, c'est pas jojo. Deux types de relations passent au tordeur: les couples, et la maternité. Les deux impliquent des choix, et qu'arrive-t-il lorsqu'après un certain temps, on se rend compte que ces choix n'étaient pas les bons?
La plume impeccable de l'auteur devient ici un microscope ou une loupe explorant des vies à première vue ordinaires. Avec le garçon déchiré entre les vies de deux parents qui se détestent, on pense inévitablement à David Goudreau et La bête à sa mère, pour ces enfants blessés profondément par les égoïsmes inconscients de parents plus ou moins naïfs. Avec l'enseignante victime de ses démons, on se rend compte de la fragilité de ceux qu'on croit les plus forts, et avec la mère qui découvre le côté insidieux des médias sociaux, on se questionne sur la place qu'on désire occuper dans la vie de ceux qui nous entourent. A-t-on besoin de faire tout ça, et si oui, pourquoi?
Delphine de Vigan est assurément une grande auteure, parce que sans réussir à l'aimer autant que tant d'autres, je ne peux toutefois pas m'empêcher de lire ce qu'elle produit depuis Rien ne s'oppose à la nuit, qui demeure, à mon sens, son grand livre. Observatrice hors pair de la société qui l'entoure, spécialiste des imperfections, elle nous brasse avec finesse, ce qui fait quand même un certain bien.
Les loyautés est un livre qui vous remet inévitablement en question. Faut y être prêt.
Dans ce livre court et très dur au titre très à propos, Delphine de Vigan parle de relations, de celles qu'on s'oblige et de celles qu'on choisit. Elle nous fait nous demander la valeur des loyautés, et donne une vigoureuse claque aux ceux qui pourraient croire qu'être loyal n'entraîne que de bonnes choses. Sous son oeil, les loyautés sont plus souvent des relations dans lesquelles on a choisi de s'investir et sans lesquelles on choisit de demeurer... ou pas. Y rester implique un prix à payer, ce qui n'est pas toujours heureux. Bref, pour être loyal, il faut parfois piler sur ben des principes et renoncer à bien des choses. En voyant le résultat, ne reste que soi-même à féliciter... ou à blâmer.
Dans ce livre, on l'aura deviné, c'est pas jojo. Deux types de relations passent au tordeur: les couples, et la maternité. Les deux impliquent des choix, et qu'arrive-t-il lorsqu'après un certain temps, on se rend compte que ces choix n'étaient pas les bons?
La plume impeccable de l'auteur devient ici un microscope ou une loupe explorant des vies à première vue ordinaires. Avec le garçon déchiré entre les vies de deux parents qui se détestent, on pense inévitablement à David Goudreau et La bête à sa mère, pour ces enfants blessés profondément par les égoïsmes inconscients de parents plus ou moins naïfs. Avec l'enseignante victime de ses démons, on se rend compte de la fragilité de ceux qu'on croit les plus forts, et avec la mère qui découvre le côté insidieux des médias sociaux, on se questionne sur la place qu'on désire occuper dans la vie de ceux qui nous entourent. A-t-on besoin de faire tout ça, et si oui, pourquoi?
Delphine de Vigan est assurément une grande auteure, parce que sans réussir à l'aimer autant que tant d'autres, je ne peux toutefois pas m'empêcher de lire ce qu'elle produit depuis Rien ne s'oppose à la nuit, qui demeure, à mon sens, son grand livre. Observatrice hors pair de la société qui l'entoure, spécialiste des imperfections, elle nous brasse avec finesse, ce qui fait quand même un certain bien.
Les loyautés est un livre qui vous remet inévitablement en question. Faut y être prêt.
jeudi 5 avril 2018
Couleurs de l'incendie, par Pierre Lemaitre, éditions Albin Michel
J'ai appris que Au revoir là-haut était le premier livre d'une trilogie en lisant le quatrième de couverture de Couleurs de l'incendie. J'ai dû provoquer un son dans la librairie en l'apprenant. Quel, plaisir, il y en aura un troisième!
Le livre s'ouvre en 1927. On est aux funérailles de Marcel Péricourt, le père banquier du cher Édouard d'Au revoir là-haut, décédé sept ans plus tôt dans les circonstances que les lecteurs de ce premier tome extraordinaire connaissent. Le seul héritier de la colossale fortune du banquier est sa fille Madeleine, qui sera le personnage centrale de Couleurs de l'incendie. Héritière peu intéressée par les affaires, Madeleine vivra les affres du temps: on est à l'aube de 1929. Sa fortune sera fortement touchée, et les circonstances qui l'y conduiront seront provoquées pas tant par l'époque elle-même que par les actions torves d'autres beaucoup plus avides de richesse qu'elle.
Madeleine sera donc victime, mais de plus encore que de l'économie chancelante. Comme dans Au revoir là-haut, Couleurs de l'incendie commencera avec un incident épouvantablement tragique qui surviendra pendant les funérailles du patriarche. Vous vous souvenez du début sur les chapeaux de roue du livre précédent? Ça commence pareil avec le deuxième, mais dans un tout autre contexte. Puis, ça se bouscule jusqu'à la fin.
Couleurs de l'incendie est le récit d'une effroyable vengeance. À un moment, Madeleine se dit que l'époque dans la quelle elle vit est cruelle: l'économie de marché prends le dessus, tout est à l'argent, les plus forts sont les plus riches. Aussi, se dit-elle que pour s'en sortir, il lui faudra être cruelle elle aussi. Mais c'est du Pierre Lemaître. Rien n'est sordide, ou à peine, mais tout est spectaculaire.
Car l'écriture de Pierre Lemaitre est spectaculaire. Efficaces, drôles, percutants: les mots choisis par cet auteur hors-pair nous tiennent en haleine. Excellent conteur, c'est aussi un auteur soucieux du contexte historique et des lieux. Et par-dessus tout ça, ajouter des personnages irrésistibles: une infirmière polonaise qui ne parle que polonais, une cantatrice pseudo-italienne, une dame de compagnie parvenue, un adolescent passionné de publicité, et plusieurs autres visages qu'on n'est pas prêts d'oublier en tant que lecteur. Et comme décor: le Paris des années 20 et 30. C'est classique, me direz-vous. Oui, mais c'est absolument efficace, je reviens sur le mot, d'autant plus que Lemaitre réussi aussi à nous montrer cette époque que un calque de la nôtre. À moins que ce soit le contraire? Pensez-y: capitalisme tout-puissant, gouvernements faibles, montée de la droite dure et du fascisme...
Une autre chose rend l'écriture de Pierre Lemaitre remarquable: la constance du combat entre le bien et le mal. C'est partout, tant dans l'époque, l'histoire, que chacun des personnages. Tous, autant qu'ils sont, sont victimes et bourreaux, anges et démons. Quant au fil des événements, il faut avouer que c'est très cinématographique. On ne se surpendra pas qu'Au revoir là-haut ait été adapté au grand écran. Parions que celui-là suivra.
Action sans temps mort, rigueur historique, revirements spectaculaires, on n'est pas là dans l'introspection. Certaines scènes vous tordront pourtant le coeur, donc une, en particulier, dans un train, et d'autres vous feront éclater de rire malgré le tragique des situations rencontrées. C'est ça, Pierre Lemaitre: du tragique, voir même du cruel, mais avec des fleurs autour. Si vous avez aimé Au revoir là-haut, c'est une obligation de se procurer Couleurs de l'incendie. Et si vous ne connaissez encore ni l'un ni l'autre, ne vous demandez même pas si je vous les recommande. ÇA, c'est de la littérature!
Le livre s'ouvre en 1927. On est aux funérailles de Marcel Péricourt, le père banquier du cher Édouard d'Au revoir là-haut, décédé sept ans plus tôt dans les circonstances que les lecteurs de ce premier tome extraordinaire connaissent. Le seul héritier de la colossale fortune du banquier est sa fille Madeleine, qui sera le personnage centrale de Couleurs de l'incendie. Héritière peu intéressée par les affaires, Madeleine vivra les affres du temps: on est à l'aube de 1929. Sa fortune sera fortement touchée, et les circonstances qui l'y conduiront seront provoquées pas tant par l'époque elle-même que par les actions torves d'autres beaucoup plus avides de richesse qu'elle.
Madeleine sera donc victime, mais de plus encore que de l'économie chancelante. Comme dans Au revoir là-haut, Couleurs de l'incendie commencera avec un incident épouvantablement tragique qui surviendra pendant les funérailles du patriarche. Vous vous souvenez du début sur les chapeaux de roue du livre précédent? Ça commence pareil avec le deuxième, mais dans un tout autre contexte. Puis, ça se bouscule jusqu'à la fin.
Couleurs de l'incendie est le récit d'une effroyable vengeance. À un moment, Madeleine se dit que l'époque dans la quelle elle vit est cruelle: l'économie de marché prends le dessus, tout est à l'argent, les plus forts sont les plus riches. Aussi, se dit-elle que pour s'en sortir, il lui faudra être cruelle elle aussi. Mais c'est du Pierre Lemaître. Rien n'est sordide, ou à peine, mais tout est spectaculaire.
Car l'écriture de Pierre Lemaitre est spectaculaire. Efficaces, drôles, percutants: les mots choisis par cet auteur hors-pair nous tiennent en haleine. Excellent conteur, c'est aussi un auteur soucieux du contexte historique et des lieux. Et par-dessus tout ça, ajouter des personnages irrésistibles: une infirmière polonaise qui ne parle que polonais, une cantatrice pseudo-italienne, une dame de compagnie parvenue, un adolescent passionné de publicité, et plusieurs autres visages qu'on n'est pas prêts d'oublier en tant que lecteur. Et comme décor: le Paris des années 20 et 30. C'est classique, me direz-vous. Oui, mais c'est absolument efficace, je reviens sur le mot, d'autant plus que Lemaitre réussi aussi à nous montrer cette époque que un calque de la nôtre. À moins que ce soit le contraire? Pensez-y: capitalisme tout-puissant, gouvernements faibles, montée de la droite dure et du fascisme...
Une autre chose rend l'écriture de Pierre Lemaitre remarquable: la constance du combat entre le bien et le mal. C'est partout, tant dans l'époque, l'histoire, que chacun des personnages. Tous, autant qu'ils sont, sont victimes et bourreaux, anges et démons. Quant au fil des événements, il faut avouer que c'est très cinématographique. On ne se surpendra pas qu'Au revoir là-haut ait été adapté au grand écran. Parions que celui-là suivra.
Action sans temps mort, rigueur historique, revirements spectaculaires, on n'est pas là dans l'introspection. Certaines scènes vous tordront pourtant le coeur, donc une, en particulier, dans un train, et d'autres vous feront éclater de rire malgré le tragique des situations rencontrées. C'est ça, Pierre Lemaitre: du tragique, voir même du cruel, mais avec des fleurs autour. Si vous avez aimé Au revoir là-haut, c'est une obligation de se procurer Couleurs de l'incendie. Et si vous ne connaissez encore ni l'un ni l'autre, ne vous demandez même pas si je vous les recommande. ÇA, c'est de la littérature!
mardi 13 mars 2018
Le séducteur, par Jan Kjaerstad, éditions Monsieur Toussaint Louverture
Le titre vous fait peut-être penser à quelque chose de vaguement sentimental ou de macho, alors que la page couverture pourrait vous faire vous imaginer un ouvrage léger ou gentil. Ce sont des leurres. Le séducteur de Jan Kjaerstad est un roman geek, extraverti et ambitieux.
Geek
Dans cette véritable histoire le la Norvège moderne, l'auteur raconte l'histoire d'un personnage né dans les années 50, jusqu'aux années 90. Réalisateur de documentaires sur de grands personnages norvégiens, ce personnage et ses sujets deviennent prétexte à une grande rétrospective de l'histoire de ce pays modeste, mais ô combien singulier. Tout amateur du genre ne pourra qu'être complètement happé. C'est complet, documenté et fort bien raconté. J'avais parfois l'impression de lire Mathieu Enard avec ses mille et une références historiques et musicales. J'ai souvent googlé en lisant le Séducteur, et j'y ai fait de belles découvertes.
Extraverti
À travers son personnage, Kjaerstad raconte donc son pays. Avec l'un, il dépeint l'autre, et par de savants tableaux, l'un devient victime et tributaire de l'autre. Cette façon de raconter un peuple est extrêmement originale, et on imagine facilement qu'elle aura su déranger un public cible, qu'on imagine norvégien, qu'on perçoit comme originellement modeste, réservé et peu enclin à l'auto-congratulation. (Tiens, ça me rappelle un autre petit peuple du même genre mais sur un autre continent, ça.). Parce que ce personnage de réalisateur décide de montrer des visages de l'histoire de son peuple à travers des documentaires grandioses qui brassent la cage et suscitent un immense intérêt. Or, tel n'était pas le cas jusque là, en Norvège, pays du grand fleuve tranquille, qui commençait tout juste à s'éveiller, depuis quelques décennies. Le peuple, comme l'homme, réalise que toute une planète grouille autour de lui, et c'est la grande ouverture. La Norvège s'ouvre sur le monde, notre bonhomme découvre le sien, fait des liens, constate et comprend ce qui l'entoure. Il sort, va à la rencontre des autres, bref, il dérange un peu. Le peuple, comme l'homme, brasse, bouge, et tous n'avancent pas à la même vitesse. Bref, cette histoire est fortement extravertie par rapport à son contexte, et pour cette seule constatation, ça en fait, là encore, un objet très original.
Ambitieux
L'histoire du personnage au coeur de ce roman est vaste. Il ne s'agit pas d'un roman d'action, plein de poursuites et de rebondissements, mais d'un portrait en milliers de détails, avec toutes les palettes de couleur qu'on puisse imaginer. Le narrateur du livre est un personnage inconnu, un espèce d'observateur neutre qui dit vouloir raconter l'homme en question pour qu'on le réhabilite, parce que, il faut le dire, le livre commence par la découverte du corps inanimé de sa femme dans sa maison au retour d'un voyage d'affaires. Ce qui ressemble donc à une intrigue au le départ se transforme plutôt en un genre d'encyclopédie où l'on va d'une époque à l'autre, d'un personnage à un autre, d'incise en incise, pour revenir à ce qu'on racontait 30 pages plus loin, et ainsi de suite.
Disons-le, c'est parfois difficile à suivre. Cet hommage à l'imagination stimule énormément la nôtre avec des personnages tantôt hyper forts et colorés, ou tantôt beiges et un peu inutiles. N'en demeure pas moins que l'exigence de certains passages vaut le coup. On fait, quelques pages plus loin, des trouvailles où art, sexualité et tolérance prennent une grande place, et c'est fort bien raconté.
Un livre actuel et vintage en même temps, qui vante le plaisir de découvrir, d'être curieux et d'éviter le repli sur soi, avec beaucoup de mots, mais une ambition noble. Plusieurs adoreront le Séducteur.
Geek
Dans cette véritable histoire le la Norvège moderne, l'auteur raconte l'histoire d'un personnage né dans les années 50, jusqu'aux années 90. Réalisateur de documentaires sur de grands personnages norvégiens, ce personnage et ses sujets deviennent prétexte à une grande rétrospective de l'histoire de ce pays modeste, mais ô combien singulier. Tout amateur du genre ne pourra qu'être complètement happé. C'est complet, documenté et fort bien raconté. J'avais parfois l'impression de lire Mathieu Enard avec ses mille et une références historiques et musicales. J'ai souvent googlé en lisant le Séducteur, et j'y ai fait de belles découvertes.
Extraverti
À travers son personnage, Kjaerstad raconte donc son pays. Avec l'un, il dépeint l'autre, et par de savants tableaux, l'un devient victime et tributaire de l'autre. Cette façon de raconter un peuple est extrêmement originale, et on imagine facilement qu'elle aura su déranger un public cible, qu'on imagine norvégien, qu'on perçoit comme originellement modeste, réservé et peu enclin à l'auto-congratulation. (Tiens, ça me rappelle un autre petit peuple du même genre mais sur un autre continent, ça.). Parce que ce personnage de réalisateur décide de montrer des visages de l'histoire de son peuple à travers des documentaires grandioses qui brassent la cage et suscitent un immense intérêt. Or, tel n'était pas le cas jusque là, en Norvège, pays du grand fleuve tranquille, qui commençait tout juste à s'éveiller, depuis quelques décennies. Le peuple, comme l'homme, réalise que toute une planète grouille autour de lui, et c'est la grande ouverture. La Norvège s'ouvre sur le monde, notre bonhomme découvre le sien, fait des liens, constate et comprend ce qui l'entoure. Il sort, va à la rencontre des autres, bref, il dérange un peu. Le peuple, comme l'homme, brasse, bouge, et tous n'avancent pas à la même vitesse. Bref, cette histoire est fortement extravertie par rapport à son contexte, et pour cette seule constatation, ça en fait, là encore, un objet très original.
Ambitieux
L'histoire du personnage au coeur de ce roman est vaste. Il ne s'agit pas d'un roman d'action, plein de poursuites et de rebondissements, mais d'un portrait en milliers de détails, avec toutes les palettes de couleur qu'on puisse imaginer. Le narrateur du livre est un personnage inconnu, un espèce d'observateur neutre qui dit vouloir raconter l'homme en question pour qu'on le réhabilite, parce que, il faut le dire, le livre commence par la découverte du corps inanimé de sa femme dans sa maison au retour d'un voyage d'affaires. Ce qui ressemble donc à une intrigue au le départ se transforme plutôt en un genre d'encyclopédie où l'on va d'une époque à l'autre, d'un personnage à un autre, d'incise en incise, pour revenir à ce qu'on racontait 30 pages plus loin, et ainsi de suite.
Disons-le, c'est parfois difficile à suivre. Cet hommage à l'imagination stimule énormément la nôtre avec des personnages tantôt hyper forts et colorés, ou tantôt beiges et un peu inutiles. N'en demeure pas moins que l'exigence de certains passages vaut le coup. On fait, quelques pages plus loin, des trouvailles où art, sexualité et tolérance prennent une grande place, et c'est fort bien raconté.
Un livre actuel et vintage en même temps, qui vante le plaisir de découvrir, d'être curieux et d'éviter le repli sur soi, avec beaucoup de mots, mais une ambition noble. Plusieurs adoreront le Séducteur.
jeudi 8 février 2018
La bête et sa cage, par David Goudreault, éditions Stanké
Après ce qui lui est arrivé à la fin de La bête à sa mère, le personnage de David Goudreault se retrouve en prison. Et c'est lui, tel qu'il est, qui nous décrit le monde dans lequel il vit.
Ce personnage est fort, immensément fort. La seule création de ce personnage me fait porter un immense respect à son auteur. C'est un humain à l'état brut, qui s'est fait tout seul, sans aucune référence sociale, familiale ou affective. S'il existe de tels personnages "dans la vraie vie" on les connait peu, et avoir accès à leur vision du monde par une oeuvre de fiction est un privilège.
Bref, on explore le monde carcéral à travers le regard de ce petit délinquant qui s'avère un vrai danger public, dans le sens où le public est, pour lui, un monde inconnu, qu'il ne comprend pas. Mais voilà, ça se confirme dans ce deuxième livre, le mec n'est pas complètement con pour autant. Ce qui nous pousse à cette conclusion, c'est son désir de lire des livres. Ah, voilà, j'en vois qui décrochent, voyant là la rédemption d'un pauvre délinquant naïf et sans éducation. Mais non. Le gars ne trouvera pas son salut par les livres. Pas du tout. En fait, il lancera ainsi à certaines composantes un peu plus éveillées de son entourage le message qu'il possède un potentiel, et que si la vie n'avait pas fait de lui ce qu'il était devenu, il aurait pu devenir "quelqu'un". C'est sans doute le cas de bien d'autres gens en prison.
Reste que bien au-delà des livres, on vit la proximité d'un groupe de détenus d'une prison à sécurité maximum. De la sexualité aux relations de pouvoir, en passant par les désirs et les lubies, on voit à quel point il s'agit d'un monde parallèle. Et cette découverte d'un monde inconnu, on la fait à travers un personnage de plus en plus assumé par son auteur.
Dans son premier livre, on sentait de l'empathie pour ce personnage fini, complètement détruit, en mode survie. On souriait de ses naïvetés et on avait mal pour ses incompréhensions, ses mauvaises interprétations. Dans ce deuxième livre, on se permet à rire vraiment plus souvent avec et... de lui. L'écriture de David Goudreault est juste, fairplay. Comme pour une relation, avec un ami qu'on connait petit à petit, on développe des familiarités avec le personnage et on se permet de le trouver parfois un peu épais, naïf à outrance. Certaines de ses réparties son si savoureuses qu'on ne peut se retenir de rire. C'est inévitablement drôle. Et la force, c'est que c'est tragique en même temps. La fin de La bête dans sa cage nous le rappelle avec un grand coup de poing. La violence existe, on voit d'où elle vient et on se demande comment on pourrait maintenant la guérir alors qu'on ne l'a pas empêché de se développer.
Meilleur ou pas que La bête à sa mère? Je ne saurais dire, mais ce deuxième livre est certainement au moins aussi bon que celui qui l'a précédé. Hors de toute forme de rectitude politique mais écrit avec limpidité, sans aucune formule facile, c'est la consécration d'un auteur vraiment très fort. Lisez La bête à sa mère et si vous aimez, ne manquez surtout pas La bête dans sa cage.
Maintenant, il me reste un troisième livre pour clore cette série de David Goudreault. Je me donne un peu de temps mais je sais déjà que j'ai très hâte de plonger dedans.
Ce personnage est fort, immensément fort. La seule création de ce personnage me fait porter un immense respect à son auteur. C'est un humain à l'état brut, qui s'est fait tout seul, sans aucune référence sociale, familiale ou affective. S'il existe de tels personnages "dans la vraie vie" on les connait peu, et avoir accès à leur vision du monde par une oeuvre de fiction est un privilège.
Bref, on explore le monde carcéral à travers le regard de ce petit délinquant qui s'avère un vrai danger public, dans le sens où le public est, pour lui, un monde inconnu, qu'il ne comprend pas. Mais voilà, ça se confirme dans ce deuxième livre, le mec n'est pas complètement con pour autant. Ce qui nous pousse à cette conclusion, c'est son désir de lire des livres. Ah, voilà, j'en vois qui décrochent, voyant là la rédemption d'un pauvre délinquant naïf et sans éducation. Mais non. Le gars ne trouvera pas son salut par les livres. Pas du tout. En fait, il lancera ainsi à certaines composantes un peu plus éveillées de son entourage le message qu'il possède un potentiel, et que si la vie n'avait pas fait de lui ce qu'il était devenu, il aurait pu devenir "quelqu'un". C'est sans doute le cas de bien d'autres gens en prison.
Reste que bien au-delà des livres, on vit la proximité d'un groupe de détenus d'une prison à sécurité maximum. De la sexualité aux relations de pouvoir, en passant par les désirs et les lubies, on voit à quel point il s'agit d'un monde parallèle. Et cette découverte d'un monde inconnu, on la fait à travers un personnage de plus en plus assumé par son auteur.
Dans son premier livre, on sentait de l'empathie pour ce personnage fini, complètement détruit, en mode survie. On souriait de ses naïvetés et on avait mal pour ses incompréhensions, ses mauvaises interprétations. Dans ce deuxième livre, on se permet à rire vraiment plus souvent avec et... de lui. L'écriture de David Goudreault est juste, fairplay. Comme pour une relation, avec un ami qu'on connait petit à petit, on développe des familiarités avec le personnage et on se permet de le trouver parfois un peu épais, naïf à outrance. Certaines de ses réparties son si savoureuses qu'on ne peut se retenir de rire. C'est inévitablement drôle. Et la force, c'est que c'est tragique en même temps. La fin de La bête dans sa cage nous le rappelle avec un grand coup de poing. La violence existe, on voit d'où elle vient et on se demande comment on pourrait maintenant la guérir alors qu'on ne l'a pas empêché de se développer.
Meilleur ou pas que La bête à sa mère? Je ne saurais dire, mais ce deuxième livre est certainement au moins aussi bon que celui qui l'a précédé. Hors de toute forme de rectitude politique mais écrit avec limpidité, sans aucune formule facile, c'est la consécration d'un auteur vraiment très fort. Lisez La bête à sa mère et si vous aimez, ne manquez surtout pas La bête dans sa cage.
Maintenant, il me reste un troisième livre pour clore cette série de David Goudreault. Je me donne un peu de temps mais je sais déjà que j'ai très hâte de plonger dedans.
lundi 29 janvier 2018
Borealium Tremens, par Mathieu Villeneuve, éditions La Peuplade
Un homme revient dans son Saguenay-Lac-St-Jean natal pour prendre possession d'un legs: une terre au nord du Lac St-Jean, dans le secteur de la rivière Péribonka. Du Saguenay où ils vivent, il emmène avec lui son frère et sa blonde pour prendre possession de la maison abandonnée des ancêtres et de la terre en friche, voisine d'une tourbière inhospitalière.
Le projet semble ne semble réaliste que pour le principal protagoniste. Tous tentent de le décourager, et les raisons de manquent pas pour le dissuader de réaliser son désir de retour à a terre mais aussi, de l'écriture d'un roman qui raconte... l'aventure d'un mec qui repend la maison et la terre de ses ancêtres malgré les reproches de son entourage. Bon. Vous voyez un roman dans le roman? Pas exactement. Quoi que...
Le nouveau propriétaire va donc contre vents et marées, un passé de désordres psychologiques, des rumeurs de malédiction familiale et l'opprobre du voisinage ayant des vues sur la propriété des lieux. Il se bât contre tous, et c'est dur. Malgré leur désapprobation, son frère et sa blonde, une amie d'enfance, se mettent à l'ouvrage avec lui. Mais voilà qu'au fil du temps, l'initiateur du projet ne fait rien pour s'aider en buvant immodérément. Mais il s'obstine, malgré les messages peu encourageants de témoins du passé des lieux qu'il tente de reconquérir. Puis d'autres personnages s'ajoutent, issus du passé.
Passé et présent font bon ménage dans la langue de Mathieu Villeneuve. Excellent conteur, fin observateur, sa description des lieux et de toute la région vaut n'importe quelle brochure socio-touristique du coin. On ressent facilement les vents de canicule et ceux d'hiver, les odeurs de terre et d'humidité, la poussière, les sons des oiseaux et de la scierie voisine, tellement qu'on en redemande. Certains auteurs sont parfois si forts dans la mise en scène qu'il ne leur suffit que d'une histoire simple à travers ça pour réussir un grand livre. Dans Borealium Tremens, à travers ces superbes descriptions, se déploie une histoire qui, elle, laisse un peu perplexe. Comme leur environnement, les personnages sont durs et intenses. Très intenses, S'il s'agissait d'un film, on croirait que les acteurs sur-jouent. Plus l'histoire avance, plus l'intrigue s'enfonce, comme les personnages, dans une atmosphère de fin du monde, ou de fin d'un monde, jusqu'à ce que commence la fin, qui durera tout le dernier tiers du livre. On se retrouve vite dans un genre proche de la symphonie heavy metal, videoclip à l'appui, où canicules, feux et inondations se succèdent.
Magnifiquement écrit, ce livre contient plusieurs belles idées qui donnent ses lettres de noblesse au Nord inhospitalier où il se déroule. Côté scénario toutefois, on assiste à un difficile mélange de genres, surtout vers la fin du livre. Pas inintéressante, la jonction de la réalité du personnage avec ses rêves avait effectivement un potentiel. On a déjà vu ça, un roman dans un roman, et c'est toujours périlleux. On dirait que l'auteur l'a compris, et c'est pourquoi il s'y adonne seulement en fin de livre. Le résultat m'a laissé dubitatif, mais je suis convaincu qu'il plaira à plusieurs. Intense, mais pas saugrenu, ce Borealium Tremens est ce que d'aucuns appelleront un "ovni littéraire" qui, même s'il ne semble pas tout à fait au point, nous fait nous demander avec envie ce que Mathieu Villeneuve écrira encore.
Vivement une autre histoire dans un lieu hors du commun, mais avec un dénouement un peu moins... un peu plus... enfin, vous voyez?
Le projet semble ne semble réaliste que pour le principal protagoniste. Tous tentent de le décourager, et les raisons de manquent pas pour le dissuader de réaliser son désir de retour à a terre mais aussi, de l'écriture d'un roman qui raconte... l'aventure d'un mec qui repend la maison et la terre de ses ancêtres malgré les reproches de son entourage. Bon. Vous voyez un roman dans le roman? Pas exactement. Quoi que...
Le nouveau propriétaire va donc contre vents et marées, un passé de désordres psychologiques, des rumeurs de malédiction familiale et l'opprobre du voisinage ayant des vues sur la propriété des lieux. Il se bât contre tous, et c'est dur. Malgré leur désapprobation, son frère et sa blonde, une amie d'enfance, se mettent à l'ouvrage avec lui. Mais voilà qu'au fil du temps, l'initiateur du projet ne fait rien pour s'aider en buvant immodérément. Mais il s'obstine, malgré les messages peu encourageants de témoins du passé des lieux qu'il tente de reconquérir. Puis d'autres personnages s'ajoutent, issus du passé.
Passé et présent font bon ménage dans la langue de Mathieu Villeneuve. Excellent conteur, fin observateur, sa description des lieux et de toute la région vaut n'importe quelle brochure socio-touristique du coin. On ressent facilement les vents de canicule et ceux d'hiver, les odeurs de terre et d'humidité, la poussière, les sons des oiseaux et de la scierie voisine, tellement qu'on en redemande. Certains auteurs sont parfois si forts dans la mise en scène qu'il ne leur suffit que d'une histoire simple à travers ça pour réussir un grand livre. Dans Borealium Tremens, à travers ces superbes descriptions, se déploie une histoire qui, elle, laisse un peu perplexe. Comme leur environnement, les personnages sont durs et intenses. Très intenses, S'il s'agissait d'un film, on croirait que les acteurs sur-jouent. Plus l'histoire avance, plus l'intrigue s'enfonce, comme les personnages, dans une atmosphère de fin du monde, ou de fin d'un monde, jusqu'à ce que commence la fin, qui durera tout le dernier tiers du livre. On se retrouve vite dans un genre proche de la symphonie heavy metal, videoclip à l'appui, où canicules, feux et inondations se succèdent.
Magnifiquement écrit, ce livre contient plusieurs belles idées qui donnent ses lettres de noblesse au Nord inhospitalier où il se déroule. Côté scénario toutefois, on assiste à un difficile mélange de genres, surtout vers la fin du livre. Pas inintéressante, la jonction de la réalité du personnage avec ses rêves avait effectivement un potentiel. On a déjà vu ça, un roman dans un roman, et c'est toujours périlleux. On dirait que l'auteur l'a compris, et c'est pourquoi il s'y adonne seulement en fin de livre. Le résultat m'a laissé dubitatif, mais je suis convaincu qu'il plaira à plusieurs. Intense, mais pas saugrenu, ce Borealium Tremens est ce que d'aucuns appelleront un "ovni littéraire" qui, même s'il ne semble pas tout à fait au point, nous fait nous demander avec envie ce que Mathieu Villeneuve écrira encore.
Vivement une autre histoire dans un lieu hors du commun, mais avec un dénouement un peu moins... un peu plus... enfin, vous voyez?
lundi 15 janvier 2018
L'habitude des bêtes, par Lise Tremblay, éditions Boréal
C'est mon troisième roman de Lise Tremblay et ce ne sera pas le dernier. La lire, c'est comme de se faire faire dire "Ça va bien aller" par une personne qu'on aime après une crise d'angoisse. C'est ainsi que je me sens depuis que j'ai terminé son livre et j'en voudrais encore.
Saguenéenne, Lise Tremblay est une des plus scandinaves des auteurs québécois. Son écriture est épurée, calme, un peu froide et elle va doit au coeur. Ses personnages ont toutes ces qualités sauf une: ils ne sont pas calmes, enfin pour la plupart. Tous vivent leurs angoisses à l'orée d'un parc, dans une petite communauté aux contreforts d'un village où le rythme suit celui de la forêt qui l'entoure. Gens simples, leurs préoccupations proviennent de leurs interactions avec leurs proches. Qu'est-ce qu'un tel pensera de ça? Que dira un autre si je fais ça?, etc. Or, de telles préoccupations peuvent devenir des obsessions lorsque que rien ni personne n'est là pour pour aider à relativiser ce qui vous semble une montagne. Votre idée fixe, qui parait bien mince pour les autres, surtout ceux qui ne vivent pas les mêmes préoccupations que vous, devient bientôt une mur qui semble infranchissable. C'est ce que vivra un des personnages de ce livre d'une auteure qui connaît bien les gens dont elle parle.
Les bêtes, et donc, la chasse, remuent les habitudes tranquilles des habitants du village, aujourd'hui comme avant. C'est un dentiste à la retraite qui raconte cette histoire. Il est venu de Montréal s'établir au Saguenay justement en raison de son amour de la saison de chasse, qui, avec le temps, s'est muée en un besoin de refuge dans son chalet devenu résidence principale, où il vit avec son chien. Ses voisins deviennent peu à peu ses proches alors que sa famille, son ex-femme et sa fille, eux, s'éloignent.
De ces personnages, deux verront venir la mort, ce qui inclut son chien, et une autre vivra une nouvelle vie. Le narrateur vivra ces débuts et ce recommencement entouré de ces gens simples dont les interactions font penser à celles d'une meute de loups, pas dans le sens du méchant loup, mais dans celui de l'animal sauvage dont le seul but est de vivre, et bien souvent, de survivre.
Lise Tremblay écrit comme certains savent qu'ils attireront l'attention en parlant bas plutôt qu'en élevant la voix. Sage, droit et sensible, son style me saisit à chaque fois. Loin des actions enlevantes, elle sait fait ressortir la splendeur de la lenteur, la profondeur des décors les plus simples, et les plus belles sensibilités des gens les plus renfrognés. Avec le Saguenay comme décor, on se dépayse dans un rythme de vie qu'on craint et qu'on envie en même temps grâce à l'immense talent de cette auteure de plus en plus incontournable.
Saguenéenne, Lise Tremblay est une des plus scandinaves des auteurs québécois. Son écriture est épurée, calme, un peu froide et elle va doit au coeur. Ses personnages ont toutes ces qualités sauf une: ils ne sont pas calmes, enfin pour la plupart. Tous vivent leurs angoisses à l'orée d'un parc, dans une petite communauté aux contreforts d'un village où le rythme suit celui de la forêt qui l'entoure. Gens simples, leurs préoccupations proviennent de leurs interactions avec leurs proches. Qu'est-ce qu'un tel pensera de ça? Que dira un autre si je fais ça?, etc. Or, de telles préoccupations peuvent devenir des obsessions lorsque que rien ni personne n'est là pour pour aider à relativiser ce qui vous semble une montagne. Votre idée fixe, qui parait bien mince pour les autres, surtout ceux qui ne vivent pas les mêmes préoccupations que vous, devient bientôt une mur qui semble infranchissable. C'est ce que vivra un des personnages de ce livre d'une auteure qui connaît bien les gens dont elle parle.
Les bêtes, et donc, la chasse, remuent les habitudes tranquilles des habitants du village, aujourd'hui comme avant. C'est un dentiste à la retraite qui raconte cette histoire. Il est venu de Montréal s'établir au Saguenay justement en raison de son amour de la saison de chasse, qui, avec le temps, s'est muée en un besoin de refuge dans son chalet devenu résidence principale, où il vit avec son chien. Ses voisins deviennent peu à peu ses proches alors que sa famille, son ex-femme et sa fille, eux, s'éloignent.
De ces personnages, deux verront venir la mort, ce qui inclut son chien, et une autre vivra une nouvelle vie. Le narrateur vivra ces débuts et ce recommencement entouré de ces gens simples dont les interactions font penser à celles d'une meute de loups, pas dans le sens du méchant loup, mais dans celui de l'animal sauvage dont le seul but est de vivre, et bien souvent, de survivre.
Lise Tremblay écrit comme certains savent qu'ils attireront l'attention en parlant bas plutôt qu'en élevant la voix. Sage, droit et sensible, son style me saisit à chaque fois. Loin des actions enlevantes, elle sait fait ressortir la splendeur de la lenteur, la profondeur des décors les plus simples, et les plus belles sensibilités des gens les plus renfrognés. Avec le Saguenay comme décor, on se dépayse dans un rythme de vie qu'on craint et qu'on envie en même temps grâce à l'immense talent de cette auteure de plus en plus incontournable.
jeudi 11 janvier 2018
La bête à sa mère, par David Goudreault, éditions Stanké
C'est l'histoire de la personne que vous avez le plus détestée depuis que vous êtes en âge de rencontrer des gens. Vous l'avez peut-être croisé deux minutes, une partie d'une journée, ou dans le contexte du travail, allez savoir. C'est un personnage absolument détestable: pas beau, négligé, arrogant, il vous donnera l'impression de tout savoir. Si vous êtes une femme, il vous draguera assez salement. Nerveux, il vous donnera une impression de "ne pas être très clair". Si on vous en parle, c'est inévitablement en mal. Personne n'en veut.
C'est ce personnage qui se raconte dans la Bête à sa mère. Il se décrit, vous raconte sa vie et vous dit ce qu'il en pense, de sa vie, des gens, de vous, et ce n'est absolument pas banal.
Outre ses frasques de larcins en tous genres, de fuites et de petites violences ordinaires, on découvre, et c'est là où réside le principal tour de force, ce que le bonhomme a en tête. À force de le connaître, on en vient à constater que le garçon, bien qu'il agisse comme tel, n'est pas totalement con. Curieux, il emmagasine l'information comme peut-être un geek aurait pu le faire dans un contexte de développement normal. En fait, on constate que le gars aurait pu avoir du talent, qu'il lit, qu'il sait reconnaître quelqu'un qui ne sait pas écrire et qu'il est, finalement, un talent gaspillé.
En fait, ce livre se joue dans les premières pages, où le personnage raconte son enfance, qu'il a passé de famille d'accueil en famille d'accueil dès l'âge de cinq ans. Le garçon s'est fait tout seul, selon ses principes et ses interprétations à lui, et ça donne ce que ça donne: un être en mode survie qui n'a aucun respect pour rien mais qui sait se débrouiller, et ce, à tout prix.
Goudreault est un travailleur social. Ça se voit. On imagine facilement que son personnage regroupe un peu de plusieurs des gens qu'il a côtoyé. C'est sans doute dans cette expérience de rencontres qu'il a puisé les deux traits particuliers du personnage de son livre qui feront le titre: les bêtes, la mère. Il fait d'abord une habile démonstration qu'il est toujours satisfaisant de s'attaquer à plus petit que soi, d'où la relation singulière de son personnage avec les animaux de compagnie. Tantôt tenté de les dominer, tantôt exaspéré par l'attention qu'ils reçoivent, une attention que lui n'a jamais reçu, il en fera ses boucs émissaires, et ils prendront une certaine place dans sa vie à un moment donné. Par le fait même, l'auteur en fera aussi autant de miroirs dans lesquels on voit son personnage, sauvage, mal élevé mais aussi et surtout, abandonné. Parce que sa grande quête, c'est aussi de retrouver sa mère. Cette obsession le mènera au plus bas et lui donnera aussi une raison de vivre.
La Bête à sa mère, c'est Tarzan réinventé. David Goudreault y fait la magistrale démonstration de ce qu'un humain laissé seul face à lui-même peut devenir dans un monde qui, quel qu'il soit, sera toujours pour lui une véritable jungle, où la seule chose à faire, et ce coûte que coûte, c'est de survivre. Et tout ça, il faut le souligner, n'est pas vulgaire. On pourrait s'y attendre, avec un tel personnage. Mais non. C'est cru comme histoire, oui, mais la narration ne s'embourbe pas dans les sacres et les disgrâces verbales. Pas besoin. Les aventures du pauvre gars parlent par elles mêmes. La forme (l'écriture) n'a rien de spectaculaire mais le fond (l'histoire) est magistrale.
Amoureux d'histoires d'amour, d'amitiés fleuries et de licornes s'abstenir. Amateur de réalité augmentée, vous serez gâtés. On parle ici, d'un nouveau grand auteur.
C'est ce personnage qui se raconte dans la Bête à sa mère. Il se décrit, vous raconte sa vie et vous dit ce qu'il en pense, de sa vie, des gens, de vous, et ce n'est absolument pas banal.
Outre ses frasques de larcins en tous genres, de fuites et de petites violences ordinaires, on découvre, et c'est là où réside le principal tour de force, ce que le bonhomme a en tête. À force de le connaître, on en vient à constater que le garçon, bien qu'il agisse comme tel, n'est pas totalement con. Curieux, il emmagasine l'information comme peut-être un geek aurait pu le faire dans un contexte de développement normal. En fait, on constate que le gars aurait pu avoir du talent, qu'il lit, qu'il sait reconnaître quelqu'un qui ne sait pas écrire et qu'il est, finalement, un talent gaspillé.
En fait, ce livre se joue dans les premières pages, où le personnage raconte son enfance, qu'il a passé de famille d'accueil en famille d'accueil dès l'âge de cinq ans. Le garçon s'est fait tout seul, selon ses principes et ses interprétations à lui, et ça donne ce que ça donne: un être en mode survie qui n'a aucun respect pour rien mais qui sait se débrouiller, et ce, à tout prix.
Goudreault est un travailleur social. Ça se voit. On imagine facilement que son personnage regroupe un peu de plusieurs des gens qu'il a côtoyé. C'est sans doute dans cette expérience de rencontres qu'il a puisé les deux traits particuliers du personnage de son livre qui feront le titre: les bêtes, la mère. Il fait d'abord une habile démonstration qu'il est toujours satisfaisant de s'attaquer à plus petit que soi, d'où la relation singulière de son personnage avec les animaux de compagnie. Tantôt tenté de les dominer, tantôt exaspéré par l'attention qu'ils reçoivent, une attention que lui n'a jamais reçu, il en fera ses boucs émissaires, et ils prendront une certaine place dans sa vie à un moment donné. Par le fait même, l'auteur en fera aussi autant de miroirs dans lesquels on voit son personnage, sauvage, mal élevé mais aussi et surtout, abandonné. Parce que sa grande quête, c'est aussi de retrouver sa mère. Cette obsession le mènera au plus bas et lui donnera aussi une raison de vivre.
La Bête à sa mère, c'est Tarzan réinventé. David Goudreault y fait la magistrale démonstration de ce qu'un humain laissé seul face à lui-même peut devenir dans un monde qui, quel qu'il soit, sera toujours pour lui une véritable jungle, où la seule chose à faire, et ce coûte que coûte, c'est de survivre. Et tout ça, il faut le souligner, n'est pas vulgaire. On pourrait s'y attendre, avec un tel personnage. Mais non. C'est cru comme histoire, oui, mais la narration ne s'embourbe pas dans les sacres et les disgrâces verbales. Pas besoin. Les aventures du pauvre gars parlent par elles mêmes. La forme (l'écriture) n'a rien de spectaculaire mais le fond (l'histoire) est magistrale.
Amoureux d'histoires d'amour, d'amitiés fleuries et de licornes s'abstenir. Amateur de réalité augmentée, vous serez gâtés. On parle ici, d'un nouveau grand auteur.
lundi 8 janvier 2018
Le sous-majordome, par Patrick Dewitt, éditions Alto
L'auteur des Frères Sisters revient nous confirmer que ça spécialité, c'est l'ambiance étrange. Très théâtral, ce Sous-majordome mélange des dialogues à la Beckett dans un décor à la Kafka avec une histoire à la Lewis Caroll.
On parle ici d'une histoire très dense. C'est qu'il s'en passera des choses dans la vie du petit Lucien, parti assez jeune de son village pour aller travailler au château d'un riche baron, dans un autre village assez éloigné pour qu'il lui faille s'y rendre en train. On est fixés dès les premières pages sur le type de personnages qu'on y rencontrera. Comme une Alice dans un pays pas vraiment merveilleux mais vraiment étrange, Lucien nous semblera bien souvent le seul être "normal". Sa mère, même, craint un peu, et contribue à faire débuter le livre sur les chapeaux de roue. Puis, vient le voyage en train, avec d'autres personnages, et suivent les rencontres du majordome, du baron, de villageois et de bien d'autres êtres étranges.
Les descriptions des endroits et des gens m'ont souvent ramené aux ambiances de films aux personnages bédéèsques, comme le Delicatessen de Caro et Jeunet, par exemple. Ces personnages sont forts même dans leur modestie. Tranchants, sans fioritures, chacun a d'abord l'air destiné à ne jouer qu'un seul rôle, le sien, dans sa propre bulle, sans trop d'empathie pour les autres. Pourtant, à force de rencontres, l'empathie et même l'amour feront surface pour Lucien. Le roman en devient alors un d'apprentissage, non seulement des choses de l'amour, mais aussi de la vie, du sens qu'elle peut avoir pour chacun, et dieu sait que le manque de sens est justement ce qui en marque plusieurs...
Le Sous-majordome est truffé de scènes délirantes en des lieux vraiment très singuliers. Le château à lui seul vaut son pesant d'or, mais aussi un autre endroit, situé dans la campagne environnante, où se passeront d'autres scènes autour desquelles tournera tout le livre. Souvent étourdissant parce que bouillonnant de rebondissements, on sort de ce livre en se disant qu'il aurait pu en constituer 2 ou 3 tellement l'histoire ou le caractère de chaque personnage est riche.
Ce livre contient toutefois un important bémol puisque plusieurs de ses pages, particulièrement vers la fin, contiennent de grossières erreurs d'éditions. Mots dédoublés, manquants ou phrases carrément illisibles laissent parfois supposer une révision mal faite ou une date de tombée un peu exigeante pour le traducteur ou le réviseur. Ceci n'empêche pas la lecture du livre, mais l'évidence de ces erreurs laissent un peu perplexe. En espérant que l'éditeur n'ait pas simplement décidé de laisser passer, que ce n'était pas si grave. Oui, ce l'est. Et c'est dommage aussi, car il s'agit ici d'un excellent texte qu'on a un peu barbouillé.
Reste que le Sous-majordome confirme le talent de Patrick Dewitt, qui est en train de faire sa marque avec un style unique. On en veut encore des comme ça... mais bien traduit, et révisé!
On parle ici d'une histoire très dense. C'est qu'il s'en passera des choses dans la vie du petit Lucien, parti assez jeune de son village pour aller travailler au château d'un riche baron, dans un autre village assez éloigné pour qu'il lui faille s'y rendre en train. On est fixés dès les premières pages sur le type de personnages qu'on y rencontrera. Comme une Alice dans un pays pas vraiment merveilleux mais vraiment étrange, Lucien nous semblera bien souvent le seul être "normal". Sa mère, même, craint un peu, et contribue à faire débuter le livre sur les chapeaux de roue. Puis, vient le voyage en train, avec d'autres personnages, et suivent les rencontres du majordome, du baron, de villageois et de bien d'autres êtres étranges.
Les descriptions des endroits et des gens m'ont souvent ramené aux ambiances de films aux personnages bédéèsques, comme le Delicatessen de Caro et Jeunet, par exemple. Ces personnages sont forts même dans leur modestie. Tranchants, sans fioritures, chacun a d'abord l'air destiné à ne jouer qu'un seul rôle, le sien, dans sa propre bulle, sans trop d'empathie pour les autres. Pourtant, à force de rencontres, l'empathie et même l'amour feront surface pour Lucien. Le roman en devient alors un d'apprentissage, non seulement des choses de l'amour, mais aussi de la vie, du sens qu'elle peut avoir pour chacun, et dieu sait que le manque de sens est justement ce qui en marque plusieurs...
Le Sous-majordome est truffé de scènes délirantes en des lieux vraiment très singuliers. Le château à lui seul vaut son pesant d'or, mais aussi un autre endroit, situé dans la campagne environnante, où se passeront d'autres scènes autour desquelles tournera tout le livre. Souvent étourdissant parce que bouillonnant de rebondissements, on sort de ce livre en se disant qu'il aurait pu en constituer 2 ou 3 tellement l'histoire ou le caractère de chaque personnage est riche.
Ce livre contient toutefois un important bémol puisque plusieurs de ses pages, particulièrement vers la fin, contiennent de grossières erreurs d'éditions. Mots dédoublés, manquants ou phrases carrément illisibles laissent parfois supposer une révision mal faite ou une date de tombée un peu exigeante pour le traducteur ou le réviseur. Ceci n'empêche pas la lecture du livre, mais l'évidence de ces erreurs laissent un peu perplexe. En espérant que l'éditeur n'ait pas simplement décidé de laisser passer, que ce n'était pas si grave. Oui, ce l'est. Et c'est dommage aussi, car il s'agit ici d'un excellent texte qu'on a un peu barbouillé.
Reste que le Sous-majordome confirme le talent de Patrick Dewitt, qui est en train de faire sa marque avec un style unique. On en veut encore des comme ça... mais bien traduit, et révisé!
mercredi 3 janvier 2018
Les producteurs, par Antoine Bello, éditions Gallimard
C'est une société dont les membres, disséminés à travers le monde, contribuent à élaborer des fausses nouvelles qui, une fois lancées dans l'actualité, contribueront à rendre le monde meilleur. Troisième d'une série de trois, cet ouvrage a tout un côté visionnaire. Campé dans l'actualité des dernières années (mais attention, pas de la dernière année, les amateurs de Trump seront déçus...), cette histoire intelligente a tout pour faire réfléchir.
On y suit le personnage principal dans l'évolution de certains "dossiers" de l'organisation, dont il devient un des dirigeants. Il y est entre autres question de la montée et de la chute de Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence américaine, de la marée noire du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique et d'autres récits inventés et couverts par les médias, dont un en particulier, dont l'ambition est particulièrement remarquable.
Ces "faiseurs d'histoires" utilisent les médias sociaux et traditionnels pour faire circuler leurs scénarios, dont ils contrôlent l'interprétation. L'idée est fascinante. On a là, en fait, des genres de nouveaux super-héros, mais geeks et discrets plutôt que musclés et ostentatoires. Fouillé parce que bien documentée, l'histoire des Producteurs est presque trop belle pour arriver... et c'est ce qui m'est entré en tête, sans ne plus en sortir, à partir de la réalisation du scénario final, qui deviendra l'aboutissement de la trilogie. Dommage, mais pourtant...
Et pourtant, ça plait. Les trois livres d'Antoine Bello sont traduits en plusieurs langues. Écrits sobrement, ils contiennent juste assez d'intrigues amoureuses pour ajouter le sucre nécessaire à un produit à succès. Pas que ce soit trop, non, mais il y a là comme un passage obligé où les deux personnages principaux, un homme et une femme, en viennent à se flirter. Pour ma part, c'est décevant parce que trop prévisible, ce qui n'est pourtant pas le cas du reste de l'intrigue.
Rédigé à la manière d'un scénario de film, Les Producteurs contient plusieurs dialogues, souvent savoureux, avec de belles pointes d'ironie. En fait, l'invention même de cette histoire constitue en elle-même une fameuse ironie sur notre monde de communications, de détournement d'opinions, et d'opinions tout court. Big Brother n'est pas loin, mais dans ce cas-ci, il a le beau rôle.
Un bon divertissement, truffé de bonnes occasions de réfléchir sur la place qu'occupent les médias dans notre vie.
On y suit le personnage principal dans l'évolution de certains "dossiers" de l'organisation, dont il devient un des dirigeants. Il y est entre autres question de la montée et de la chute de Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence américaine, de la marée noire du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique et d'autres récits inventés et couverts par les médias, dont un en particulier, dont l'ambition est particulièrement remarquable.
Ces "faiseurs d'histoires" utilisent les médias sociaux et traditionnels pour faire circuler leurs scénarios, dont ils contrôlent l'interprétation. L'idée est fascinante. On a là, en fait, des genres de nouveaux super-héros, mais geeks et discrets plutôt que musclés et ostentatoires. Fouillé parce que bien documentée, l'histoire des Producteurs est presque trop belle pour arriver... et c'est ce qui m'est entré en tête, sans ne plus en sortir, à partir de la réalisation du scénario final, qui deviendra l'aboutissement de la trilogie. Dommage, mais pourtant...
Et pourtant, ça plait. Les trois livres d'Antoine Bello sont traduits en plusieurs langues. Écrits sobrement, ils contiennent juste assez d'intrigues amoureuses pour ajouter le sucre nécessaire à un produit à succès. Pas que ce soit trop, non, mais il y a là comme un passage obligé où les deux personnages principaux, un homme et une femme, en viennent à se flirter. Pour ma part, c'est décevant parce que trop prévisible, ce qui n'est pourtant pas le cas du reste de l'intrigue.
Rédigé à la manière d'un scénario de film, Les Producteurs contient plusieurs dialogues, souvent savoureux, avec de belles pointes d'ironie. En fait, l'invention même de cette histoire constitue en elle-même une fameuse ironie sur notre monde de communications, de détournement d'opinions, et d'opinions tout court. Big Brother n'est pas loin, mais dans ce cas-ci, il a le beau rôle.
Un bon divertissement, truffé de bonnes occasions de réfléchir sur la place qu'occupent les médias dans notre vie.
Inscription à :
Articles (Atom)